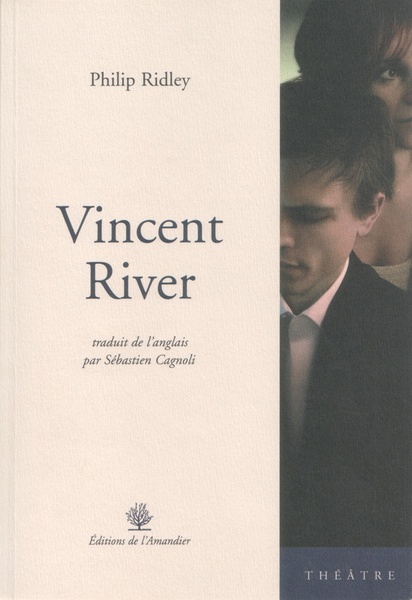 De la beauté à la terreur : les
mystères du monde de l’Autre
De la beauté à la terreur : les
mystères du monde de l’Autre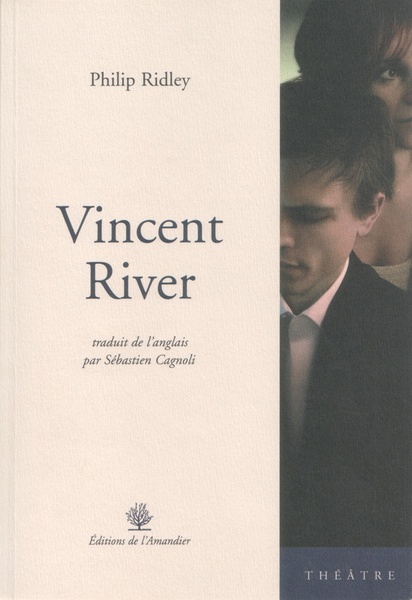 De la beauté à la terreur : les
mystères du monde de l’Autre
De la beauté à la terreur : les
mystères du monde de l’AutrePuma Glass a trente ans, mais il a cessé de compter ses anniversaires depuis le dix-neuvième. Il passe ses journées assis sous une lampe à UV, sans activité. Il habite dans l’East End de Londres avec Capitaine Toc, qui vit dans un monde d’oiseaux empaillés, un monde où le temps est suspendu. Il est vieux, mais il s’entoure de ces représentations d’une jeunesse éternelle. Puma voudrait rester jeune, comme ces oiseaux empaillés. The Fastest Clock in the Universe (L'horloge la plus rapide de l'univers, 1992) ressemble au joli conte de fées que raconte Capitaine Toc et duquel la pièce tire son titre. À l’instar de Narcisse, Puma est le plus beau jeune homme de l’univers et tout le monde l’admire. Mais il n’aime pas les gens. Il n’aime que lui et veut qu’on l’aime. Aussi est-il puni : il vieillit et perd sa beauté. La seule chose qui pourrait le sauver, dit le conte, c’est « l’Horloge la plus rapide de l’univers »… En invitant le jeune Foxtrot Chéri (Jude Law, lors de la création à Londres) à une illusoire cérémonie d’anniversaire, il ne fait qu’exercer une nouvelle fois sa cruauté. Capitaine Toc voudrait sauver Puma, il voudrait lui faire découvrir « l’Horloge la plus rapide de l’univers »… Le dernier mot de la pièce nous donnera la solution de cette énigme.
Peintre de formation, Philip Ridley est l’auteur de romans et de nouvelles, de pièces de théâtre et de scénarios, ainsi que de contes pour enfants. Ses pièces ont été créées à Londres, puis traduites et jouées depuis dans plusieurs pays — en particulier aux États-Unis et en Allemagne. Après avoir écrit le film The Krays[1], réalisé en 1990 par Peter Medak, Philip Ridley a mis en scène ses propres scénarios. The Reflecting Skin[2] et The Passion of Darkly Noon[3] lui ont permis de se faire connaître dans le monde entier. Alors que The Krays était une histoire typiquement anglaise, les deux films qu’il a lui-même réalisés, réunis sous l’appellation collective American Dreams, ont pour décor une Amérique onirique, un monde à mi-chemin entre réel et fantastique. Un monde imaginaire comme celui de l’enfance. Même quand il s’adresse à des adultes, Philip Ridley raconte ses histoires à travers un regard enfantin.
Qu’il s’agisse de pièces ou de romans, destinés à des enfants ou à des adultes, on reconnaît dans les personnages de ces textes des caractères récurrents : leurs noms sont étranges et évocateurs ; ils ont des secrets, des souvenirs qui les hantent ; souvent, pour garder leurs secrets, ils s’isolent dans une enfance illusoire dont ils refusent de sortir, au point parfois de perdre de vue la réalité. Doublement victimes, ils souffrent en silence sous le poids de secrets qu’ils ne peuvent partager, et sont persécutés à cause de leur comportement marginal et du mystère qui les entoure. Mais s’ils sont d’abord mystérieux et inquiétants, ils perdent peu à peu leurs masques pour dévoiler toute leur faiblesse et s’avérer profondément humains, d’une humanité poignante.
La carrière littéraire de Philip Ridley commence à la fin des années 1980 avec la publication de deux romans, Crocodilia (1988) et In the Eyes of Mr Fury (1989), où les thèmes ci-dessus s’affirment déjà d’une manière très personnelle. L’auteur y explore fidèlement la poésie sauvage de son imagination, sans se laisser brider par les convenances. L’amour y est au cœur des secrets, source de beauté et de terreur.
En exergue de son recueil de nouvelles Flamingoes in Orbit (1990), Philip Ridley cite des vers de Rilke : « … Car la Beauté n’est autre que le commencement de la Terreur… » Le ton est donné. Dans la nouvelle éponyme, le narrateur est un enfant de douze ans, qui vit avec sa mère et un mystérieux locataire. Celui-ci connaît justement cette expérience qui va de l’admiration de la beauté à la terreur. Il nous est présenté comme un homme « gros, chauve et bien rasé, avec une peau tendre et rose et des yeux humides, comme un énorme bébé ». Mais cet énorme bébé, aux yeux de la voisine, va devenir une menace pour ses hôtes. Quel secret cache cet homme qui passe des journées enfermé dans sa chambre ? L’histoire est rapportée par le fils, déformée par son innocence d’enfant de douze ans.
Dans certains pays, ce recueil est considéré comme un livre pour enfants. Pourtant, le ton grave, violent, qui tend parfois vers l’horreur, le rapproche plutôt du film de la même année, The Reflecting Skin. Ce « rêve américain » — qui tire son titre d’une image atroce d’enfant brûlé au napalm, la chair à vif — se déroule autour de quelques maisons dans un coin de campagne au ciel bleu et aux champs dorés. C’est là que vit le petit Seth Dove (Jeremy Cooper), avec ses parents et son grand frère, Cameron (Viggo Mortensen), de retour de l’armée. Dans le voisinage vit une femme seule, Dolphin Blue (Lindsay Duncan), recluse derrière les murs d’une maison délabrée. Seth observe les gens de son entourage, qui sont tous étranges ou en mauvaise santé. Plusieurs enfants du village sont retrouvés violés et tués. Et de mystérieux jeunes hommes parcourent la campagne dans une voiture sombre… À la recherche du criminel, le shérif mène l’enquête, mais sans grand succès. De son côté, Seth a tous les éléments pour résoudre les différents mystères. En tant que spectateur, d’ailleurs, on comprend rapidement de quoi il retourne. Mais le petit garçon, influencé par ses lectures fantastiques, établit des liens naïfs entre les événements, et parvient à des conclusions décalées. Il serait dommage d’aller plus loin dans le résumé de l’histoire ; elle est remarquablement bien construite, et même si l’on est forcément plus lucide que Seth, on ne peut s’empêcher, par moments, de se laisser emporter par son imagination juvénile. Je m’attarderai seulement sur le personnage de Dolphin Blue, cette femme qui vit seule, à l’écart de la communauté, entourée de mystère — ce qui fait d’elle une parfaite « sorcière ». La jeune femme sera même soupçonnée d’être un vampire, qui se nourrit de sang pour échapper au vieillissement. Ce thème de la sorcière se décline dans l’œuvre de Philip Ridley sous une infinité de visages. Il s’agit d’un adulte qu’un mode de vie solitaire rend suspect, et qu’on affuble d’une réputation d’« ogre » et de bourreau d’enfants.
L’isolement, le silence et les secrets rendent le monde de l’Autre décidément bien mystérieux et terrifiant… Dans un court-métrage de jeunesse, The Universe of Dermot Finn (1988), le jeune Dermot fait la connaissance de l’étrange famille de sa copine dans une maison de l’East End. Toutes les maisons de la rue se ressemblent, avec leurs briques rouges et leurs fenêtres alignées. Mais derrière la porte du voisin peut exister tout un univers qu’on est loin de soupçonner. Et naturellement, on est aussi soi-même un « voisin »…
L’East End, cet ancien faubourg populaire et industriel en marge de Londres, connu au XIXème siècle pour les faits divers sordides qui se sont perpétrés dans les brouillards de ses rues — on se souvient du mystère de Jack l’Éventreur —, ravagé par les bombardements de 1940, ce quartier défavorisé aujourd’hui en pleine mutation est le cadre privilégié des pièces de Philip Ridley. La première, The Pitchfork Disney (1991)[4], mettait en scène deux jumeaux, un garçon et une fille de vingt-huit ans, qui vivent seuls dans une pièce délabrée de l’East End, et qui ont cessé de grandir, pour ainsi dire, à la mort de leurs parents il y a dix ans. Ils trouvent du réconfort dans leurs tablettes de chocolat, dans leur tétine et dans l’anxiolytique de leur mère. Dans cet univers qu’ils conservent méticuleusement hors du temps surgissent tout à coup deux intrus, Cosmo Disney et Pitchfork Cavalier. Ces deux personnages extérieurs vont bouleverser l’harmonie illusoire de l’existence des deux jumeaux, ils vont s’insinuer dans leurs rêves et les terroriser. Le cauchemar récurrent raconté par Presley est terrifiant. En cinq pages, il fait le tour de tous les fantasmes, de toutes les angoisses caractéristiques des personnages de Philip Ridley. Presley rêve qu’à son réveil il est un vieillard, que personne ne veut admettre qu’il n’est qu’un enfant ; il parcourt la ville poursuivi par un dangereux tueur d’enfants auquel il échappe grâce à l’explosion d’une bombe atomique qui détruit tout et ramène Presley dans un monde où plus rien ne viendra le menacer ; et il redevient un enfant. Comme quoi, aussi terrible que soit la réalité, on peut toujours faire en sorte que tout se termine bien en s’échappant dans un monde imaginaire.
Le protagoniste de Ghost from a Perfect Place (1994), Travis Flood, est un vieillard qui retourne dans l’East End après vingt-cinq ans d’absence. À l’époque, il était un gangster respecté. Il semait la terreur dans la ville. Tout a changé. Le temps a passé. Mais il y a quelque chose qu’il ne peut oublier. Quelque chose qui va ressurgir quand il va rencontrer Torchie, la grand-mère de Rio. Rio a vingt-cinq ans. C’est une jeune fille mystérieuse, et Travis cherche à mieux la connaître. Quelque chose l’intrigue. Torchie se souvient avec nostalgie de cette époque révolue où les gangsters avaient du style. Pendant le premier acte, elle lui raconte des choses qu’il sait, des choses qu’il ne sait pas. Jusqu’à la naissance de Rio. Quant à Rio, entourée de sa bande de « gangsters » d’aujourd’hui, elle va raconter à son tour — pendant le second acte — des choses que Travis sait ou ne sait pas, et elle va faire éclater la vérité au cours d’une cérémonie violemment cruelle. Les deux générations s’opposent. Le fossé entre Travis et Rio est d’autant plus grand que bien des choses ont évolué pendant la longue absence de Travis. Il revient inchangé dans ce monde radicalement différent, tel un fantôme d’une autre époque. Mais si tout semble opposer Travis et Rio, ils ont bien plus en commun que leur appartenance à des époques différentes pourrait le laisser croire.
Les gangsters de l’East End de son enfance avaient déjà inspiré à Philip Ridley son premier scénario de long métrage, The Krays (1990), avec Billie Whitelaw — la diabolique gouvernante du petit Damien dans The Omen[5] — en mère poule d’élégants truands.
Le second long métrage entièrement écrit et réalisé par Philip Ridley, The Passion of Darkly Noon (1995), renoue au contraire avec l’Amérique imaginaire de The Reflecting Skin. Darkly Noon (Brendan Fraser) est un grand adolescent qui n’arrive pas à devenir adulte. Traumatisé par la mort de ses parents, il bégaye et regarde le monde comme un enfant. Perdu dans la forêt, il est recueilli dans une maison, auprès d’une jeune femme (Ashley Judd), et de son mari muet (Viggo Mortensen). Darkly Noon va donc vivre avec eux, au milieu de la forêt, où il va découvrir un monde qui lui était étranger. Et il sera tiraillé entre le monde d’enfant dans lequel il s’était enfermé depuis la mort de ses parents, et ce monde nouveau qui l’effraie et le tente. Comme The Reflecting Skin, on dirait qu’il s’agit d’une histoire banale vue par les yeux d’un enfant schizophrène — car Darkly Noon n’est autre qu’un grand enfant. Darkly imagine comme Seth des histoires de sorcières, et porte de fausses accusations. Et Philip Ridley nous met dans la peau de ce personnage, au point que l’on se demande parfois si ses hallucinations ne sont pas réelles. L’atmosphère inquiétante de la forêt et la violence de la dernière nuit ont fait dire à des critiques — influencés en cela par un dossier de presse ambigu — que Darkly Noon était un film d’horreur, ce qui les a laissés perplexes. Si l’on devait vraiment rattacher ce film à un genre, il faudrait dire qu’il s’agit en vérité d’un drame psychologique. L’auteur compare son film à Psychose. De fait son sujet rappelle le chef-d’œuvre d’Hitchcock — qui a certainement nourri son imagination, et que rappelaient aussi les oiseaux empaillés du Capitaine Toc dans The Fastest Clock in the Universe —, et il ne s’est pas tant intéressé à faire sursauter le spectateur qu’à insuffler une horreur viscérale par la peinture poignante d’un personnage terrorisé et terrorisant.
Je pense que les exemples qui précèdent illustrent assez l’originalité des noms propres que j’évoquais en introduction. Chaque personnage porte un nom de famille — hérité —, un prénom — choisi par ses parents —, et bien souvent un surnom — attribué par l’usage. Philip Ridley est bien conscient de l’influence de ces trois attributs, dont aucun n’a été choisi par celui qui les porte mais qu’ils identifient au sein de la société, sur le développement d’un enfant et sur l’adulte qu’il devient. C’est l’image que les autres ont de lui, et partant celle qu’il aura de lui-même, qui va se dessiner dans la résonance de ces trois vocables, et il est bien difficile d’échapper à ces images. « À la naissance nous sommes magiques et aimants et pleins d’émerveillement. Mais l’obscurité et l’ignorance nous entourent dans tous les coins. Jusqu’au jour où quelqu’un nous traite de monstre ou de diable et que nous le croyons. »[6] Et c’est ainsi qu’on devient une sorcière ou un ogre : quand la magie et l’amour se heurtent à l’obscurité et à l’ignorance.
Philip Ridley joue peut-être plus encore avec le pouvoir évocateur des noms propres dans ses œuvres pour enfants, qu’il élabore parallèlement à ses exploration psychologiques destinées à des publics adultes pour stimuler l’imagination des lecteurs en profitant de la part de fantastique que permet — et requiert, dans une certaine mesure — le genre littéraire du conte : Mercedes Ice (1989), Dakota of the White Flats (1990)[7], Krindlekrax (1991)[8], Meteorite Spoon (1994)[9], Kasper in the Glitter (1995), Scribbleboy (1997), ZinderZunder (1998), Vinegar Street (2000), Mighty Fizz Chilla (2002), Zip’s Apollo (à paraître en 2005). Dans plusieurs de ces petits romans, l’enfant protagoniste est confronté à un adulte enveloppé d’un mystère qui en fait une parfaite « sorcière ». D’autres se concentrent sur les relations entre individus dans un groupe d’enfants qui est une représentation en miniature de la société. La caractérisation des personnages, avec leurs traits caricaturaux et leurs tics de langage, ainsi que la narration souvent cinématographique, en rendent la lecture particulièrement vivante et attrayante. Si certains de ces textes s’adressent à de très jeunes enfants — notamment les petits contes The Hooligan’s Shampoo (1995) et Dreamboat Zing (1996) —, la plupart sont plutôt destinés en priorité à un public adolescent — de onze à dix-neuf ans, approximativement et non exclusivement — dont l’auteur cherche à stimuler l’imagination et l’amour de la vie. À cet effet, il montre qu’on peut transfigurer la réalité en racontant de belles histoires. Le théâtre, bien sûr, s’avère encore une fois le moyen idéal pour représenter la réalité de manière crédible afin de mieux la transfigurer, il a le pouvoir de donner vie à des monde plus « vrais » que la réalité, et c’est ce pouvoir que Philip Ridley a exploité dans ses pièces pour public adolescent : Sparkleshark (1997), Fairytaleheart (1998)[10], Apocalyptica/Brokenville (1998/2000), Moonfleece (2004).
Au lieu de représenter l’action sur la scène, c’est en racontant des fragments d’histoires qu’on construit alors devant le spectateur, petit à petit, une grande histoire que personne ne connaît vraiment dans sa totalité. Après avoir pratiqué ce mode narratif dans son théâtre pour jeune public, Philip Ridley l’a mis en œuvre dans sa pièce pour adultes Vincent River (2000). De la même manière, en l’occurrence, le mystère exposé dès le début de la pièce sera résolu progressivement au gré d’une mosaïque de petites histoires, de souvenirs, entre réalité et fiction, entre aveux et faux-semblants. Sans autre décor visible qu’un appartement en cours d’emménagement, encombré de cartons, lieu transitoire entre deux existences, le spectateur est transporté dans différentes époques, par des séquences assemblées comme dans un film, dans des lieux et des univers variés évoqués par les personnages de manière aussi convaincante que s’ils étaient représentés sur le plateau. Ainsi se succèdent des scènes de souvenirs qui sont toujours plus ou moins altérés par l’enthousiasme, l’imagination, le rêve ou le mensonge, des scènes qui se contredisent parfois mais qui, peu à peu, dessinent une mosaïque qui finira par révéler ce qui s’est passé. Car les événements passés, chacun n’en connaît qu’une partie : c’est ce qui conduit Davey et Anita à se rencontrer et à passer ensemble le temps qu’il faudra pour reconstituer, à eux deux, toute l’histoire de Vincent River.
De la fascination de la beauté à la solitude de l’ogre, du jardin secret de l’enfant au monde inquiétant de l’Autre, de la conception à la mort, c’est l’Amour qui est le moteur de toutes choses, de toutes ces histoires qui, réunies, constituent la vaste mosaïque de la vie : chaque histoire n’est peut-être pas tout à fait réelle, mais elle n’en est que plus vraie, comme l’auteur aime à le rappeler, voire plus vraie que la réalité même.
Jusqu’à présent, en France, le grand public n’a eu accès qu’à une pièce de théâtre et à deux ou trois longs métrages, sans vraiment pouvoir se faire une idée générale de la puissante cohérence du style de Philip Ridley. Darkly Noon y est passé à peu près inaperçu, avant tout parce que les cinq copies distribuées dans tout le pays n’étaient pas suffisantes pour attirer l’attention d’un public qui n’était pas familier avec l’œuvre de l’auteur. Il reste encore à organiser en France une rétrospective de toute son œuvre — théâtre, peinture, cinéma… —, qui prend de plus en plus de relief à mesure qu’on en explore les différentes parties, de la même manière qu’il faut reculer de quelques pas pour avoir une vue d’ensemble sur la fresque de la cafétéria de l’hôpital dans Vincent River.
Sébastien Cagnoli
1998 / 2004
[1] Les frères Kray.
[2] L’enfant miroir.
[3] Darkly Noon.
[4] Pitchfork Disney, traduction d’Elisabeth Wrightson et Evelyne Pieiller ; Ch. Bourgois, coll. « Le répertoire de saint Jérôme », 1993.
[5] La malédiction (1976), de Richard Donner.
[6] In the Eyes of Mr Fury, début de la quatrième partie.
[7] Dakota des cités blanches, traduction d’Annick Le Goyat, illustrations originales de Frédérique Vayssières ; Hachette jeunesse, 1991.
[8] Kikenkrok, traduction d’Annick Le Goyat, illustrations originales de Jean-Michel Nicolet ; Hachette jeunesse, 1993.
[9]
Du rififi chez les Ronchon [sic], trad. Yannick Surcouf ; Bayard, coll.
« Délires », 1997.
[10] Fairytaleheart, traduction de Marie Mianovski ; L’école des loisirs, coll. « Théâtre », 2000.