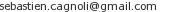I
Nostalgie
Si seulement ce soir quelqu’un jouait pour moi,
quand le soleil s’en va se fondre dans les flots.
Ah, si le calme ineffable des grands espaces
s’insufflait par ses mélodies dans mon sang chaud.
Si seulement ce soir quelqu’un jouait pour moi,
quand la nuit sur les joncs s’en va dormir le vent.
Car je suis si malade. Ici mon cœur aspire
aux noces des nuées et du soleil couchant.
Si seulement ce soir quelqu’un jouait pour moi,
et qu’il chantât pour moi quelque chant sur l’ennui.
Ô, s’il était possible, d’ailes scintillantes,
tel l’oiseau migrateur, de s’enfuir de la vie !
Printemps
Aujourd’hui est né le printemps.
La mer par ses baisers a dégelé le rivage.
Les mouettes ont lavé leurs ailes
au milieu des écueils lointains.
Hier encore le chapiteau du ciel était gris.
Quelqu’un a tendu un drap bleu à la place.
Le vent de sud-ouest a appris à parler
et il apporte des messages à l’homme :
Défonce les fenêtres de ton esprit,
où l’araignée d’un air mauvais
en hiver tissait sa toile.
Libère de sa cage l’oiseau de la nostalgie
et laisse-le folâtrer au milieu des écueils lointains
parmi une volée de mouettes.
Laisse-le voler de ses ailes inquiètes
avec les grues loin au-dessus des toits
quelque part, dans un autre monde,
dans les champs qui attendent,
dans un désert où la vie s’éveille.
Envoie les enfants aux boucles d’or de tes sens
saluer le printemps
qui aujourd’hui est né
au cœur de la nature,
dans les rayons du soleil
et en l’homme.
Mi-été
Il est doux de s’étendre ici.
Sur la paume du rocher.
Nu.
À peine sorti du bain.
Sur le front encore
une ribambelle de cheveux mouillés.
C’est l’été, ici.
À côté, au-dessus et devant.
Batifolant dans les corolles de l’œillet.
Les joues dans le rouge du fraisier.
Criant ses plaisirs dans les airs
en un chant de fauvette des ruisseaux.
Tu tends seulement la main
— et voici qu’elle est pleine d’été !
Il est doux d’être ici.
De regarder le labeur estival des fourmis.
Voilà le bonheur, voilà.
Regarder.
Sans pensées.
Le ciel au-dessus en guise de tente
telle une soie bleue.
Au plafond, une pièce d’or prodigieusement brillante.
La peau est maintenant mûre, c’est sûr.
Il est bel et bien
le véritable four à pain du Créateur,
ce rocher.
II
Berceuse
Dodo, dodo, mon moineau,
Dodo, mon oiseau en cage.
– Le monde est une cage. –
Que tu n’y sois né seulement
Pour devoir y plier tes ailes,
Bergeronnette de maman.
Dodo, dodo, endors-toi.
Que ma chanson ne te perde…
– De ton monde enchanté
Que le banal ne te réveille,
Que tu ne trembles de douleur,
Ô merle chanteur de maman.
III
Une analyse
(Un
ancien
chimiste donne dans la maison de fous son cours habituel)
Mes chers auditeurs, voyez, ce flacon…
— vauriens, modérez donc votre jargon ! —
oui, c’est Salomon, chimiste et royal,
qui a rempli ce flacon de cristal.
Mes chers, très chers auditeurs, regardez
ce liquide en son flacon scintiller.
— À tous les instants sa couleur varie. —
Le nom de ce liquide, c’est la vie.
C’est pour la science un mystère insondable,
sa formule est toujours impénétrable.
De l’étudier moi aussi je pris soin,
pendant cent nuits l’analysant en vain.
Car voyez : de même que sa couleur
peut se transformer du blanc tout à l’heure
en noir profond, de même sa formule
aussi se transforme. En vain l’on spécule.
Pour parler la langue des troubadours,
c’est la synthèse de haine et d’amour,
larmes et rire, travail et répit,
céleste manne et infernale nuit.
Expérimentons. — Ce flacon plus gris,
très chers auditeurs, de mort est rempli. —
Dans mon autre flacon je l’ai vidé :
inouïe est la synthèse effectuée.
Aah, voyez : le liquide disparaît !…
— Mes chers auditeurs, soyez rassurés :
le flacon ne contenait nul liquide,
rien qu’illusion et délire, et du vide.
La main
Combien
j’ai
peur
de
cette
main !
Elle abattit bien des travaux
maléfiques et déloyaux.
Elle n’a pas touché au bien.
Elle opprima les indigents,
vendit ce qui ne se vend point,
frappa sans en avoir besoin,
sema des germes de serpents.
J’ai peur de la main sur ma table.
Puisse-t-elle ici se flétrir !
Ah, la croix noire qu’elle tire
pèse sur ma vie misérable.
IV
Le vent et l’épi
Tu puisais ta force en terre,
suçant à humbles gorgées.
La chaleur ne manquait pas
mais bien peu d’eau t’arrosait.
Ton lieu de croissance aride :
une motte au bord d’un roc.
Pourtant tu veux t’acquitter
de la tâche qui t’attend.
Pour la fête de la vie,
qu’on célébrera demain,
en dispensant tout ton suc
tu as fait mûrir le grain.
— — —
Épi de tourbe de roc,
je frissonne sur ton sort,
lorsque le vent du nord-est
souffle fièrement vers toi.
Survolant le champ bien vite,
il halète de colère,
fouette d’averses de grêle
et fulmine et vitupère.
Le voici qui veut plier
les pins des bois éternels,
à sa volonté se plient
les nuages dans le ciel.
Comme il a déjà brisé
tant et tant de tes amis !
Devant la toute-puissance
sache donc baisser la tête.
— — —
Mais l’oreille du passant
entend un muet murmure :
Frappe, opprime et assassine,
vent, accomplis ton travail !
Moi, vulnérable et fragile,
assurément tu me brises.
Mais un dessein victorieux
a surpassé ton dessein :
celui de la création,
saint, éternel, solennel.
Tu m’as frappé, et je meurs
— j’ai semé le grain de vie.
Tandis que l’été grandit,
une précieuse récolte
enrichira le grenier
de la moisson du seigneur.
Le petit mot
Qui donc a prononcé pour moi ce petit mot ?
Je n’entendis rien d’autre, et n’ai d’autre mémoire.
Mais tel un tourbillon
étourdissant,
au loin il
transporta mon cœur.
Dans une vallée bleue, par-dessus les montagnes,
par les remous des mers les plus vertigineux,
il le mena baiser le
front du ciel
en un tourment
d’ardent désir.
Qui donc a prononcé pour moi ce petit mot ?
Je n’entendis rien d’autre, et n’ai d’autre mémoire.
Mais ainsi que
l’étoile
la plus haute
se serait
envolé mon cœur.
Finale
Mon chant de par sa
qualité
s’accorda-t-il à mon
esprit ?
De ma tête en feu les
caprices,
parfois nul ne les a
compris.
Jadis au milieu de la vie,
par un beau rêve
visité,
m’ont épuisé joies
et tourments
sous l’emprise de la
beauté.
Fier est le destin du
chanteur :
bénissant le chant, son
petit,
marcher avec la tête haute
à l’encontre de son oubli.
Version
1932 :
la
deuxième
strophe
a
été
supprimée (et la dernière
commence un peu différemment, mais sans impact sur la
traduction).