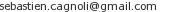En bateauAinsi le bateau léger fend les flotsde puissants avirons, en compagnie du son des flûtes d’or de jeunes vierges. Les filles jouent, elles nous divertissent. Un vin exquis écume dans les coupes, et dans l’esprit s’enflamme l’allégresse. Les immortels m’attendent, je suppose, chevauchant tristement dans le lointain — moi je vogue, insouciant, sur le bateau. Les palais et châteaux, qui autrefois surgirent sur ces collines désertes, ont disparu, ils se sont effondrés. Les sublimes paroles du poète sont éternelles comme un monument qui s’élève étincelant vers les astres. Dans mon ivresse j’agrippe ma plume, j’écris un chant digne d’un ouragan, et les cinq monts sacrés sont ébranlés. Je suis fier et joyeux, — et je me moque de tous les dons bigarrés de ce monde : ainsi que les feuilles des fleurs, ils tombent. La puissance, l’honneur et la richesse, le jour où j’y prendrai goût, on verra le fleuve Jaune remonter son lit. |
Complainte de l’épouseElle était seule en la vallée déserte,la jeune épouse à qui la providence avait accordé le don de beauté. Elle dit : Bien que d’illustre maison, j’ai pourtant connu mauvaise fortune et dans le désert je cherche un abri. Un grand malheur a détruit mon pays, et a tué mes frères dans le sang, eux dont la jeunesse n’était que luxe. On ne m’a pas laissé prendre leurs corps, pour que je puisse les ensevelir – notre siècle est gouverné par la haine. La vie est incertaine, tel le feu du flambeau porté dans le vent. Adieu, siècle tumultueux de mon époux ! Son cœur ne se soucie point de grandeur, il n’y règne qu’un seul désir : tenir dans ses bras quelque autre femme rieuse. Déjà ses yeux sont émus par la grâce d’une autre femme. Entendra-t-il jamais le soupir de l’épouse délaissée ! Loin d’ici j’ai envoyé ma servante vendre tous les diamants de mes bijoux : ne reste que ma maison de roseaux. Fragile est la maison. Je la répare avec des guirlandes de lierre aux murs ; le temps est froid, les habits sont légers. Ma servante apporte des fleurs – fi donc ! Comme marque de mon chagrin, plutôt, apportez-moi un rameau de cyprès. Déjà le soleil se couche. Je cherche à me protéger sous ces grands bambous pour y passer la nuit froide et déserte. |
Quand je serais le feuQuand je serais le feu, j’incendierais le monde.Quand je serais le vent, j’emporterais vos biens. Quand je serais de l’eau, je serais diluvien. Et quand je serais Dieu : – gare à vous si je gronde ! Quand je serais le pape, alors ma joie profonde serait de tourmenter l’âme de tous chrétiens. Quand je serais le roi je ferais pour un rien égorger mes sujets d’une main furibonde. Quand je serais la mort, j’embrasserais mon père ; quand je serais la vie, je serais loin de lui ; et je ferais de même avec ma vieille mère. Quand je serais Cecco – tiens, c’est ce que je suis, je prendrais près de moi les plus jolies rosières : et que le laideron offre à d’autres ses fruits ! |
S'i' fosse focoS'i' fosse foco, arderei' il mondo;s'i' fosse vento, lo tempestarei; s'i' fosse acqua, i' l'annegherei; s'i' fosse Dio, mandereil en profondo; s'i' fosse papa, serei allor giocondo, ché tutti ' cristiani embrigarei; s'i' fosse 'mperator, sa' che farei? a tutti mozzarei lo capo a tondo. S'i' fosse morte, andarei da mio padre; s'i' fosse vita, fuggirei da lui: similemente faria da mi' madre. S'i' fosse Cecco com'i' sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre: le vecchie e laide lasserei altrui. |
Le chevalier OlafI
Devant le dôme sont deux hommes, Revêtus de tuniques rouges, Et l’un n’est autre que le roi, Et le bourreau est le second. Et au bourreau parle le roi : « J’entends au chant de la prêtraille Que déjà prend fin le mariage – Prépare donc ta bonne hache. » Carillon et tumulte d’orgue, Et le peuple afflue de l’église ; Parmi la foule colorée, Les mariés parés d’ornements. Soucieuse et pâle comme un mort, Telle est du roi la jolie fille ; Sire Olaf est brave et joyeux ; De sa bouche rouge il sourit. Et souriant de sa bouche rouge Il parle au sinistre monarque : « Bien le bonjour, mon chère beau-père, Aujourd’hui ma tête t’échoit. Je dois mourir – Ô, laisse-moi Vivre jusqu’à minuit encore, Pour que je célèbre ma noce Qu’on boive et qu’on danse aux flambeaux. Laisse-moi vivre, laisse-moi, Jusqu’au fond de l’ultime coupe, Jusqu’au bout de l’ultime danse – Que je vive jusqu’à minuit ! » Et au bourreau parle le roi : « Que de notre gendre la vie Soit prorogée jusqu’à minuit – Prépare donc ta bonne hache. » Au banquet de noce, assis dans le groupe, Olaf a vidé son ultime coupe. Son épouse en détresse À lui se presse – Le bourreau se tient à la porte. La ronde commence, et Olaf prend vite Sa jeune épouse, et d’une ardeur subite Dans les flambeaux ils dansent L’ultime danse – Le bourreau se tient à la porte. Joyeux sont les sons du gai violon, La flûte lugubre a des soupirs longs ! À voir leur danse amère, Le cœur se serre – Le bourreau se tient à la porte. Et comme ils dansent, dans le hall qui tinte, Olaf murmure à sa triste conjointe : « Je t’aime plus que tout au monde – Froide est la tombe – » Le bourreau se tient à la porte. Ta vie prend un tournant fatal ! Car tu connus selon ton gré Une vierge de sang royal. Un requiem se fait entendre, L’homme arborant sa rouge veste Se tient déjà, la hache nue, À côté du billot funeste. Sire Olaf descend dans la cour, Où sabres et lanternes brillent, Et sourit de sa bouche rouge, Disant de lèvres qui pétillent : « Lune et soleil, je vous bénis, Et dans le ciel les astres clairs. Je bénis aussi les oiseaux Dont le babil emplit les airs. Je bénis la mer et la terre, Et les fleurs des prés harmonieux. Car douces sont les violettes Comme de ma femme les yeux. Douces prunelles de ma femme, La vie par vous m’est enlevée ! Je bénis enfin le sureau Au pied duquel tu t’es livrée. » |
Ritter OlafVor dem Dome stehn zwei Männer, Tragen beide rote Röcke, Und der eine ist der König, Und der Henker ist der andre. Und zum Henker spricht der König: »Am Gesang der Pfaffen merk ich, Daß vollendet schon die Trauung - Halt bereit dein gutes Richtbeil.« Glockenklang und Orgelrauschen, Und das Volk strömt aus der Kirche; Bunter Festzug, in der Mitte Die geschmückten Neuvermählten. Leichenblaß und bang und traurig Schaut die schöne Königstochter; Keck und heiter schaut Herr Olaf; Und sein roter Mund, der lächelt. Und mit lächelnd rotem Munde Spricht er zu dem finstern König: »Guten Morgen, Schwiegervater, Heut ist dir mein Haupt verfallen. Sterben soll ich heut - O, laß mich Nur bis Mitternacht noch leben, Daß ich meine Hochzeit feire Mit Bankett und Fackeltänzen. Laß mich leben, laß mich leben, Bis geleert der letzte Becher, Bis der letzte Tanz getanzt ist - Laß bis Mitternacht mich leben!« Und zum Henker spricht der König: »Unserm Eidam sei gefristet Bis um Mitternacht sein Leben - Halt bereit dein gutes Richtbeil.« II
Herr Olaf sitzt beim Hochzeitschmaus, Er trinkt den letzten Becher aus. An seine Schulter lehnt Sein Weib und stöhnt - Der Henker steht vor der Türe. Der Reigen beginnt, und Herr Olaf erfaßt Sein junges Weib, und mit wilder Hast Sie tanzen, bei Fackelglanz, Den letzten Tanz - Der Henker steht vor der Türe. Die Geigen geben so lustigen Klang, Die Flöten seufzen so traurig und bang! Wer die beiden tanzen sieht, Dem erbebt das Gemüt - Der Henker steht vor der Türe. Und wie sie tanzen, im dröhnenden Saal, Herr Olaf flüstert zu seinem Gemahl: »Du weißt nicht, wie lieb ich dich hab - So kalt ist das Grab -« Der Henker steht vor der Türe. III
Herr Olaf, es ist Mitternacht, Dein Leben ist verflossen! Du hattest eines Fürstenkinds In freier Lust genossen. Die Mönche murmeln das Totengebet, Der Mann im roten Rocke, Er steht mit seinem blanken Beil Schon vor dem schwarzen Blocke. Herr Olaf steigt in den Hof hinab, Da blinken viel Schwerter und Lichter. Es lächelt des Ritters roter Mund, Mit lächelndem Munde spricht er: »Ich segne die Sonne, ich segne den Mond, Und die Stern, die am Himmel schweifen. Ich segne auch die Vögelein, Die in den Lüften pfeifen. Ich segne das Meer, ich segne das Land, Und die Blumen auf der Aue. Ich segne die Veilchen, sie sind so sanft Wie die Augen meiner Fraue. Ihr Veilchenaugen meiner Frau, Durch euch verlier ich mein Leben! Ich segne auch den Holunderbaum, Wo du dich mir ergeben.« |
Dan Andersson
Revenants
Si ce soir dans ta
hutte tu es solitaire, ne ferme pas ta porte, non ! Sur les monts enneigés sous les étoiles claires comme autrefois nous revenons. Ce printemps fut au cimetière un long sommeil pour le repos de nos vieux os – sous le ciel bleu nous avons fait notre réveil, pour que la lune nous tînt chaud. Nous nous réunissons sous le ciel sans nuages dans le vent du nord furibond, afin de nous asseoir et porter témoignage sur ta vieille hutte à charbon. Car nous marchons sans cesse à tort et à travers au tombeau creusé par la faim, et si la paix fut grande en notre antre de terre, à la haine rien n’a mis fin. Et notre haine est celle d’un mort condamné à l’errance perpétuelle, et nuls pleurs, camarade, en nos yeux chagrinés, mais notre plainte est éternelle. Hélas ! de nos tombeaux trop tard nous nous levons pour exercer notre vengeance – ceux qui de nos tourments aiguisaient l’aiguillon sont morts aussi, et en errance. |
Gengångare
Är du ensam vid din mila i din koja
i kväll,håll öppen, håll öppen din dörr! Under glittrande stjärnor över snötäckta fjäll komma vi, komma vi som förr. Vi ha sovit redan länge i vår kyrkogårdsvrå och vilat våra gammalmansben - vi ha vakat för att skönja om himlen är blå, för att värma oss i månens sken. Under stjärnornas ögon må vi samlas till ting medan nordvinden härjar hård, må vi bänka oss ned i en domarering på din fridlysta kolaregård. Ty vi vandra, vi vandra och hava ej ro i de gravar som svälten har grävt, och fast friden var djup i vårt jordbyggda bo, vårt hat har den aldrig kvävt. Och vårt hat är ett vandrande dödmanshat som skall spöka tiderna ut, och vår sorg är en tårlös sorg, kamrat, och vår jämmer är utan slut. Men ve oss, för sent ha vi gått ur vår grav för att krämares domare bli - de män som skuro vår plågas stav äro döda och vandra som vi. |
Dan
Andersson
(1888-1920),
poète
suédois.
Le poème
extrait
du recueil Kolvaktarens
visor (1915). Je m'appuie ici sur l'original suédois.
Le violoneux de DooneyQuand mon violon sonne à Dooney,Le peuple danse comme l’onde ; Mon cousin prêche à Kilvarnet, Mon frère en Irlande profonde. J’ai dépassé frère et cousin : Eux lisent leurs livres dévots ; Et moi mon livre de refrains Acquis aux puces de Sligo. Quand nous viendrons devant saint Pierre, En grande pompe, au jour dernier, Il bénira les trois compères, Mais m’accueillera le premier ; Car c’est aux bons qu’est le bonheur, A moins de quelque male chance, Et les bienheureux, dans leur cœur Aiment le violon et la danse : Et en me voyant arriver, Ainsi s’écriera tout le monde : « V’là le violoneux de Dooney ! » Et tous danseront comme l’onde. |
The Fiddler of DooneyWhen I play on my fiddle in Dooney,Folk dance like a wave of the sea; My cousin is priest in Kilvarnet, My brother in Moharabuiee. I passed my brother and cousin: They read in their books of prayer; I read in my book of songs I bought at the Sligo fair. When we come at the end of time, To Peter sitting in state, He will smile on the three old spirits, But call me first through the gate; For the good are always the merry, Save by an evil chance, And the merry love the fiddle And the merry love to dance: And when the folk there spy me, They will all come up to me, With ‘Here is the fiddler of Dooney!’ And dance like a wave of the sea. |