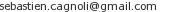L’imagePar tes yeux fixement déjà je regardais,Narcisse, en la source, d’une image captif et tandis que le temps tournait je revenais sous d’autres traits devant une image identique. Les années par milliers, en un serein murmure, glissent dans les broussailles à l’instar des vents. Je regarde toujours la profonde étendue. Dans le miroir l’image y est sans précédent. Je sais que je regarde une divinité. et qu'un être divin à son tour me regarde. Ah – d’un vorace appétit de félicité je me suis abreuvé dans ses yeux insondables. Je ne suis point lui — et pourtant je le ressens : c’est lui-même, et en lui-même, qu’il me faut être. Il me regarde, d’un visage ravissant — mais ma propre face est difforme et contrefaite. Ô laideur à la ravageuse cruauté ! Elle brûle comme la flamme sur l’autel en la présence du regard de la Beauté. C’est que les immortels ont un regard mortel. Je m’enfuis. Et je veux sortir de ma mémoire ce visage divin, dont la vision me ronge. Mais — voici que la source chemine avec moi. Et l’image se montre au plus profond des songes. En quelque lieu que j’aille, je la vois encore. J’ai beau me dire : « Bois jusqu’à tomber par terre ! » ou bien : « Souille ton corps, et sois malpropre ! », l’image me retient, je ne peux m’en défaire. Ainsi sans cesse, un dieu m’ayant sous son empire, je parcours l’existence en un cercle enchanté. C’est pour lui, après lui, si grand, que je soupire — moi, image grotesque et privée de beauté. |
 Magnus Enckell, Narkissos, 1897 |
Le regard
Dans tes brumes chaudes d’un calme platun temps d’orage est toujours là guettant,
un songe de prédateur tremblotant —
ton velours cache des griffes de chat.
Tu es, sur la mer secrète de l’âme,
la face claire où luit le nénuphar.
Ton fond regorge d’ombrages blafards,
où le reflet d’une pieuvre se trame.
Tu es, sans frontière, une mer d’énigmes.
La nouveauté de ton ciel qui s’étend
et de ta profondeur sans espérance
attirent le plongeur en ton abîme.
Tu apportes coraux et sable blanc,
dans la marée montante de tes lèvres ;
mais une cataracte alors te couvre —
ô regard de glaive, à double tranchant.
Les yeux échangés
Tu dis : « Comment peut-il se faire ? »— Nous n’avons fait que changer d’yeux.
Tu portes mes yeux de naguère,
j’ai reçu les tiens en leur lieu.
Tes yeux portaient la cruauté,
et les miens souffraient en silence.
Tes yeux cruels je dois porter —
et toi de mes yeux la souffrance.
Au bord
| J’ai peur quand je suis
dans ma chambre. J’ai peur en voyant la fenêtre et les silhouettes humaines ombres de lézards, reptiliennes, que sur le mur elle projette. J’ai peur de regarder la porte. La porte ouvre sur les ténèbres — la poignée pourrait pivoter, laissant entrer les innommés, les gens que je vois dans mes rêves… Et puis des murs aussi j’ai peur. Je sens un frisson me gagner : ils ne peuvent rien arrêter — ne sont que toiles d’araignées. Ainsi qu’une haleine étrangère effraie, la nuit, l’enfant qui dort, ainsi au travers de mes murs, me clouant à mes couvertures, Cela s’insinue, que j’ignore. Son épouvantable présence, je la sens. Elle est perceptible. Et des esprits font sentinelle dans ma chambre, au cœur de laquelle je me suis arrêté de vivre. C’est à peine si je respire. Je ne suis que peur mortifère. Un mot sans voix : Miséricorde ! L’aveugle dont les yeux abordent les hautes mers de l’univers que ma pensée incontinent entraperçoit à ce moment. Signal de détresse : Où, que diable, trouver un détroit navigable ? Et Dieu existe-t-il vraiment ? — Personne ne répond, personne. — Comme si près du lit passait la Mort levant son aiguillon. Comme si quelque part au fond le précipice rugissait. |
 Hugo Simberg, Caucase |
Pays désert
Immense à l’instar de l’Asie,
Désert tel l’océan glacial.
Ce n’est que sable gris,
Sable et massifs de rochers gris,
Et sans le moindre végétal.
Depuis longtemps déjà
Les empreintes des caravanes
Sont ensevelies dans le sable.
Nul mirage illusoire
Ne s’y distingue de la terre
Sur la voie vide du regard.
Le pays de mon âme
Est assombri par un nuage,
Loin, du ponant jusqu’au levant.
Et le dernier oiseau
Sous son aile a caché sa tête.
Il ne reste rien de vivant.
Sur le terrain de sport
Sur le bord du terrain de sportvoici qu’un garçonnet boiteux
s’était arrêté un instant
sous les branches du grand tilleul.
Il se tenait sur le gazon,
prenant appui sur des béquilles,
il regardait l’agitation
du jeu, avec des yeux fébriles.
Parmi le sable ensoleillé
où le tilleul portait son ombre,
plus d’un cri joyeux résonnait,
et des éclats de rire en nombre.
Les garçons foulaient en souplesse
ce terrain de sport de leurs pieds.
L’autre était debout, immobile,
l’autre qui était estropié.
Mais lui en toute vérité
ne pensait point à ses béquilles.
Une lueur d’enchantement
brillait sur sa face livide.
D’ardeur et de joie frémissait
sa narine, sous mon regard,
chacune des fois que la batte
frappait la balle en haut des arbres.
Et lorsque au delà de la ligne
quelqu’un se mettait à courir,
on eût dit que sous le tilleul
l’autre aussi venait de bondir —
comme si hors du corps boiteux
l’âme du garçonnet se fût
jetée dans la compétition
vers les autres, à corps perdu.
Il fit un pas — — mais tout à coup
comme s’il s’était réveillé
il se vit… Et sa jambe droite
n’était qu’un moignon atrophié.
Les garçons foulaient en souplesse
ce terrain de sport de leurs pieds
mais sous le tilleul se tenait
l’autre qui était estropié,
et qui, saisi d’un tremblement,
le teint grisâtre s’en alla
comme si sous le gilet brun
le cœur avait cessé de battre. —
Et un cri joyeux résonnait,
et des éclats de rire en nombre
parmi le sable ensoleillé
où le tilleul portait son ombre.
Chant nébuleux
Les moments planent comme les nuagesAu-dessus des plantations.
Derrière tous les nuages se tendent
Les bras voraces du Vide.
Il ne connaît pas la moindre pitié
Pour celui qui ose vivre,
Que portent des ailes de papillon
Au devant des yeux du Jour.
Plus on se dépêche vers les hauteurs,
Plus on tombera de haut.
La camarde fauche sa plantation.
L’araignée tisse sa toile.
Un chant ardent
En atteignant le bout du sentier hivernal,Il s’effondra, gelé, sur la couche de neige,
Le voyageur venu d’ici.
– Mais un chant, tout à coup, retentit sur sa tête.
Il retentit… et s’embrasa,
Versant sur le front du dormeur
Une couronne incandescente.
Le feu monta au ciel. Ici resta la terre.
Mon fils
Mon fils — qui jamais ne naquismais fus enfanté par le songe —
en cet instant de quiétude
tu es chez moi dans ma maison.
Contre le bord de mon bureau
je vois ton menton, petit homme.
Tu es là depuis un instant
ou peut-être longtemps, en somme.
Voici que tes grands yeux d'enfant
vifs comme un ruisseau me regardent.
Ta menotte très maladroite,
dans ma direction tu la dardes.
Tu dis un mot tout bas : Papa.
Et tu ne dis pas davantage.
Quand je veux prendre ta menotte,
tout à coup elle se dégage.
Mais c'est comme si hors de vue
elle m'appelait : Je suis là !
— Mon fils, au fond de tes prunelles
ma propre éternité je vois,
cela seul qui demeurera
quand je pourrirai sous la terre,
et c'est pour cette éternité
que je t'aime d'un cœur de père.
Je le pressens : lorsque la Mort
dans le Vide m'emmènera,
si tes petits doigts à l'instant
je les sens au bout de mon bras
et si, mon fils, tu dis encore
un petit mot, tout doucement,
je n'aurai plus peur d'avancer,
non, dans le cercle du Néant.
Pieds nus
Ainsi un jourje suis venu,
ainsi je marche :
mes pieds sont nus.
Les plaies à vif,
profonds sillons,
y sont béantes
sous les talons :
dans les jointures
où chaque pierre
s’est incrustée
du sang ruisselle.
— Mais ainsi que
j’ai commencé,
je finirai :
nus sont mes pieds.
Et quand le mal
devient profond
je dis alors :
« Cela est bon. »
« Que s’accomplissent
tous tes desseins,
ô mon Destin,
et non les miens. »
Le chant de la pyramide
Ô, pharaons, vous qui rêvâtesdes rêveries pyramidées,
recevez nos salutations
par-dessus des milliers d’années.
Au delà de la mort avide,
vers les éloignements du temps
vous avez projeté vos rêves
en érigeant vos monuments.
Recevez nos salutations
par-dessus des milliers d’années.
Les pyramides surgiront
tant que vivra l’humanité.
Chacun de nous à sa mesure
dresse sa propre pyramide.
Et au cœur d’icelle bientôt
nous dormons d’un sommeil placide
comme les pharaons, au calme,
comme la larve en son cocon.
Reste et se voit la pyramide.
Mais on oublie le pharaon.
L’éveil
Dans un pays qui est loin d’ici et que la mappemonde ne connaît pas — c’est là que j’ouvris les yeux.
Comment je m’étais retrouvé dans ce pays, je ne le savais pas. J’étais seulement là et j’ouvris les yeux.
En ce pays, l’existence était si différente d’ici que mes mots paraissent fades quand je voudrais la dépeindre. En ce pays il ne faisait ni chaud ni froid, ni sec ni pluvieux. C’était seulement un lieu rayonnant et parfumé. Une lumière éternelle qu’aucune ombre ne rayait. Un air vivant, nourrissant, où ne cheminait ni vent ni nuage.
En ce pays, je n’étais pas le même moi qu’ici.
Ici je traînais — et traîne — un fardeau ; je connaissais la peur, coupable, livré à la mort ; je voyais les ombres et mon ombre, interrogeant de jour en jour : Quoi ? Pourquoi ? et Qui en a décidé ainsi ?
Là-bas, j’étais ce qu’ici j’avais vaguement voulu être. Un être sans poutre ni cataracte, ouvert à tous les autres et beau en soi. Sans ombre, sans fardeau ni peur. Tel un nouveau-né qui ne se souvient ni n’interroge. Qui ouvre les yeux pour la première fois, voit chaque chose, la ressent bien, l’aime et fait un avec elle. Sans âge. Pourtant heureux de ce qu’il ressent : qu’il a toujours existé, et sera toujours — le même. Qui ouvre les yeux, avec dans l’esprit une joie indicible et une certitude :
Nous sommes sauvés, mon âme !
Je vis devant moi un grand arbre et sur lui des feuilles diaphanes. Et j’eus cette sensation : l’arbre me regardait. L’arbre était vivant. Les feuilles m’observaient… et bondirent en l’air. Elles se répandirent au-dessus de l’arbre comme un nuage doré. Et le nuage gazouillait. Mille petites voix d’oiseaux gazouillaient dans le nuage.
Les feuilles — les oiseaux.
Puis elles blanchirent de nouveau. Elles retournèrent à leurs branches. C’étaient des feuilles.
L’une d’entre elles, petite et duveteuse, se sépara des autres et s’approcha de moi. Elle virevolta autour de mon visage. Elle s’assit un instant sur mon bras, pleine d’une vie battante. Elle me regarda avec des yeux radieux et gazouilla :
« Où étais-tu ? »
Et je ne m’étonnai pas de comprendre le gazouillement. Tout en ce pays était naturel, allant de soi.
Je réfléchis à la question. Dans mon esprit s’éveilla un vague souvenir, comme une ombre fuyante. Et je répondis :
« Très loin…… dans le noir. »
Je les sentis tous m’écouter. L’arbre et les feuilles, l’air et la lumière.
« Qu’est-ce que le noir ? pépia l’oiseau.
— Là où l’on ne voyait rien.
— Était-ce comme quand tu fermes les yeux ?
— Ce n’était pas cela. J’avais les yeux ouverts… et je ne voyais pas. »
L’oiseau secoua pensivement la tête.
« Je ne comprends pas.
— Là-bas c’était laid. Et on s’y sentait mal.
— Qu’est-ce que “laid” ? Et qu’est-ce que “sentait mal” ?
— Ce sont…… je ne sais plus moi-même. Je me rappelle seulement que partout là-bas c’était différent d’ici.
— Non, je ne te comprends pas, gazouilla l’oiseau. Comment quelque chose peut-il être différent !
— Tu as raison : comment quelque chose pourrait-il être différent ! »
Et je compris :
« Tout a toujours été ainsi. Et je faisais un simple rêve…
— Ça je comprends, acquiesça l’oiseau. Tu faisais un rêve.
— Je faisais un rêve confus…… d'un pays étranger…
— Et maintenant tu t’es réveillé.
— Maintenant je me suis réveillé, maintenant mes yeux sont ouverts, et maintenant je vois ! Ce n’est pas laid, ce ne l’a jamais été, ce ne peut le devenir ! »
Et je vis la joie de l’oiseau. Et la joie de l’arbre et des feuilles. Et la terre qui me regardait de ses milliers d’yeux interrogatifs.
« Qui es-tu ? demandai-je à l’oiseau.
— La pensée la plus ardente, que tu invites et congédies. »
« Viens, gazouilla l’oiseau. Je reprends mon vol. »
Et l’oiseau déploya ses ailes diaphanes et se mit à survoler la terre en une courbe harmonieuse. Tout en volant, il gazouilla :
« Viens ! Il t’attend ! »
Et en même temps, toutes les feuilles s’envolèrent de leurs branches et c’étaient des oiseaux. Ils se joignirent à leur petit frère messager. Ils coururent guillerets par monts et par vaux. L’œil voyait seulement une nuée de rayures dorées ; elle étincelait dans l’air comme l’eau d’une fontaine.
Et de la terre s’épanouit une vie exultante. Je me vis debout au milieu d’une infinie nuée de fleurs. Dans mes narines ondoyait une merveilleuse mer d’arômes. Et quand je me mis à marcher… les fleurs avançaient avec moi. Elles s’épanouissaient devant moi, s’épanouissaient des deux côtés, passaient en volant derrière moi… battaient de leurs ailes de papillon. Et en l’air naquit un arc-en-ciel vivant. Lui aussi avançait avec moi.
Là où je marchais marchait au-dessus de la terre une vague d’allégresse et de beauté.
« Viens, il t’attend ! » C’était comme le murmure de milliers de flûtes.
Les oiseaux gazouillaient cela. Et l’arbre murmurait. Et les fleurs et les herbes. Et l’arc-en-ciel de papillons. Et la terre était sous moi comme une harpe au son cristallin.
Je ne savais pas quelle distance je parcourais. Qui peut mesurer un temps intemporel ? Et je ne savais pas où j’allais. J’obéissais à un appel merveilleux. Et je ne m’épuisais pas.
Soudain le murmure se tut. L’arc-en-ciel plongea dans la terre molle et y reposa comme un tapis bigarré. Les oiseaux volèrent en feuilles dans les arbres et les buissons. Le messager virevolta tout seul en l’air, en gazouillant :
« Attends là et regarde ! Attends et regarde ! »
En même temps, lui aussi était une feuille, la plus petite et diaphane de toutes.
J’attendis un moment — ou attendis-je mille ans ? qui sait ? Rien d’autre n’existait que l’attente, sans reprendre haleine. Comme l’attente de Dieu, quand il a dit : « Que cela soit ! ».
Enfin… un buisson remua. Le buisson s’écarta.
Quand je levai les yeux, voici — je Le vis.
En rêve je l’avais toujours cherché dans le noir – en vain. Dans l’intemporalité je l’avais déjà senti — et perdu. Partout j’avais rencontré les traces de ses pas — jamais lui-même.
À présent il était devant moi sous une forme vivante. L’Être sans nom — rêve de mon âme. La beauté l’enveloppait, comme un nuage, d’innombrables voiles diaphanes.
Tandis que je le regardais, il consumait les yeux et flétrissait le cœur — et les ranimait en même temps. C’était une béatitude au-dessus de toute mesure, profonde et débordante comme le ciel et la mer.
« Viens !
dit-il. Viens et sois mon hôte. »
Uuno Kailas, Paljain jaloin, 1928. Illustrations originales de Väinö Kunnas.
© 2004-2015, poèmes traduits du finnois par Sébastien Cagnoli