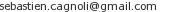ô porte de mon calme recoin,
sans le vouloir, en ton embrasure.
Je dis : Gardienne de mon destin……
Auparavant d'innombrables fois
j'ai passé par le seuil de ma hutte,
vers des voies de désirs et de luttes,
vers la déception et vers la joie.
Mais, ô ma porte, sur ton bouton
la main un instant s'est arrêtée.
C'est comme si, la tête voilée,
une norne rôdait dans ton ombre.
Ô porte ouverte sur le lointain,
ô porte qui mènes aux mystères :
de chez toi partent tous les chemins
de la terre — et d'une neuve terre.
Mes rêves jetaient de cette chambre
vers les astres de prodigieux ponts.
Là j'ai embrassé, bu jusqu'au fond
le poison de coupes enivrantes.
Une fois d'ici je m'en allai
d'un pas vif, avec la nostalgie
des matins clairs, du charme des nuits.
— Mais à présent tout est bien changé.
Car avec mon cœur roué de coups
j'ai regagné le seuil de mon huis.
Et je ne me suis point rétabli,
une fois mon cœur roué de coups.
Au bord de la mort et de la vie
je me mis alors à chanceler.
J'allais et venais et allais — mais
la Peur, de ses ailes, m'assombrit.
Parfois dans mon recoin je tremblote
comme on frémit au bord de la tombe.
À ma vitre vole une colombe,
qui réclame ma jeunesse morte.
— Ô porte, frontière de deux mondes,
tu gardes de mystérieux trésors.
Tu es ici l'écho de la mort.
Mais le rédempteur, où est-il donc ?
Combien de fois vainqueur et perdant
me faudra-t-il être encor, ma norne ?
Ta tête est voilée d'un voile morne.
Tu ne vois, mon œil, à un empan.
Ô savoir, tu ne révèles rien,
en vain tu tâtes la plaine entière, —
mais quant aux mystères des mystères,
comment donc en aurais-tu l'instinct.
Mais dans le cercle vicieux des ombres,
des souvenirs, des méfaits commis,
des longues nuits en lit d'agonie,
rester est au-delà de mes forces.
Le rédempteur, je veux le chercher,
que je ne rende un dernier soupir.
Du passé je vais vers l'avenir,
d'un monde à l'autre passant le gué.
Restez là, mes amis, à la ronde.
Je me suis fatigué de la terre.
En captivité, j'aspire au monde
où l'on m'affranchira de mes fers.
Mon âme, allons vers ta destinée !
Tant pour la soif que pour le tourment,
aveugle, en rêve chemin faisant !
Ô porte, j'ai tourné ta poignée.

Hugo Simberg