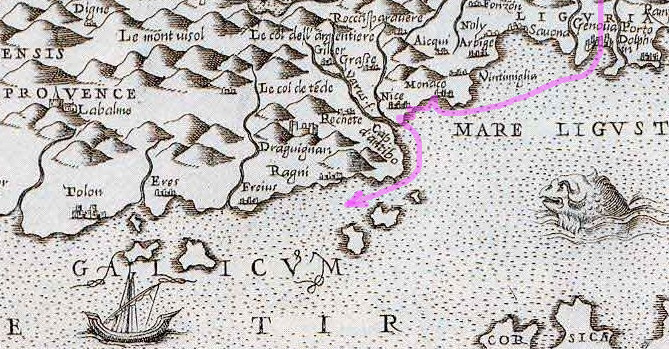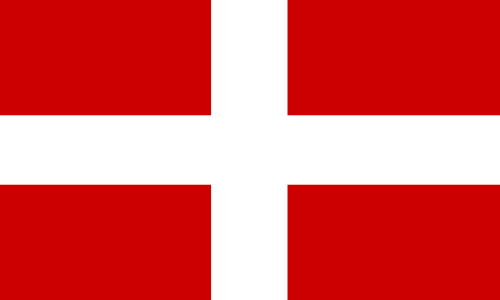
La campagne de Carras se trouve à l'ouest de Nice, au pied des
collines, en bord de mer, à 4 km environ des portes de la cité.
L'image ci-dessous donne une idée du cadre, et de la vue
qu'on y a sur Nice et sur le cap Ferrat. À l'écart de la ville et
de ses fortifications, le hameau est constitué de quelques
fermes et de maisons rurales de la noblesse niçoise, mais sa
situation n'est pas commode, exposée en permanence aux invasions
françaises (par la route) et aux pirates (par la mer). En effet,
si le Comté de Nice est éternellement un territoire frontalier
entre Provence et Piémont, sans cesse disputé par la France et
l'Italie (du Moyen-Âge à 1947), le quartier de Carras se trouve
aux confins mêmes de Nice et de la France : c'est en quelque sorte
la frontière de la frontière. Sa situation sur la grand-route du
littoral à l'entrée du Comté est stratégique pour le commerce,
mais catastrophique pour la sécurité.
La représentation ci-contre est tirée de la galerie des
cartes, au Vatican (XVIe siècle). La commune de Nice est indiquée
en jaune, avec la campagne de Carras en bleu.
XVe-XVIe
siècles

Le
13 mars 1490,
le duc Charles de Savoie meurt à l'âge de 22 ans (on pense qu'il a
été empoisonné par le marquis Louis II de Saluces). Sa veuve
Blanche de Montferrat [ci-contre]
prend en charge la régence de leur fils, Charles-Jean-Amédée, âgé
d'à peine un an.
Le
1er mai 1492, Blanche et
le
gouverneur de Nice (Antoine de Soumont) réforment la procédure
d'élection des syndics de la ville. Le sort désigne
Antoine Falicon parmi 8
citoyens chargés d'élire les 4 nouveaux syndics (un pour
chacun des 4 états) qui administreront la ville à compter du 1er
janvier 1493 : ils désignent le noble Matthieu Marquesan, le
marchand Jean Caravadossi, l'artisan Jean Nicolai et le paysan
Antoine Pittavino
[cf. Gioffredo].
Juillet 1524 : bataille navale dans la baie des
Anges
En Europe, le XVIe siècle n'est autre qu'une série de
conflits entre le Royaume de France et le Saint-Empire.
François Ier a pris le Milanais en 1515 (Marignan), mais
il en est expulsé par les troupes impériales dès avril 1524 (6e guerre
d'Italie, 1521-1525). Les Français battent alors en
retraite, et l'armée de Charles V est bien résolue à les
pourchasser jusqu'en Provence. Fin juin, les
belligérants arrivent sur le littoral niçois : les
Français s'abritent dans la rade de Villefranche (le duc
Charles II de Savoie étant alors "neutre"), tandis
que les troupes impériales mouillent à Monaco.
Le 7 juillet, les
Espagnols sortent 18 galères de Monaco pour débarquer
leurs troupes à Nice (flotte de l'amiral Hugues de Moncade, soutenue
à terre par l'infanterie de Charles III de Bourbon).
Mais 15 galères françaises interviennent et se
mettent à les bombarder (avec l'aide d'Andrea Doria). Les
Espagnols reprennent le large, sauf 3 navires,
qui n'arrivent pas à suivre et tentent tout de même de
viser la plage de Carras. Il s'ensuit une bataille
navale au cours de laquelle les galères impériales
sont attaquées, bombardées, capturées, libérées,
incendiées... avec de lourdes pertes des deux côtés.
|
 Juin
1538 : le Congrès de Nice Juin
1538 : le Congrès de Nice
En 1538, pour en
finir avec la 8e guerre d'Italie, le pape Paul III a organisé à
Nice un Congrès afin de persuader Charles V et François Ier de
consentir à une trêve.
Le souverain pontife à Nice le 17 mai, accompagné par
des diplomates vénitiens et par une douzaine de galères
espagnoles. Devant ce déploiement de forces militaires,
les Niçois paniquent : dans ce contexte de guerre
incessante entre les deux voisins, ils craignent une
véritable invasion et refusent donc d'ouvrir les portes de
la ville. Les abords de la baie des Anges sont dans
une tension extême, et tout le congrès va se dérouler sous
haute surveillance, hors les murs, la ville et son château
fortement gardés. Le pape, vexé, va s’installer
directement au couvent franciscain de la Sainte-Croix,
dans les faubourgs occidentaux de la ville, sur la route
de France, non loin du bord de mer.
Invité à plusieurs reprises par Paul III,
François Ier finit par arriver derrière la frontière le 31
mai. Il s’installe au château de Villeneuve-Loubet.
D’entrée de jeu, François pose ses conditions : "Si le cardinal de Carpi
avait écrit à sa sainteté la pure vérité, c’est-à-dire
que je ne voudrais jamais de la paix sans l’État de
Milan, le saint père aurait alors essayé d’obtenir cette
condition de l’empereur ; et en le voyant tout à fait
éloigné d’une telle concession, il n’aurait pas
entrepris un voyage inutile." Il répète "qu’il veut de l’État de
Milan, que cet État lui appartient, que tout le monde le
sait, que rien n’a jamais été d’une plus grande
évidence".
Les deux monarques ne se rencontrent pas
directement. Étant donné la tension extrême qui règne
autour de la cité, ils ne mettent même pas les pieds en
ville : Charles V reste dans la rade de Villefranche
; François ne va pas plus loin que Carras. Le pape fait la
navette entre les deux avec l’aide de messagers.
Il tente d’abord de rédiger un traité de paix,
avec pour objectifs : d’empêcher l’annexion pure et
simple du Milanais par le roi de France ; de restituer au
duc de Savoie les terres occupées par les
Français ; de persuader les Français de
s’éloigner des protestants et des musulmans, et de se
joindre à la sainte ligue qui est en train de s’organiser
pour aller combattre les Ottomans.
Une partie des entretiens se déroule "à la bastide du noble
François-Gaspard Dal Pozzo de Buschetta, qui est à la
tour de Carras", notamment le 17 juin. Le pape et
François y "parlèrent
de la paix, il tonna, les vingt-deux galères du
roi de France stationnaient continuellement devant
la tour, soit sous la pointe du Var".
Dans l'impasse, le pape se résout à
conclure une trêve. C’est sur la conclusion de cette
« Trêve de Nice » que se séparent les intervenants le 18
juin. L’Empire germanique reste maître de la totalité du
Milanais, mais la France conserve ses conquêtes (Bresse,
Bugey, Piémont). Le duc de Savoie n'a plus que les
provinces d’Aoste, de Verceil et de Nice. L’armistice est
censé durer au moins dix ans, pendant lesquels les deux
parties sont vivement encouragées à chercher un accord de
paix.
|
Août 1543 : le Siège de Nice
Censé durer 10 ans, l'armistice de 1538 est violé par
le roi de France dès 1542. La 9e guerre
d'Italie arrive aux portes de Nice en août 1543, lorsque les
navires français de François de Bourbon, comte d'Enghien,
assistés par la flotte turque du beylerbey Khayr ad-Din Barberousse,
soumettent la ville à un siège qui laissera de profondes
cicatrices dans toutes les mémoires.
|



 |
En
1561, le duc de Savoie
autorise les Niçois établis "le long du rivage maritime et donc
exposés aux nombreux dangers d'invasion maritime de porter sur eux
toutes sortes d'armes d'attaque et de défense, exception faite des
pistolets et des arbalètes, sans encourir aucune sanction".
Le premier acte de mariage d'un
Falicon
dans cette campagne niçoise est celui d'un fils de
Francesco (Antonio ?), en
février 1577 (sous le
règne d'
Emmanuel Philibert),
avec une certaine
Andrineta
Guillon (fille de Francesco Guillon).
Le hameau n'ayant pas d'église paroissiale, il relève directement
de la cathédrale Sainte-Réparate.
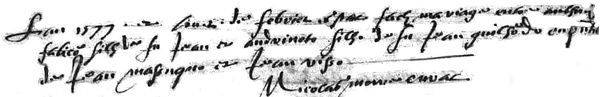
1590-1592 : guerre en Provence et razzias huguenotes
En France, les guerres de religion qui déchirent le
royaume depuis 1562 débouchent sur un conflit européen
lorsque Henri de Navarre, leader des huguenots, doit
succéder à Henri III sur le trône de France (1589-1594).
L'héritier légitime est soutenu par la reine Élisabeth
d'Angleterre, tandis que le duc de Guise bénéficie de
l'appui des catholiques : Espagne et duché de Savoie.
En 1590, le duc Charles-Emmanuel
envahit la Provence pour porter assistance à la Ligue
catholique. Son armée traverse la campagne de Carras le 14 octobre et
va affronter les troupes huguenotes dirigées par
François de Bonne, duc de Lesdiguières. Dans un
premier temps, l'initiative rencontre un certain succès,
et le duc de Savoie se fait proclamer "comte de Provence".
 
 Charles-Emmanuel vs
Lesdiguières
Charles-Emmanuel vs
Lesdiguières
|
XVIIe siècle
La branche décrite sur ces pages
est actuellement identifiée à partir de Luigi Falicon (fils d'Antoine ?) et de son épouse Lucrezia, dans les années
1610-1620 (sous Charles-Emmanuel).
Les actes d'état civil sont un
peu confus et difficiles à interpréter. En particulier, il
semble y avoir deux "Luigi Falicon" dont l'épouse se prénomme
Lucrezia (un mariage indéterminé avant 1616, et un autre en janvier 1623 avec Lucrezia
Viano, fille de Baptistin).
 1623 : raid barbaresque à Carras 1623 : raid barbaresque à Carras
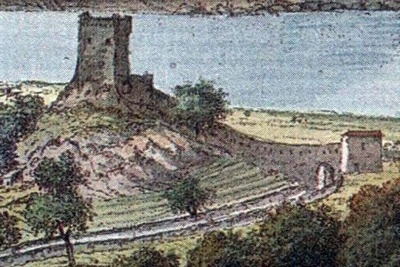 Le 17 juillet 1623, neuf galères et un
brigantin originaires d'Alger et de Bizerte accostent dans la campagne des Sagnes
(aujourd'hui l'Arénas et l'aéroport). 600 à 700 "Turcs"
débarquent et terrorisent le littoral depuis le Var
jusqu'au Magnan.
Ils brûlent et pillent tout ce qu'ils trouvent sur
leur chemin. Hommes, femmes et enfants s'enfuient et
cherchent un abri. Certains se réfugient dans la
"tour des Serres", mais les assaillants y mettent le feu,
causant la mort d'une centaine de personnes. Une
cinquantaine sont emmenés en esclavage. Les Ottomans
embarquent avec leur butin et mettent le cap sur la
Provence. Le 17 juillet 1623, neuf galères et un
brigantin originaires d'Alger et de Bizerte accostent dans la campagne des Sagnes
(aujourd'hui l'Arénas et l'aéroport). 600 à 700 "Turcs"
débarquent et terrorisent le littoral depuis le Var
jusqu'au Magnan.
Ils brûlent et pillent tout ce qu'ils trouvent sur
leur chemin. Hommes, femmes et enfants s'enfuient et
cherchent un abri. Certains se réfugient dans la
"tour des Serres", mais les assaillants y mettent le feu,
causant la mort d'une centaine de personnes. Une
cinquantaine sont emmenés en esclavage. Les Ottomans
embarquent avec leur butin et mettent le cap sur la
Provence.
 Représentation imaginaire des Falicon en fuite
pendant cet épisode : Luigi et Lucrezia, avec leurs
enfants.
Représentation imaginaire des Falicon en fuite
pendant cet épisode : Luigi et Lucrezia, avec leurs
enfants.
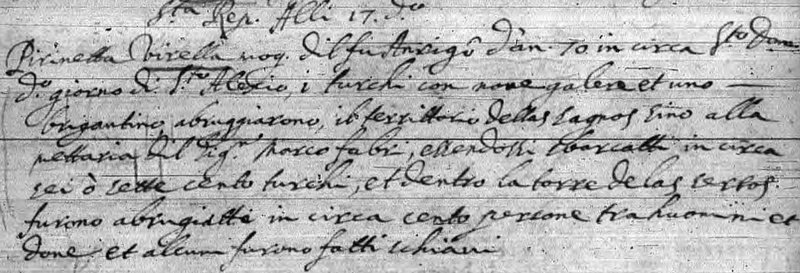 Le curé de la paroisse cathédrale rend
compte de l'incident dans le registre des décès.
Le curé de la paroisse cathédrale rend
compte de l'incident dans le registre des décès.
La "tour des Serres" était un ouvrage défensif,
vraisemblablement situé au niveau de
l'actuel boulevard Édouard-Herriot, entre la Bournala
et le vallon de l'Archet.
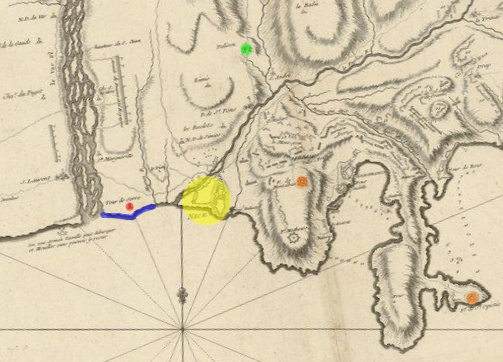
 À gauche : le littoral
concerné par les événements (en bleu), avec la tour
des Serres (en rouge) ; les forts qui surveillent le
littoral niçois sont en orange (Montalban et
Saint-Hospice) ;
À gauche : le littoral
concerné par les événements (en bleu), avec la tour
des Serres (en rouge) ; les forts qui surveillent le
littoral niçois sont en orange (Montalban et
Saint-Hospice) ;
la ville de Nice en jaune (et le village de Falicon,
sur le flanc du mont Chauve, en vert).
À droite : Alger, marché aux esclaves (gravure du
XVIIe siècle).
Dans le cadre de cette opération menée à Nice et dans les
environs, 623 personnes sont capturées.
Entre 1621 et 1625, on dénombre 8.000 à 25.000 esclaves
chrétiens à Alger.
|
Gioan Battista, fils de "Luigi et Lucrezia", naît
le 23 mars 1624. Je
suis tenté de penser que c'est le premier enfant de Lucrezia
Viano. En tout cas, la mère était
probablement enceinte lors de l'attaque des pirates
ottomans en juillet. Le garçon est baptisé le 25 à la
cathédrale.
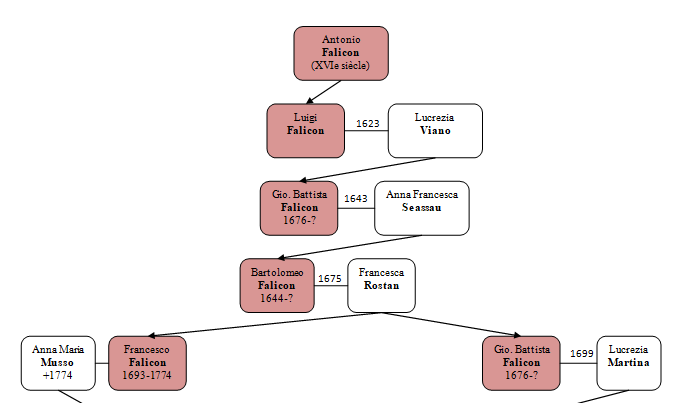
 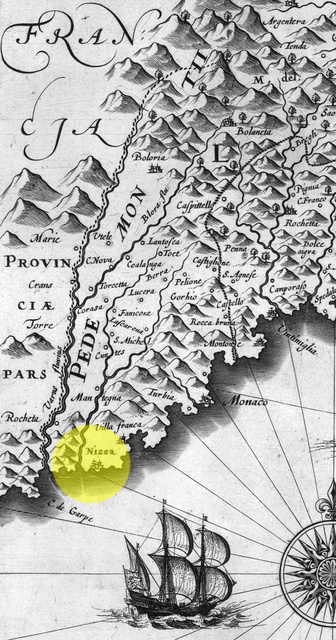 Mars 1629 : invasion française et
bombardements espagnols Mars 1629 : invasion française et
bombardements espagnols
Suite à l'extinction de la dynastie des Gonzague, les
possessions des ducs de Mantoue sont évidemment convoitées
par les Français et par les Habsbourg (guerre de
succession de Mantoue, 1628-1631), notamment le
Montferrat, entre Piémont et Milanais.
Sur le front du Var, l'invasion est imminente en mars 1629. Le 9, le habitants se
barricadent ; des renforts alliés (Espagnols et
Napolitains, puis Génois) mouillent à Villefranche et
s'approchent de Carras. Le 13, les Français construisent un pont sur
le Var et commencent à franchir la frontière. Pendant
plusieurs jours, les galères espagnoles de
Don Melchior Borgia bombardent le pont et la campagne
de Carras pour repousser les envahisseurs.
Finalement, suite à un accord de trêve signé à Suse
entre Charles-Emmanuel
et Louis XIII,
les Français se retirent le 9 avril.

 Charles-Emmanuel vs
Louis XIII
Charles-Emmanuel vs
Louis XIII
(La guerre n'est pas
finie pour autant. Avec le traité de paix de Cherasco en
avril 1631, la succession sera accordée au favori de
Louis XIII mais les ducs de Savoie annexeront une partie
du Montferrat.)
|
Le 16 août 1643 (sous Charles-Emmanuel
II), Gioan Battista Falicon
épouse Anna Francesca Seassau.
Leurs enfants : Bartolomeo
en 1644 ; Anna Camilla en 1647 ; Angela en 1649...
Dans les années 1640, Savoie et Bourbon sont alliés. Le 3 septembre 1648, Thomas
de
Savoie, prince de Carignan (et marié à Marie de Bourbon),
débarque sur la plage de Carras. Il rentre de Naples et se
dirige vers le Piémont.
Entre 1646 et 1656,
à l'initiative de la famille Rossignoli, une chapelle dédiée à
sainte Hélène est construite à Carras, parmi les vignes, les
oliveraies et les vergers.
 Portrait imaginaire de Louis et Lucrèce.
Portrait imaginaire de Louis et Lucrèce.
|
En 1663, un Bartolomeo Falicon
est nommé consul de Nice. Il représente sans doute
la classe des paysans.
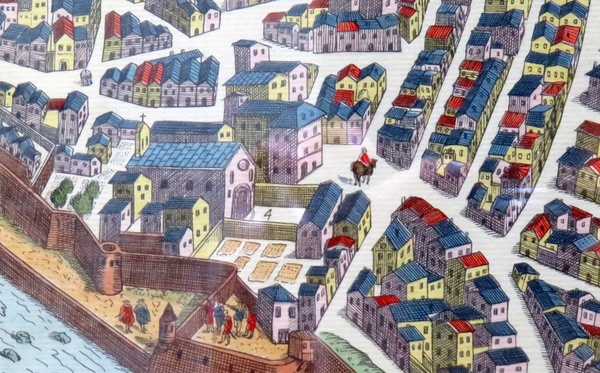
La place Saint-François et le Palais Communal, où siègent les consuls
de la ville [représentation du XVIe s.].
|
Notre
Bartolomeo se marie
en mai 1675
avec
Anna Francesca Rostan (fille de
Gioan
Francesco Rostan). En
juin
1675, couronnement du duc
Victor-Amédée II de Savoie.
Enfants de Bartolomeo et d'Anna Francesca :
Gioan Battista le 12 décembre 1676
(baptisé le 13) ;
Angelica
en 1679 ; Gioan Domenico en 1682 ; Marco en 1685 ; Pietro en 1687
; Angela Maria en 1689.
 Sur cette carte de 1685, l'emplacement du quartier de Carras
est indiqué en rouge.
On remarque au passage le village de Falicon sur le flanc du
mont Chauve.
Sur cette carte de 1685, l'emplacement du quartier de Carras
est indiqué en rouge.
On remarque au passage le village de Falicon sur le flanc du
mont Chauve.
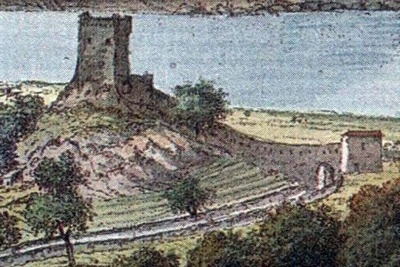
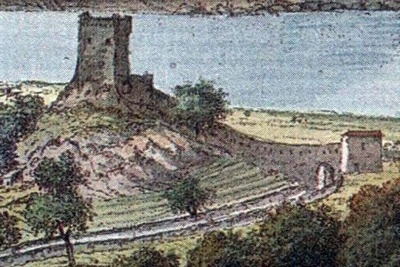
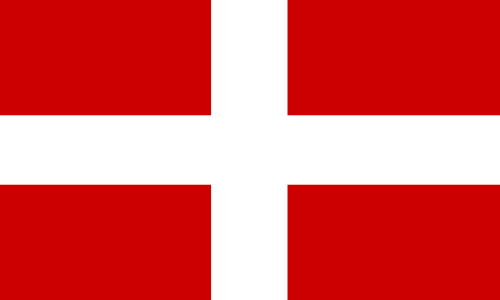
 Le 13 mars 1490,
le duc Charles de Savoie meurt à l'âge de 22 ans (on pense qu'il a
été empoisonné par le marquis Louis II de Saluces). Sa veuve Blanche de Montferrat [ci-contre]
prend en charge la régence de leur fils, Charles-Jean-Amédée, âgé
d'à peine un an.
Le 13 mars 1490,
le duc Charles de Savoie meurt à l'âge de 22 ans (on pense qu'il a
été empoisonné par le marquis Louis II de Saluces). Sa veuve Blanche de Montferrat [ci-contre]
prend en charge la régence de leur fils, Charles-Jean-Amédée, âgé
d'à peine un an.