Cagnolo,
haut Montferrat
|
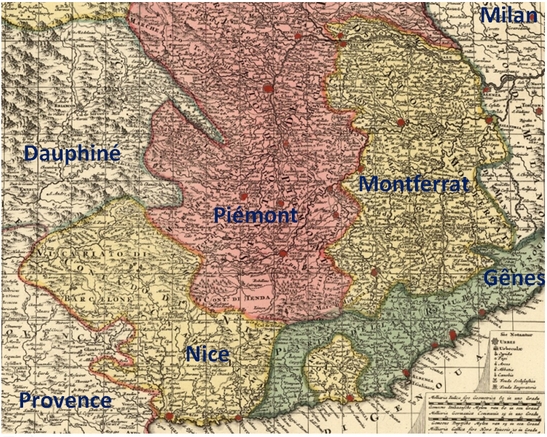
![Alto Monferrato, Bistagno, antico oratorio della Pieve
[photo SC février 2013]](alto-monferrato-2013.jpg)
 Le
Montferrat jouit d’une position stratégique sur la principale route
franchissant les montagnes entre la plaine du Pô et le littoral
ligure (par le col d’Altare alias Cadibona vers Savone, ou par celui
du Giovo vers Albisola). À ce titre, il est longtemps convoité d’un
côté par les voisins de Savoie et de Saluces, et de l’autre par les
Espagnols qui règent sur le Milanais.
Le
Montferrat jouit d’une position stratégique sur la principale route
franchissant les montagnes entre la plaine du Pô et le littoral
ligure (par le col d’Altare alias Cadibona vers Savone, ou par celui
du Giovo vers Albisola). À ce titre, il est longtemps convoité d’un
côté par les voisins de Savoie et de Saluces, et de l’autre par les
Espagnols qui règent sur le Milanais.  Le marquisat de Montferrat restant sans
héritier en 1536, l’empereur Charles V le confie à la dynastie des
Gonzague, ducs de Mantoue.
Le marquisat de Montferrat restant sans
héritier en 1536, l’empereur Charles V le confie à la dynastie des
Gonzague, ducs de Mantoue.[À droite : portrait imaginaire de la famille Cagnolo vers
1650.]






 |
 Vittorio Amedeo II de Savoie, en 1720. |
 |
 À l’issue de la Guerre de
Succession d’Espagne, en 1713, Victor-Amédée II reçoit le royaume de
Sicile.
À l’issue de la Guerre de
Succession d’Espagne, en 1713, Victor-Amédée II reçoit le royaume de
Sicile.
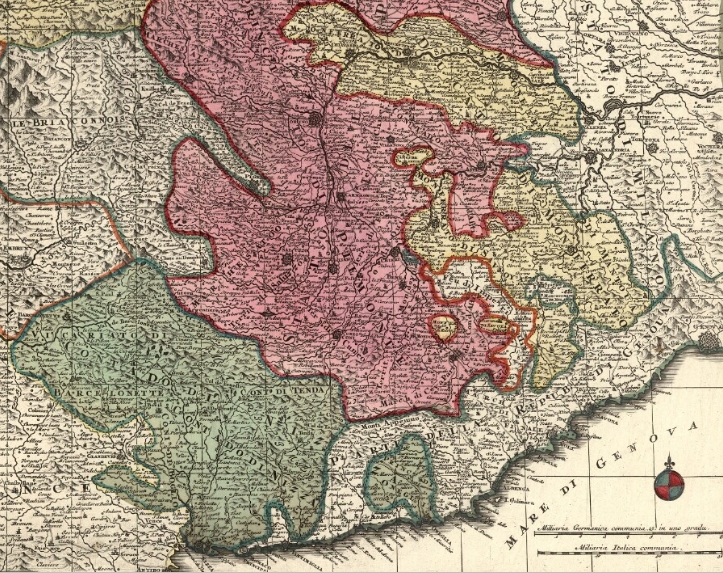
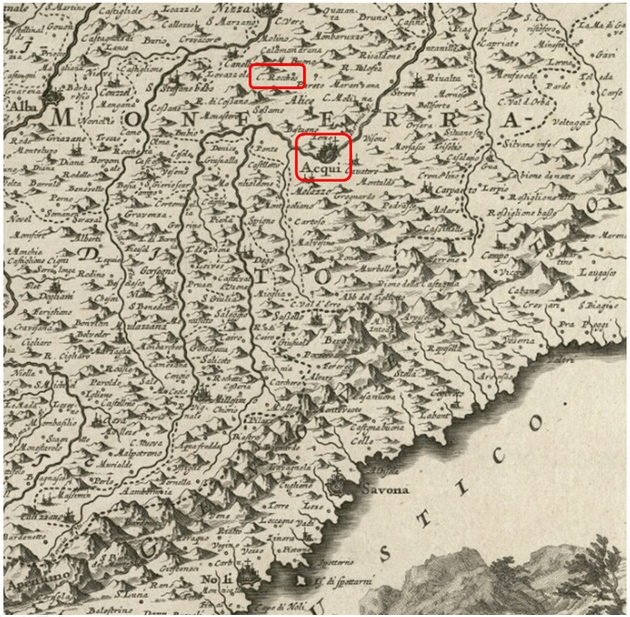 Castel Rocchero, village du diocèse d'Acqui
Castel Rocchero, village du diocèse d'Acqui  La principale activité de la province d'Acqui est
l'agriculture, notamment l'exploitation des vignes (aujourd'hui
encore, la région est réputée pour les appellations Asti,
Monferrato, etc.).
La principale activité de la province d'Acqui est
l'agriculture, notamment l'exploitation des vignes (aujourd'hui
encore, la région est réputée pour les appellations Asti,
Monferrato, etc.).
Castel Rocchero (ou
Rochero, les langues de la région étant
indifférentes aux consonnes doubles), anciennement Castrum Rocherium, était un
village de 171 habitants en 1604.
La population a considérablement augmenté par la suite,
jusqu'à 502 habitants en 1837, et 556 en 1855. (Aujourd'hui rattaché
administrativement à Asti, on y décompte 414 habitants en 2010. La
commune a une superficie de 5 km².)
Un ouvrage passionnant permet de se faire une bonne idée de
l'état d'esprit et de la vie quotidienne des habitants aux
XVI-XVIIIe siècles : Gatti neri, rane verdi e lucertole a due
code, de Paola Piana Toniolo (Impressioni Grafiche, Acqui
Terme, 2012). L'auteur exploite les archives du diocèse pour en
faire ressortir les cas de superstition ou de sorcellerie auxquels
les autorités cléricales furent confrontées à cette époque. Il
s'agit de litiges qui, de par leur nature, ne relevaient pas de la
justice civile mais des autorités religieuses. On y apprend
beaucoup de choses sur les activités des guérisseurs, sur les
dénonciations et accusations de magie noire ou d'envoûtements, et
sur le regard porté sur toutes ces affaires par le peuple et par
l'église.


Depuis 1708, le diocèse d'Acqui appartient aux États de Savoie,
devenus Royaume de Sardaigne en 1720. Peu à peu, les rois Vittorio
Amedeo II et Carlo Emanuele III mettent en place leurs
institutions, notamment juridiques, et cherchent à asseoir
leur autorité par la terreur. À cette époque,
Turin exerce une justice autoritaire, où les châtiments
exemplaires, qui font l'objet de mises en scène publiques, sont
destinés à convaincre les sujets de la toute-puissance divine du
souverain.
Dès lors, les Cagnolo sont confrontés à une série de problèmes avec cette nouvelle administration.
En 1733-1734, un Francesco Cagnolo, résidant à Castel Rocchero, fils de Gioanni Battista Cagnolo, est incarcéré à Acqui et comparaît devant la justice pour une double accusation : 1) pour avoir giflé sa femme Antonia enceinte de 4-5 mois, la faisant tomber et provoquant sa mort ; 2) il est accusé de vol à l’encontre d’un certain Clemente Viazzi. Les faits ont eu lieu le 26 avril 1731 et les 25 et 26 août 1733 à Castel Rocchero et Fontanile. Pour le décès de sa femme, il est inculpé, banni de la province pour deux ans et condamné à indemniser les héritiers de la victime ; pour le vol, il est acquitté.
 En
1735-1736, Michele Cagnolo, résidant à Castel Rocchero, fils
de Giovanni, est incarcéré à son tour à Acqui, en compagnie
de Lorenzo Thea (originaire de Castelletto Moina, mais
résidant lui aussi à Castel Rocchero) et Giovanni Francesco
Ignazio Fiore. En effet, il est soupçonné de complicité dans
l’homicide du maire de Calamandrana, Carlo Amedeo Dalmino,
perpétré le 27 janvier 1734 à Calamandrana, strada
delle Saline, dont Giovanni Francesco Bonifacio, absent, est
soupçonné d’être le commanditaire et Thea l’exécuteur
(Fiore, quant à lui, est accusé de s’être parjuré pour
couvrir Thea). Thea est inculpé et condamné à la torture
pour révéler la vérité (au moyen de tenailles ardentes),
puis à la pendaison publique après indemnisation des
héritiers de la victime. La sentence de Michele Cagnolo
étant censée dépendre du résultat de la torture de Thea,
l’issue n’est pas très claire, mais il a vraisemblablement
été acquitté. En
1735-1736, Michele Cagnolo, résidant à Castel Rocchero, fils
de Giovanni, est incarcéré à son tour à Acqui, en compagnie
de Lorenzo Thea (originaire de Castelletto Moina, mais
résidant lui aussi à Castel Rocchero) et Giovanni Francesco
Ignazio Fiore. En effet, il est soupçonné de complicité dans
l’homicide du maire de Calamandrana, Carlo Amedeo Dalmino,
perpétré le 27 janvier 1734 à Calamandrana, strada
delle Saline, dont Giovanni Francesco Bonifacio, absent, est
soupçonné d’être le commanditaire et Thea l’exécuteur
(Fiore, quant à lui, est accusé de s’être parjuré pour
couvrir Thea). Thea est inculpé et condamné à la torture
pour révéler la vérité (au moyen de tenailles ardentes),
puis à la pendaison publique après indemnisation des
héritiers de la victime. La sentence de Michele Cagnolo
étant censée dépendre du résultat de la torture de Thea,
l’issue n’est pas très claire, mais il a vraisemblablement
été acquitté.
On retrouve bientôt notre Michele Cagnolo dans les
prisons d’Acqui, dès 1739. Il a alors 70 ans (donc né vers
1668-1669 ? à moins qu'il y ait une erreur dans les
chiffres), et on l’a arrêté sur quatre accusations de vols
de bétail perpétrés à Castel Rocchero, Nizza della Paglia
(aujourd’hui Nizza Monferrato), Fontanile et Pareto en juillet
1736 et novembre 1737. Cette fois, il est
condamné à la torture pour dénoncer ses complices, et à
servir une peine de 10 ans de travaux forcés sur les
galères royales après indemnisation des victimes. Pour se faire une idée de l'atmosphère : voici l'accueil des galériens à la prison de Gênes, à la même époque, par Alessandro Magnasco (1667-1749) [Musée des beaux-arts de Bordeaux] |
Fils d'un certain Michele Cagnolo, Gioanni Battista vient
de Castel Rocchero. Selon toute vraisemblance, il est donc
étroitement apparenté aux précédents. Est-il appelé à servir dans
la Marine royale ? ou volontaire pour servir aux côtés de son père
? Toujours est-il qu'il quitte le haut Montferrat dans les années
1750 pour s'établir à Villefranche.