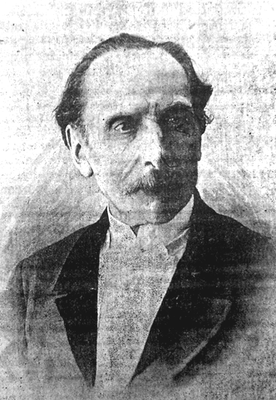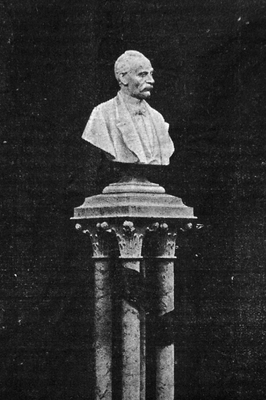Lorenzi & Guala : des familles déracinées
 Les Lorenzi, de Vintimille à Nice
Les Lorenzi, de Vintimille à Nice
Fils de Pietro Lorenzi et de Maria Lorenzi, Antonio
est né à Vintimille (à la fin de l'occupation française ou juste
après).
Les Lorenzi sont cultivateurs dans l'ouest de la commune, aux
confins de Menton (Mortala, Grimaldi).
La République de Gênes avait été occupée par Bonaparte à partir
de 1797. Depuis 1815, le littoral ligure, vestige de ce pays
génois démantelé par le Congrès de Vienne, fait partie des
États-Sardes, au même titre que le Comté de Nice ou le Piémont.

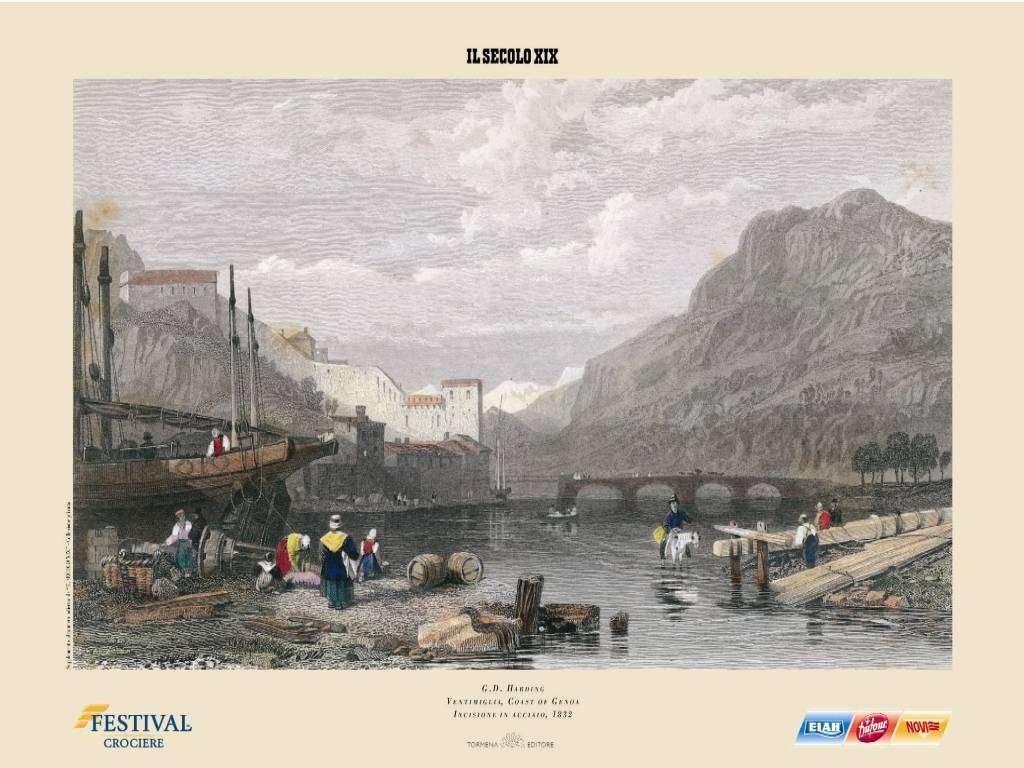
Vues de Vintimille en 1829 et 1832, paysages typiques du
littoral ligure, par William Brockedon et James Duffield
Harding.
Antonio "Lorenzo" grandit à Nice sous la Restauration et
devient maçon. Il est sans doute arrivé avec ses parents dans les
années 1820 (en tout cas, après le recensement de 1822).
Le 4 septembre 1836, il épouse (paroisse
Saint-Jacques) Maria Theresia Blanchi,
une blanchisseuse niçoise originaire de la campagne de Magnan.
Ils résident au 6 rue Centrale, près du pont Saint-Antoine.
Ils vont avoir deux enfants : Gioan Battista le 20 octobre
1837 et Rosa en avril 1844.
Gioan Battista "Laurenzo" deviendra
maçon, comme son père.
 Les Guala, de Verceil à Nice
Les Guala, de Verceil à Nice
Giovanni Guala et Teresa née Soragna sont
cultivateurs à Verceil, en Piémont.
La ville est une ancienne cité romaine et le siège d'un évêché
depuis le IVe siècle. Intégrée aux États de Savoie au XVe siècle, la
région de Verceil est notamment le centre majeur de la riziculture
en Europe (encore aujourd'hui).
Guala est
un
prénom d'origine germanique (lombarde), extrêmement rare mais
porté par quelques personnalités au Moyen-âge,
notamment Guala Bondoni, évêque de Verceil
en 1170-1182 ; un évêque de Savone (originaire d'Asti)
en 1199 ; le cardinal Guala Bicchieri (v.1150-1227),
fondateur de la basilique Saint-André de Verceil ; le bienheureux
Guala de Roniis (v.1180-1244), moine dominicain originaire de
Bergame et évêque de Brescia. Dès 1039, un certain Guala a reçu de
l'empereur Conrad II la confirmation de la possession de ses
terres à Casalvolone (fief à 8 km au nord-nord-est de Verceil,
outre-Sesia), incluant des gisements aurifères.
Guala est
aussi le nom d'une localité proche de Bielle, dans les montagnes
au nord-nord-ouest de Verceil. Il est resté en usage comme nom de
famille, principalement en Piémont. Un Pier Francesco Guala
originaire de Casale Monferrato (1698-1757) s'est distingué comme
peintre dans la région.
En 1761, un
Giovani Guala
a fondé une société d'exploitation minière à Alagna, dans les
hauteurs du Val Sesia [il pourrait être le grand-père de notre
Giovanni], en collaboration avec un Turinois et deux autres
personnes d'Alagna ; il supervise des travaux dans les mines
d'Alagna dans les années 1760. Dans la deuxième moitié du XIXe
siècle, un autre Giovanni Guala sera archiviste de la ville de
Verceil, et
Luigi
Guala (1834-1893) et son frère
Carlo
deviendront sénateurs du Royaume d'Italie.
Soragna est le nom d'une ancienne
principauté située entre Parme et Plaisance. Le patronyme est
discrètement parsemé dans la plaine du Pô.

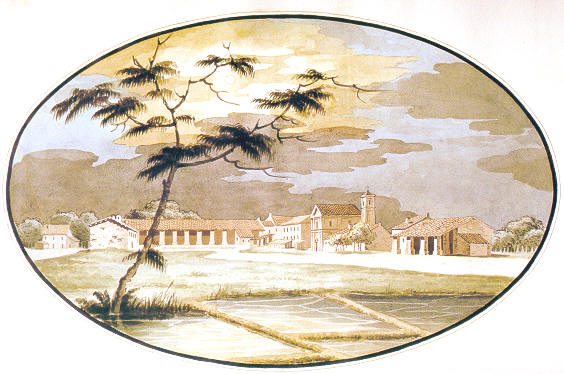 La basilique Saint-André (gravure de Barberis). - Une vue des
rizières de Lucedio au début du XIXe siècle.
La basilique Saint-André (gravure de Barberis). - Une vue des
rizières de Lucedio au début du XIXe siècle.
 Sur ce plan du XVIIe siècle, la cathédrale Saint-Eusèbe est
indiquée en rouge, et la paroissiale Saint-Sauveur en bleu.
Sur ce plan du XVIIe siècle, la cathédrale Saint-Eusèbe est
indiquée en rouge, et la paroissiale Saint-Sauveur en bleu.
 À
l'issue de la guerre de 1792-1796 (Première coalition), les États-Sardes continentaux
sont totalement désarmés (et le Comté de Nice et la Savoie sont
annexés à la France).
À
l'issue de la guerre de 1792-1796 (Première coalition), les États-Sardes continentaux
sont totalement désarmés (et le Comté de Nice et la Savoie sont
annexés à la France).
La guerre de 1798-1800 (Deuxième
coalition) aboutit à l'annexion de tout le
Piémont (les États-Sardes sont donc réduits à la seule île de
Sardaigne, où se réfugie la Cour). En 1802, Verceil est incorporée
au nouveau "département de la Sesia" [voir carte ci-contre].
Giovanni et Teresa se marient vraisemblablement en 1809.
La famille s'établit en ville, sur le territoire de la toute
nouvelle paroisse Saint-Sauveur, mais les baptêmes sont toujours
célébrés à la cathédrale Saint-Eusèbe.
Giuseppe ("Joseph") Guala, fils de Giovanni et de Teresa,
naît en août 1810.
Puis Gioanni Battista Eusebio Guala *09.02.1813
Les États-Sardes sont intégralement restaurés en 1814 (Traité de
Paris), et officiellement augmentés du pays génois en 1815
(Congrès de Vienne).
Angela Maria Clara Guala en mars 1815
Enfin, ils ont encore une Giovanna Maria Rosa, née vers 1827
(elle mourra à Paris 20e en 1896 et est inhumée au cimetière
parisien de Pantin).
Dans les années 1840, ses parents étant morts entre-temps,
Giuseppe s'installe à Nice (paroisse St-Dominique) où il exerce
le métier de tailleur. (Pourquoi
Nice ?)
Le Comté de Nice et le Piémont sont unis depuis la fin du XIVe
siècle au sein des États de Savoie, lesquels portent le nom
d'États-Sardes depuis 1720. (Sous l'occupation française, le Comté
de Nice était devenu "département des Alpes-Maritimes"
en 1793-1814).
Le 3 octobre 1846, âgé de
36 ans, Giuseppe épouse une jeune
fille de Lantosque, Antonietta Robini, qui est
cuisinière à Nice (30 ans). Le mariage est célébré comme il se doit
au village de la jeune mariée, dans la vallée de la Vésubie.
 À Nice, paroisse
Saint-Jacques
À Nice, paroisse
Saint-Jacques
La première fille de Giuseppe et d'Antonietta, Giuseppina Guala,
naît le 3 août 1847.
Abolition de la monarchie absolue (1847-1848)
1847 : réformes de Charles-Albert, qui commence à
assouplir l'absolutisme de la monarchie sarde. Il annonce la
liberté de la presse, l'amnistie des prisonniers politiques,
et promet une constitution. Ce premier pas est célébré à
Nice par un grand banquet sur la Terrasse, le 11
novembre. (Les voisins Léopold II et Pie IX
font de même en Toscane et aux États-Pontificaux. Seule
l'Autriche résiste sévèrement aux pressions populaires.)
C'est à cette époque qu'apparaît le Canto degli Italiani,
"Fratelli d'Italia...", composé par Michele Novaro sur un
texte de Goffredo Mameli (tous deux Génois), ainsi que de
nombreux hymnes à la gloire de Charles-Albert, notamment La Coccarda (mais la Marcia Reale d'Ordinanza
de Giuseppe Gabetti reste le seul hymne officiel des États
de Savoie, depuis les années 1830 et jusqu'à 1946).
Le 8 février 1848, Charles-Albert annonce la
promulgation de la constitution, le Statuto,
qui transforme le régime en une monarchie parlementaire.
 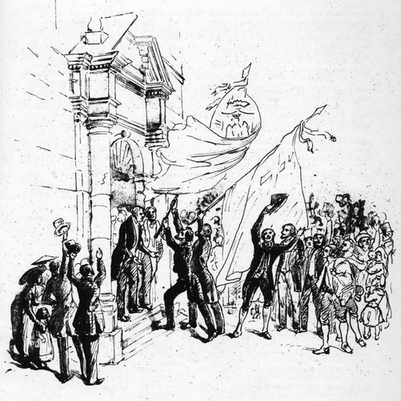
Ci-dessus, Charles-Albert signe le Statuto, à
Turin, le 4 mars 1848. À droite, les Niçois
célèbrent la promulgation du Statuto devant le
Palais Communal.
Les premières élections sont organisées le 27 avril
1848 : désormais, des députés vont représenter la
province de Nice à Turin.
|
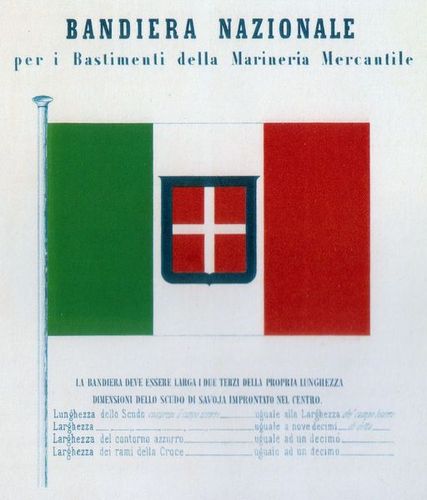
Première Guerre d'Indépendance italienne (1848-1849)
Dans le cadre des révolutions de février 1848, Charles-Albert décide de s'engager en
faveur des rebelles. En mars, Turin commence à mobiliser des troupes
pour aller soutenir les Milanais qui se soulèvent
contre leur empereur Ferdinand Ier. Au
total, les effectifs sardes mobilisés s'élèveront
aux 4/5 de l'armée (65.000 hommes).
C'est dans ce contexte que le
roi adopte le drapeau tricolore des révolutionnaires
italiens [nouveau drapeau des États-Sardes,
ci-contre].
Peu après la bataille de Custoza (24-25 juillet),
Charles-Albert capitule au début du mois d'août et signe un
premier armistice avec les Autrichiens.
À la fin de
l'année, l'empereur d'Autriche abdique au profit de son
neveu François-Joseph, âgé de 18 ans.
Le 12 mars 1849,
les alliés rompent le cessez-le-feu avec les Autrichiens.
Mais le sursaut est de courte durée : après une dernière
défaite à Novare le 23 mars), Charles-Albert abdique
(s'enfuit incognito et meurt en exil au Portugal), et son
successeur Victor-Emmanuel
II vient signer l'armistice définitif avec le maréchal
Radetzky (Vignale, 24 mars). Le traité de paix sera
signé à Milan le 6 août.

 
 Ferdinand Ier. -
Charles-Albert et ses troupes traversant le Tessin. -
Radetzky et Victor-Emmanuel II. - François-Joseph.
Ferdinand Ier. -
Charles-Albert et ses troupes traversant le Tessin. -
Radetzky et Victor-Emmanuel II. - François-Joseph.
|
 Anna Maria Guala naît
le 21 juillet 1849. C'est
leur deuxième fille.
Anna Maria Guala naît
le 21 juillet 1849. C'est
leur deuxième fille.
Giuseppe meurt dès le 4 novembre à l'hôpital
Saint-Roch (alors situé rue Saint-François, dans la Vieille-Ville),
âgé d'une quarantaine d'années.
Antonietta élève donc
seule leurs deux filles.
Elle se remarie le 8
octobre 1853 à St-Pierre-d'Arène, avec un Milanais (y a-t-il un rapport avec
la guerre de 1848-1849 ?), Francesco Maglio, originaire de
"Vagliano, diocèse de Crema, Lombardie" (probablement Vaiano
Cremasco).
[Ci-contre : une représentation imaginaire de Pietro et Maria
Lorenzi.]
La mère d'Antonio Lorenzo, Maria, meurt dans la vieille
ville en juin 1855.
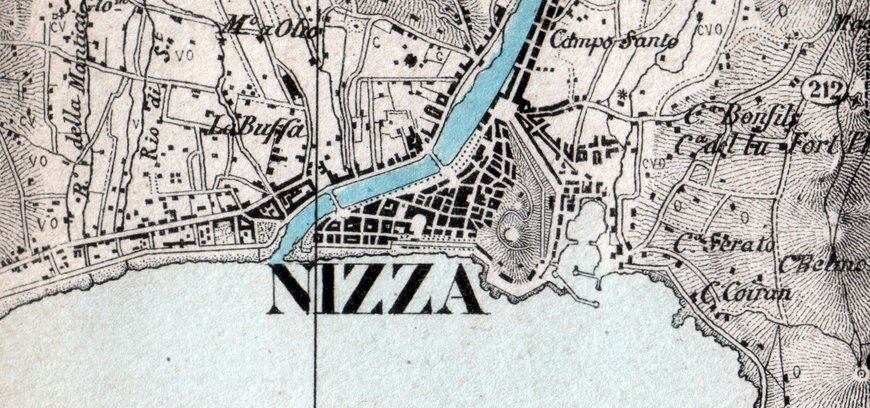
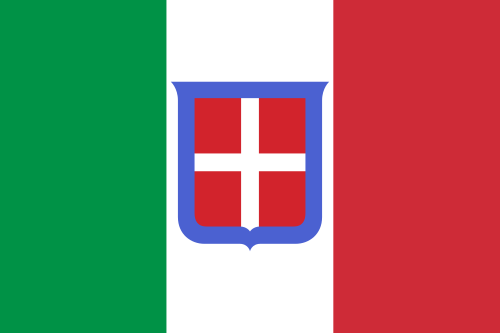
 Détail de la carte d'état-major des États-Sardes
des années 1850.
Détail de la carte d'état-major des États-Sardes
des années 1850.
Comme les Niçois, les Lorenzi et les Guala sont sujets des États
de Savoie. Ils viennent simplement des régions historiques
adjacentes (pays génois et Piémont).
Mais voici qu'en 1860, le roi cède Nice et la Savoie à Napoléon III
: l'ancien Comté devient français, et les Génois et Piémontais de Nice sont
subitement séparés de leurs racines par la nouvelle frontière.
Peu à peu, ils vont être considérés comme des "étrangers"...
Le maçon Jean-Baptiste Laurenzo et
la femme de chambre Joséphine Guala se marient le 30 janvier 1869.
Ils ont bientôt quatre enfants :
- Marie (née le 29
novembre 1869) ;
- Annette (qui épousera un certain Camille Thaon) ;
- Antoine (né en 1873,
qui épousera en 1897 une Marie Veran) ;
- Francine (née en 1874,
qui épousera Alfred Caujolle).
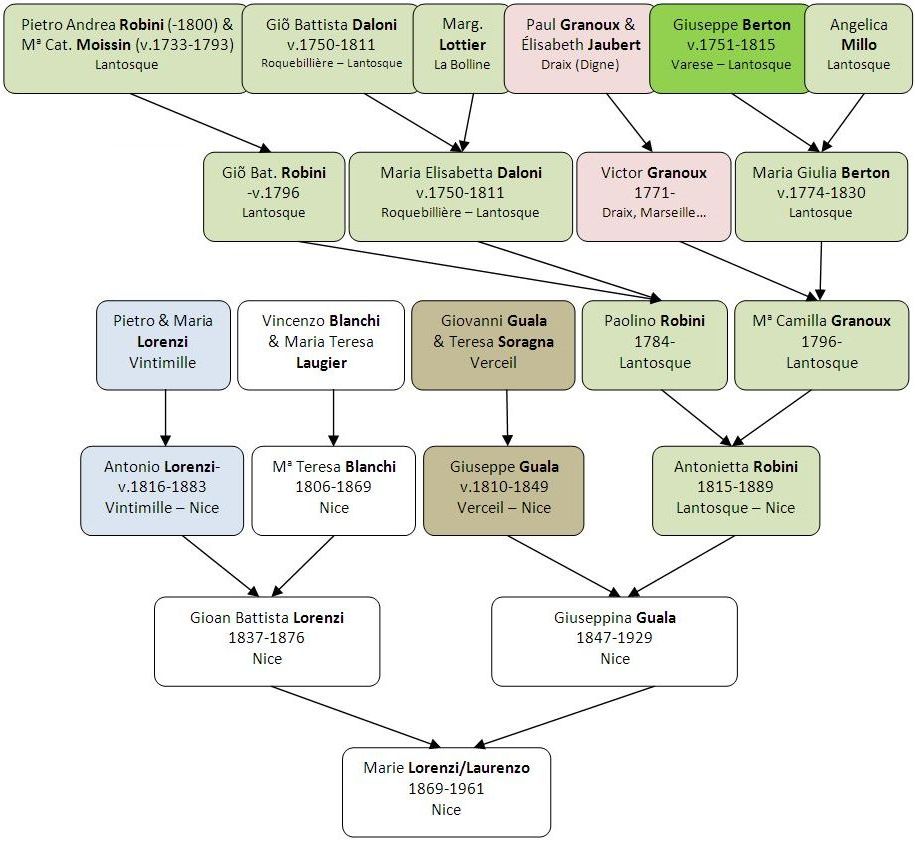 [cliquer sur la carte pour
l'agrandir]
[cliquer sur la carte pour
l'agrandir]
Joséphine a une sœur : Anna Maria, née en 1849
et également baptisée à Saint-Jacques.
Celle-ci se marie à son tour à Nice en 1875, avec
François Henri Blanchet (né en 1837 à Chambéry).
Nombreux enfants.
 En 1882, les Blanchet
traversent l'Atlantique et débarquent à New York.
Ils vont aussitôt s'installer à Santa Barbara, en
Californie.
Autres enfants...
Le mari meurt en leur demeure de Montecito en 1902.
Anne Marie meurt à son tour en 1922, à l'âge de 72 ans
Ils sont inhumés au Calvary Cemetary de Santa Barbara.
|
À la mort de son mari (le 4
octobre 1876, au 4 rue du Moulin), Joséphine reste veuve à
29 ans. Une concession à perpétuité est acquise dans le 1er carré du
nouveau cimetière qui vient d'être créé à Caucade.

Joséphine Lorenzi née Guala (1847-1929), vers 1877. |
 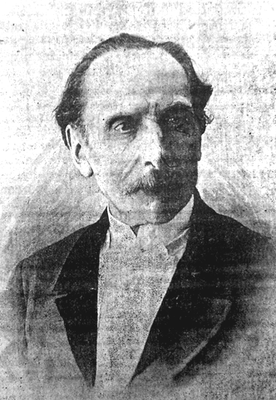 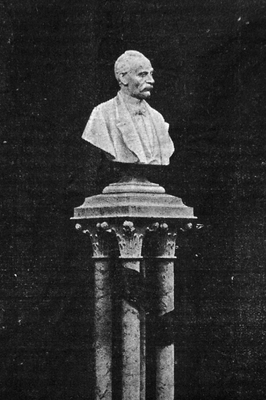
Pendant ce temps,
à Verceil, le cousin Luigi (1834-1893), fils de
médecin, est conseiller municipal (depuis 1868) ainsi
que sénateur à partir de 1890. |
Le 25 janvier 1883, décès
du père de Marie, Antonio Lorenzi (1 rue Halle-aux-Herbes, dans la
Vieille-Ville).
Le 19 avril 1888, Marie Lorenzi épouse le
marchand de meubles Louis Carlés.
Curieusement, Marie restera obsédée par le sentiment que le nom de
son père a une consonance "étrangère".
Le 13 août 1892, par
jugement du tribunal civil de première instance de Nice, elle
parvient à changer son nom de jeune fille en "Laurenzo", curieuse
orthographe sous laquelle son père avait été baptisé sous la
Restauration sarde en 1837.
Il faut dire que la situation est complexe : elle est née française à Nice, de
parents issus de familles non niçoises des États-Sardes devenues
françaises par annexion mais considérées comme étrangères par les
Français ; et son mari est issu par son père d'une famille
française immigrée à Nice avant l'annexion et, par sa mère, d'une
vieille famille niçoise.
Joséphine Laurenzo née Guala meurt au 27 bd Gambetta le 3 mars 1929.
Après la mort de son mari (le 5
mai 1934), Marie "née Laurenzo" dilapidera leur fortune au
casino (notamment l'immeuble du 27 boulevard Gambetta).


 Marie Carles "née Laurenzo" (1869-1961) vers 1909 et en 1955. Le 27 boulevard
Gambetta.
Marie Carles "née Laurenzo" (1869-1961) vers 1909 et en 1955. Le 27 boulevard
Gambetta.
Sépultures
Au cimetière de Caucade (carré 1, CAP 1426) se trouve la tombe
de la "famille Jean-Baptiste Laurenzo", où reposent Jean-Baptiste (1837-1876), avec sa belle-mère Antoinette
Robini (1815-1889), son fils Antoine (1873-1928)
et sa veuve Joséphine née Guala (1847-1929) ; ainsi que le
gendre Alfred Caujolle (+1932) avec son épouse Francine (1874-1941).
Annette (1871-1904) repose dans le caveau de son mari
Camille Thaon (carré 13) :
Marie "née Laurenzo" est inhumée avec son mari au cimetière du Château.
Retour à l'index Europe 1815
 Les Lorenzi, de Vintimille à Nice
Les Lorenzi, de Vintimille à Nice Les Lorenzi, de Vintimille à Nice
Les Lorenzi, de Vintimille à Nice
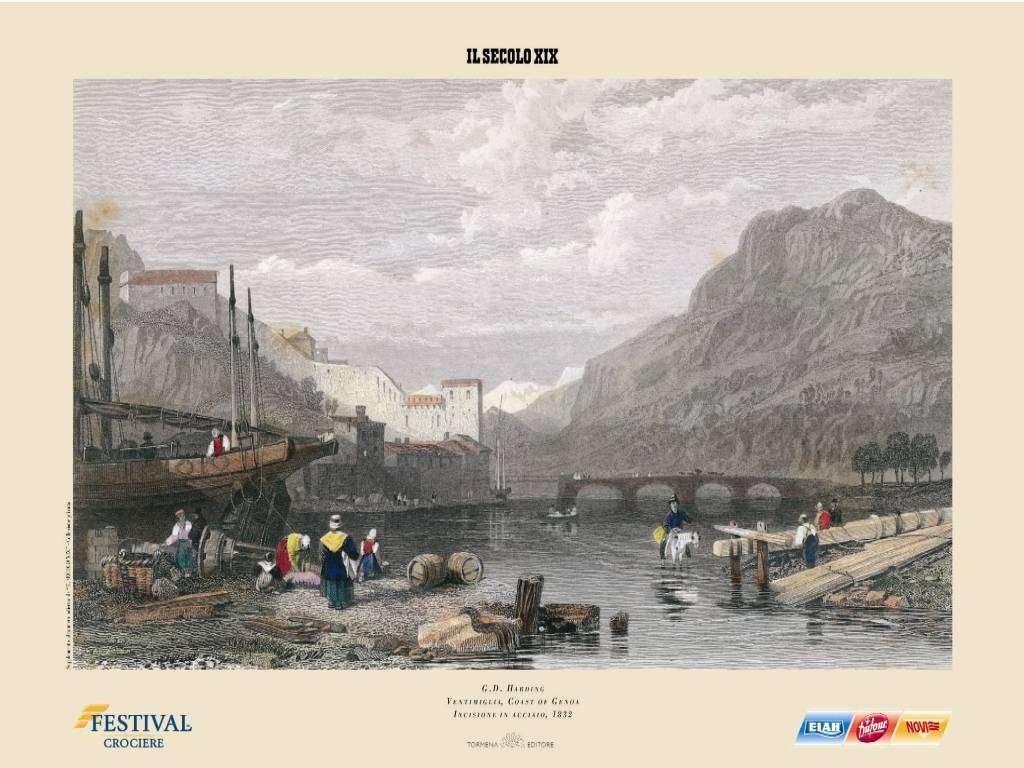
 Les Guala, de Verceil à Nice
Les Guala, de Verceil à Nice
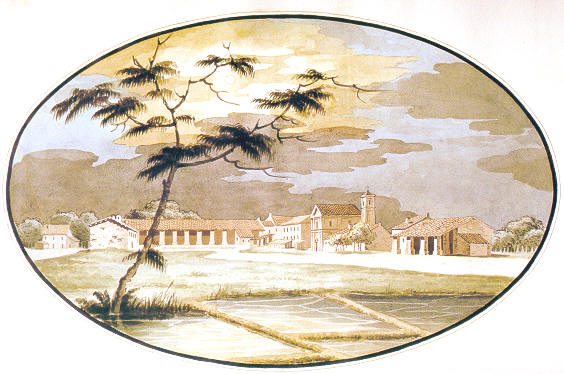

 À
l'issue de la guerre de 1792-1796 (Première coalition), les États-Sardes continentaux
sont totalement désarmés (et le Comté de Nice et la Savoie sont
annexés à la France).
À
l'issue de la guerre de 1792-1796 (Première coalition), les États-Sardes continentaux
sont totalement désarmés (et le Comté de Nice et la Savoie sont
annexés à la France).  À Nice, paroisse
Saint-Jacques
À Nice, paroisse
Saint-Jacques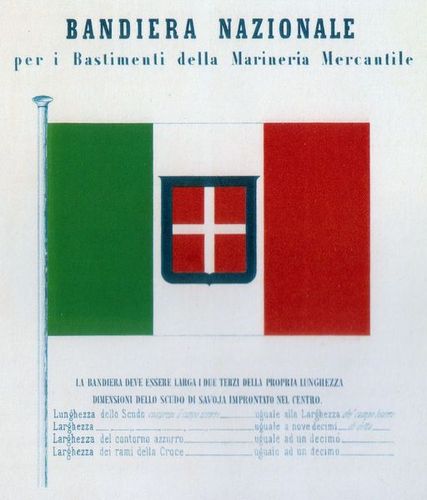
 Anna Maria Guala naît
le 21 juillet 1849. C'est
leur deuxième fille.
Anna Maria Guala naît
le 21 juillet 1849. C'est
leur deuxième fille. 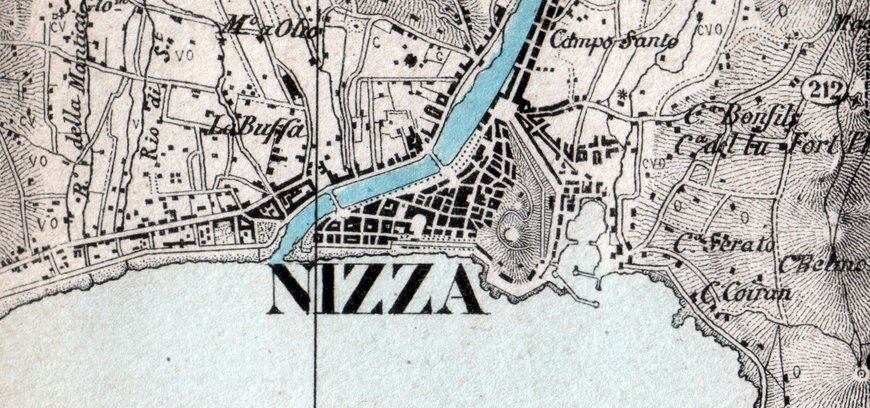
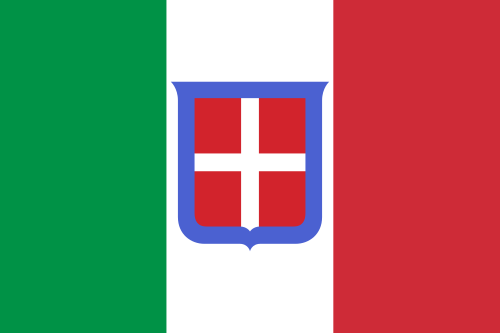
 Détail de la carte d'état-major des États-Sardes
des années 1850.
Détail de la carte d'état-major des États-Sardes
des années 1850. En 1882, les Blanchet
traversent l'Atlantique et débarquent à New York.
En 1882, les Blanchet
traversent l'Atlantique et débarquent à New York.