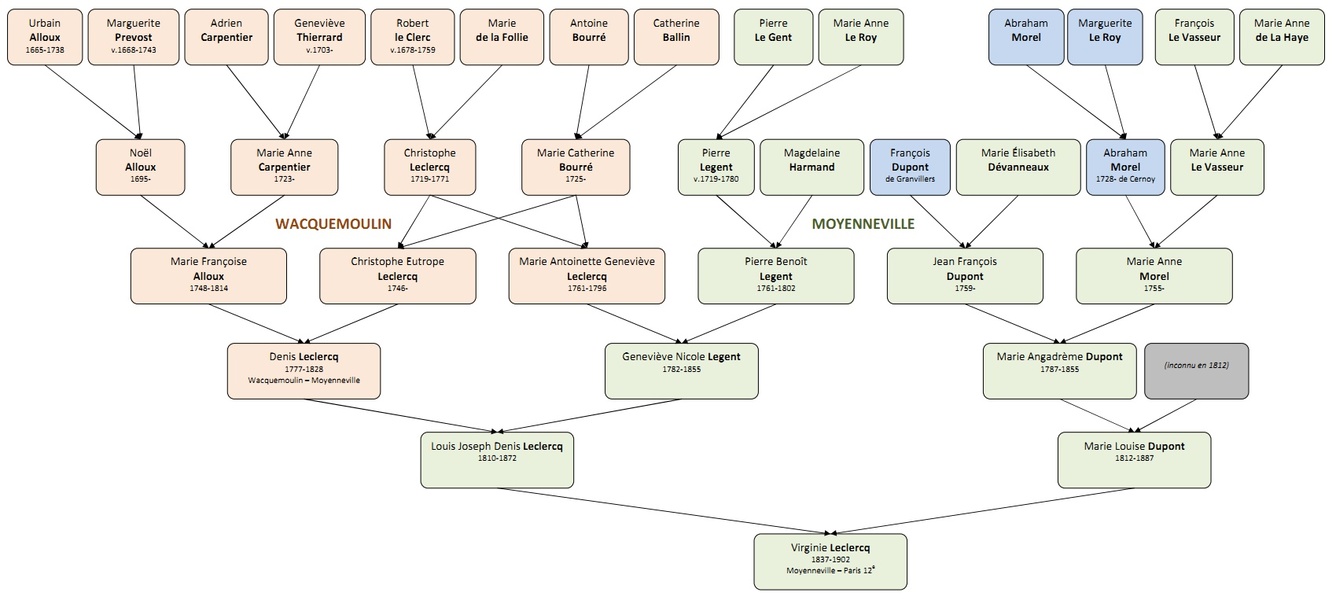Le Clerc et Le Gent en
Beauvaisis

Les familles de cette page sont concentrées sur les paroisses de Wacquemoulin et de Moyenneville, sur le
cours de la rivière Aronde, qui se jette dans l'Oise en rive
droite juste avant Compiègne.
C'est une région de plaine, lieu de passage depuis l'Antiquité.
À l'époque romaine, la voie de Nanteuil-le-Haudouin à Montdidier
passait par Estrée-Saint-Denis, Moyenneville,
Wacquemoulin, Menévillers, Tricot, etc.
Au XVIIe siècle, tout cela
se trouve dans la partie orientale du Beauvaisis (diocèse de
Beauvais), sous l'autorité coutumière de Montdidier en Picardie
(généralité d'Amiens), à proximité du Valois (Compiègne).
Détail
d'une carte du Beauvaisis en 1632 : Wacquemoulin et Moyenneville
en bleu
(ainsi que d'autres villages dont sont originaires certaines
personnes de la page), La Folie en rouge.
Dans le sens des aiguilles d'une
montre, la région est circonscrite par Beauvais, Montdidier,
Compiègne, Creil.
Wacquemoulin
C'est à Wacquemoulin que les individus de l'arbre généalogique sont
le plus nombreux.
Dans la première moitié du XVIIe siècle, Jacques et Louise Alloux
y ont trois enfants, notamment Léonard,
né vers 1621.
À cette époque, la région est secouée par la guerre de Trente Ans
(entre 1618 et 1648), qui se prolongera avec une guerre
franco-espagnole (notamment entre France et Pays-Bas)
jusqu'à 1659.
En octobre 1655, Léonard Alloux épouse Charlotte Delys (née vers 1632).
Leur fils Urbain naît en octobre 1665.
 Au sein du diocèse de Beauvais, les
communes de Wacquemoulin (paroisse Saint-Christophe) et de Moyenneville (paroisse
St-Martin-Ste-Geneviève) sont rattachées au bailliage (ou élection) de Montdidier
(pays de Santerre), dans la généralité
d'Amiens (province de
Picardie). Le reste du Beauvaisis relève plutôt de la
généralité de Paris, voire de celle de Soissons (province
d'île-de-France).
Au sein du diocèse de Beauvais, les
communes de Wacquemoulin (paroisse Saint-Christophe) et de Moyenneville (paroisse
St-Martin-Ste-Geneviève) sont rattachées au bailliage (ou élection) de Montdidier
(pays de Santerre), dans la généralité
d'Amiens (province de
Picardie). Le reste du Beauvaisis relève plutôt de la
généralité de Paris, voire de celle de Soissons (province
d'île-de-France).
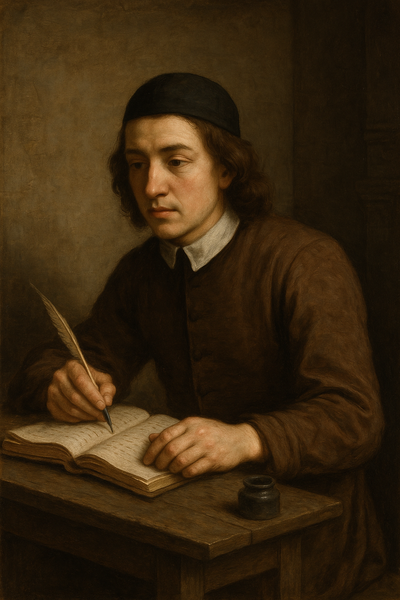
À partir de septembre 1682
(et jusqu'à sa mort), Urbain
Alloux est le clerc
de la paroisse (Saint-Christophe).
Auxiliaire du curé et du vicaire, le clerc participe à toutes les
cérémonies du culte, services quotidiens, messes dominicales,
baptêmes, mariages, sépultures, fêtes et processions, et participe à
la tenue des registres d'état civil.
Assisté du bedeau et des enfants de chœur placés sous son autorité,
il sonne les cloches et remonte l'horloge, participe au
nettoyage et à la décoration de l'église.
Le cas échéant, il est aussi chargé d'entretenir le parterre et
le jardin du curé, moyennant salaire.
Il peut aussi effectuer des travaux d'écriture ou de
mesurage pour les paysans, confectionner des registres pour les
commerçants, etc. Il se peut aussi qu'il ait rempli la fonction
de maître d'école.
[Ci-contre : portrait imaginaire d'Urbain Alloux en 1682.]
En 1689, Urbain
épouse Marguerite Prevost
(née vers 1668).
Leurs enfants : Léonard
en 1690 (il mourra dès 1724) ; Marie Maryse en 1692
; Noël en 1695 ; Urbain
en 1701 (il mourra dès 1730)...
Entre-temps, les parents d'Urbain meurent dans les années 1690 :
Charlotte en 1692
et Léonard en 1695.
En août 1692, mariage
de Pierre Thierard et
de Catherine Roussel. Lui
est originaire de Saint-Martin-aux-Bois,
elle de Méry.
Ils ont de nombreux enfants entre 1693 et 1707, notamment Geneviève en août 1703.

Robert Le Clerc
(né vers 1678)
et son épouse Marie de
La Folie sont laboureurs
à Wacquemoulin.
La Folie est
le nom d'un fief des environs (d'où la famille était sans
doute originaire au XVIe siècle) [aujourd'hui, c'est
une parcelle totalement cultivée, sans aucune trace de
bâtiment (à part un pylône électrique)].
Parmi leurs enfants, mentionnons Robert (né en mars 1709, son
parrain étant François de la Folie), Christophe en 1719, Geneviève
et Victoire (morte en juin 1735).
Adrien Carpentier
et Geneviève Thierard
se marient en 1722.
Ils sont manouvriers.
Enfin, les hommes de la famille Bourré
sont maréchaux-ferrants.
C'est le cas d'Antoine,
marié avec Catherine
Ballin vers le début des années 1720.
|
Moyenneville

Pierre Le Gent
et Marie Anne
née Le Roy sont les
parents de Pierre François
Le Gent, né vers 1719 à Moyenneville.
|
|
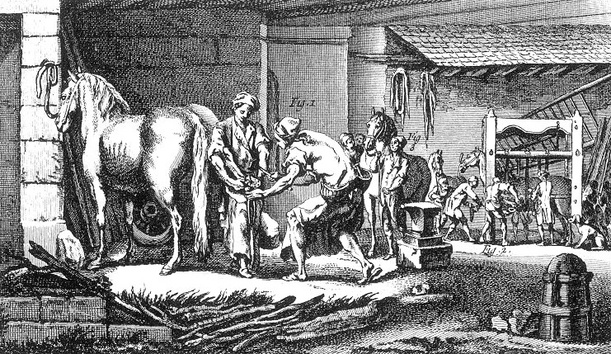
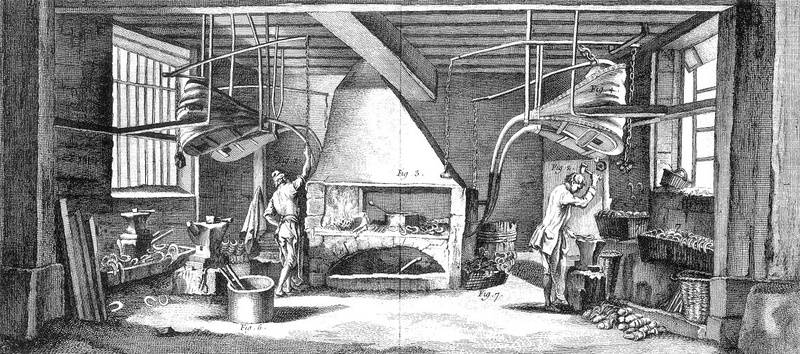
Le maréchal-ferrant dans
l'Encyclopédie.
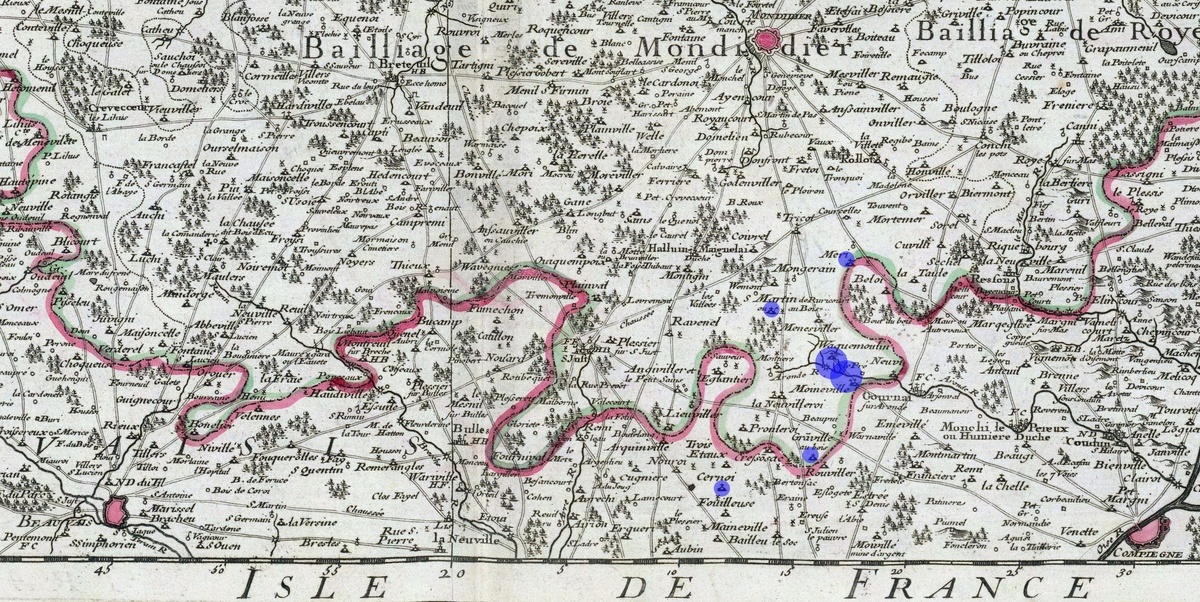
Une position flottante entre
Picardie et Île-de-France
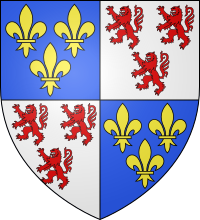  
|
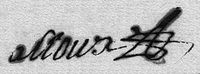 Au début des années
1740, Noël Alloux
est greffier
des fiefs d'Arnel
et de Passy-lès-Moyenneville. Au début des années
1740, Noël Alloux
est greffier
des fiefs d'Arnel
et de Passy-lès-Moyenneville.
En règle générale, le tribunal seigneurial se
compose de trois personnes : le juge
(ou prévôt, bailli, sénéchal,
vice-gérant, viguier) prononce la sentence ; le
procureur fiscal représente le ministère public et engage
les poursuites ; le greffier transcrit les jugements et
tient les archives de la justice.
Telle est donc la fonction de Noël dans ces deux seigneuries
situées sur les territoires de Wacquemoulin et Moyenneville.
Son père Urbain meurt en juin 1738, et sa mère Marguerite en mai 1743.
En novembre 1744,
il épouse Marie
Anne Carpentier,
fille d'Adrien et de Geneviève née Thierard.
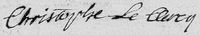 Christophe Le Clercq,
fils de Robert le Clerc et de Marie de La Folie, Christophe Le Clercq,
fils de Robert le Clerc et de Marie de La Folie,
est laboureur
et marchand.
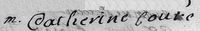 Le 20 juillet 1745, il
épouse Marie Catherine
Bourré (née en novembre
1725), fille du maréchal de forge Antoine
Bourré et de Catherine Ballin. Le 20 juillet 1745, il
épouse Marie Catherine
Bourré (née en novembre
1725), fille du maréchal de forge Antoine
Bourré et de Catherine Ballin.
|
Pierre Legent, tailleur d'habits né
vers 1719,
épouse Magdelaine
Symphorose Harmand.
Ils vont avoir au moins deux fils : Charlemagne (en 1756) et Benoît (en 1761).
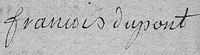 À la même
époque, François Dupont
(originaire de Grandvillers) épouse Marie Élisabeth Dévanneaux.
Tous deux sont veufs d'un premier mariage. À la même
époque, François Dupont
(originaire de Grandvillers) épouse Marie Élisabeth Dévanneaux.
Tous deux sont veufs d'un premier mariage.
Enfin, Abraham Morel
(né en 1728 à Cernoy, fils d'Abraham et de Marguerite née Le Roy) épouse Marie Anne Le
Vasseur (fille de François et de Marie Anne née de La Haye).
[Juridiquement, Cernoy dépend de Beauvais.]
Ils sont manouvriers.
|

La carte de Cassini
ci-dessus (1750) met en évidence notamment les villages
de Wacquemoulin et Moyenneville sur l'Aronde,
la route Paris-Lille, et les villes de Montdidier, Saint-Just et Compiègne.
|
Enfants de Christophe et Catherine Leclercq : Christophe Eutrope en avril 1746, Cyr
Jean Baptiste, Marie Marguerite Laurence en
juillet 1757, Marie
Antoinette Geneviève en mai 1761.
Le grand-père Robert le Clerc meurt en janvier 1759.
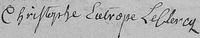 Laboureur et marchand
comme son père, Christophe
Eutrope Leclercq épouse Marie Françoise
Alloux (fille de Noël et de
Marie Anne née en 1748). Laboureur et marchand
comme son père, Christophe
Eutrope Leclercq épouse Marie Françoise
Alloux (fille de Noël et de
Marie Anne née en 1748).
|
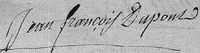 Jean-François Dupont,
fils de François et de Marie Élisabeth, est tisserand en toile
(manouvrier comme ses parents). En 1781, il épouse Marie Anne Morel
(fille d'Abraham et de Marie Anne). Jean-François Dupont,
fils de François et de Marie Élisabeth, est tisserand en toile
(manouvrier comme ses parents). En 1781, il épouse Marie Anne Morel
(fille d'Abraham et de Marie Anne).
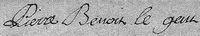 Benoît Legent
devient tailleur
comme son père (qui meurt en août 1780), mais aussi cultivateur. Benoît Legent
devient tailleur
comme son père (qui meurt en août 1780), mais aussi cultivateur.
En février 1782,
il épouse 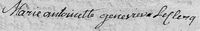 Marie Antoinette
Leclercq, fille d'un laboureur du
village de Wacquemoulin (voir ci-contre ; elle est la soeur
de Christophe Eutrope). Marie Antoinette
Leclercq, fille d'un laboureur du
village de Wacquemoulin (voir ci-contre ; elle est la soeur
de Christophe Eutrope).
L'épouse s'établit dans le village de son mari.
|
Fils de Christophe Eutrope Leclercq et de Marie
Françoise, Denis Leclercq est né en mars 1777.
Il devient marchand et manouvrier.
|
Geneviève Legent
(née en 1782)
Marie Angadrème Dupont, fille
de Jean François Dupont et de Marie Anne Morel, naît en 1787.
|
 Révolution française et
Empire à Moyenneville
Révolution française et
Empire à Moyenneville
En 1790, création du département de l'Oise.
À la Révolution, les frères Legent sont devenus cabaretiers. En 1793, Benoît et sa famille
habitent rue de la Place.
Marie Antoinette Geneviève meurt en mars 1796.
Mort de Benoît Legent en juin 1802.
À Wacquemoulin, Denis Leclercq
a épousé Marie Antoinette Geneviève Diu, mais elle meurt dès juillet 1804 (le 19 messidor de
l'an XII).
Il se remarie en janvier 1805
(le 3 pluviôse de l'an XIII), avec sa cousine germaine Geneviève Nicole Legent (comme
on l'a vu ci-dessus, leurs parents Christophe Eutrope Leclerc et
Marie Antoinette Geneviève Legent née Leclerc sont frère et sœur).
Leur fils Louis Joseph Denis
Leclercq naît en 1810.
Marie Angadrème Dupont a
un enfant d'un inconnu en mars
1812 : Louise Geneviève
Dupont.
En 1814, on voit
passer les armées napoléoniennes, notamment les Russes et les
Prussiens qui marchent sur Paris. Certains soldats quitteront leur
armée et resteront dans les villages.
À
Wacquemoulin, en 1814, Christophe Eutrope et Marie Françoise
résident rue des Fontaines. Cette dernière meurt au mois de
janvier.
 Restauration des
Bourbon
Restauration des
Bourbon
À la Restauration, en octobre 1817,
la fille-mère Marie Angadrème Dupont épouse un certain "Frédéric Redivonne",
un déserteur polonais demeurant à Rouvillers (canton de
Saint-Just-en-Chaussée, également dans l'Oise). Il est né
en 1792 à "Draguenau" dans le palatinat de Połock,
sur la Dvina, en Pologne russe (aujourd'hui en Biélorussie).
Deux grandes batailles s'y sont déroulé en 1812 dans le cadre de la
campagne de Napoléon en Russie. Il devait donc faire partie des
effectifs qui ont repoussé les Français jusqu'à Paris en 1814.
Mort de Denis Leclercq en 1828.
 Régime constitutionnel
Régime constitutionnel
En avril 1831, après la
mort du père, toute la famille est à la charge du charretier
Jean-Baptiste Carlier (*1804 ; avec sa femme Maxance Opportune,
*1909, et leur file Joseph Louis Prospère, *1827) : la veuve
Geneviève Nicole Legent, *1781, ménagère ; Marie Geneviève Legent,
*1807, domestique ; Louis Joseph Denis, *1810, manouvrier ; Marie
Julie Leclercq, *1814 ; Frédéric Pierre Thomas Leclercq, *1817). À
Moyenneville, on dénombre alors 432 habitants dans 112 maisons. 209
savent lire et écrire, 29 seulement lire.
Le 21 mari 1831 :
Mariage entre Louis Joseph
Leclercq et Louise
Geneviève Dupont, tous deux travailleurs
journaliers.
Virginie Leclercq.
Née en 1837.
Elle sera gantière puis domestique.
1855 : décès de Geneviève Legent et de Marie Angadrème Dupont (veuve
Redivonne).
Le 26 juin 1858, Virginie Leclercq épouse Léopold
D'haenens, un immigré belge qui réside alors à Estrées-Saint-Denis, rue du Lion-Noir.
Manouvrier, il travaille comme charretier.
Virginie donne naissance à un fils, Gustave Édouard "d'Hauenens", le 27
août 1859 (à Estrées-Saint-Denis). Il est de nationalité
belge, comme son père.
Puis Virginie et Léopold s'établissent à Moyenneville, rue
Qui-Branle (à côté des parents de Virginie).
À Moyenneville, naissance de deux autres garçons : Paul Raymond
d'Hauenens, le 30 juin 1862 ; Octave Alfred d'Hauenens, le 16
décembre 1864.
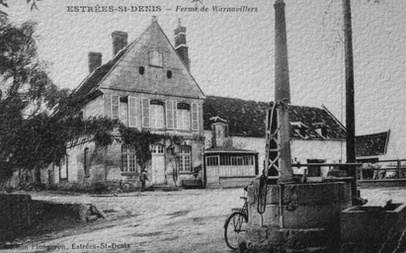

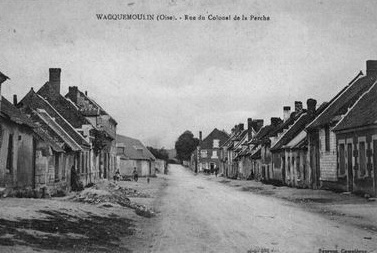
Estrées-Saint-Denis,
Moyenneville et Wacquemoulin.
Guerre franco-prussienne
Le 17 juillet 1870, la France déclare la guerre à la
Prusse. La population est appelée à verser des impôts
exceptionnels.
La guerre se passe très mal, et Napoléon III capitule à Sedan dès
le 2 septembre. Le 4,
l'Assemblée Nationale destitue Napoléon III et proclame la Troisième République.
 Le
13 septembre, les troupes allemandes entrent dans le
département de l'Oise et atteignent Compiègne en milieu
d'après-midi.
Le
13 septembre, les troupes allemandes entrent dans le
département de l'Oise et atteignent Compiègne en milieu
d'après-midi.
Paris est assiégée. Le 7 octobre,
le ministre de l'Intérieur Léon Gambetta quitte la capitale en
ballon dans l'intention de se réfugier à Tours. Touché par des
balles prussiennes, il est contraint d'atterrir dans l'Oise (à
Épineuse).
Le 19 novembre, la
première armée prussienne forte de 40 000 hommes arrive dans
l'Oise.

Réquisitions
prussiennes dans les fermes (par Louis Ulysse Souplet).
Le 26 décembre, les
Allemand destituent le préfet nommé par Gambetta et le remplacent
par le baron von Schwartzkoppen.
Le 18 janvier 1871, à
Versailles, le roi de Prusse Guillaume Ier proclame l'Empire
allemand
Le 19 janvier, victoire
allemande à Saint-Quentin.
Le 28 janvier, signature d'un armistice entre le
gouvernement provisoire de la Troisième République et les
Allemands.
Des élections législatives ont lieu le 8 février. À Paris, Louis Blanc arrive en tête,
suivi de Victor Hugo, Léon Gambetta et Joseph Garibaldi.
L’Assemblée nationale se réunit à Bordeaux le 13 février. Jules Grévy est
porté à la présidence de l'Assemblée et Adolphe Thiers est élu
chef du gouvernement.
Le 13 février, les troupes d'occupation réclament une contribution
de guerre de 11 millions de francs au Conseil général de l'Oise
(les Allemands refusent d'abord de négocier et retiennent
prisonniers les membres du Conseil, qui seront finalement libérés
le 24 février contre versement de 2 millions de francs).
26 février : signature d'un second armistice à Versailles.
Le 18 mars 1871 : une insurrection éclate à Montmartre.
Construction de barricades.
Les Prussiens craignant que des troubles éclatent dans l'Oise comme
à Paris, toutes les villes ouvrières du département sont placées
sous étroite surveillance.
Le 30 mars, le drapeau
rouge de la Commune flotte sur l'hôtel de ville et sur tous les
monuments publics de Paris.
Dans l'Oise, la deuxième quinzaine d'avril est marquée par un
important reflux de Parisiens fuyant la capitale.
Le Traité de Francfort, qui met fin à la guerre franco-allemande,
est signé le 10 mai.
21-28 mai : semaine sanglante à Paris. Les troupes de
Versailles entrent par l'ouest, franchissent les barricades et
massacrent les insurgés.
La capitale est ravagée par les incendies. Derniers combats
sporadiques début juin, puis l'ordre se rétablit et la
reconstruction commence.
Au cours de cette période de troubles, après la naissance des trois
fils (entre 1866 et 1872), Virginie
et Léopold s'en vont à Paris.
Louis Joseph Denis Leclercq meurt à Moyenneville en 1872.
La liaison ferroviaire avec Amiens (via Montdidier) et
avec Compiègne (via Estrées-Saint-Denis), décidée en 1875,
n'ouvrira qu'en 1883, avec des gares à Estrées-Saint-Denis,
Moyenneville et Wacquemoulin.
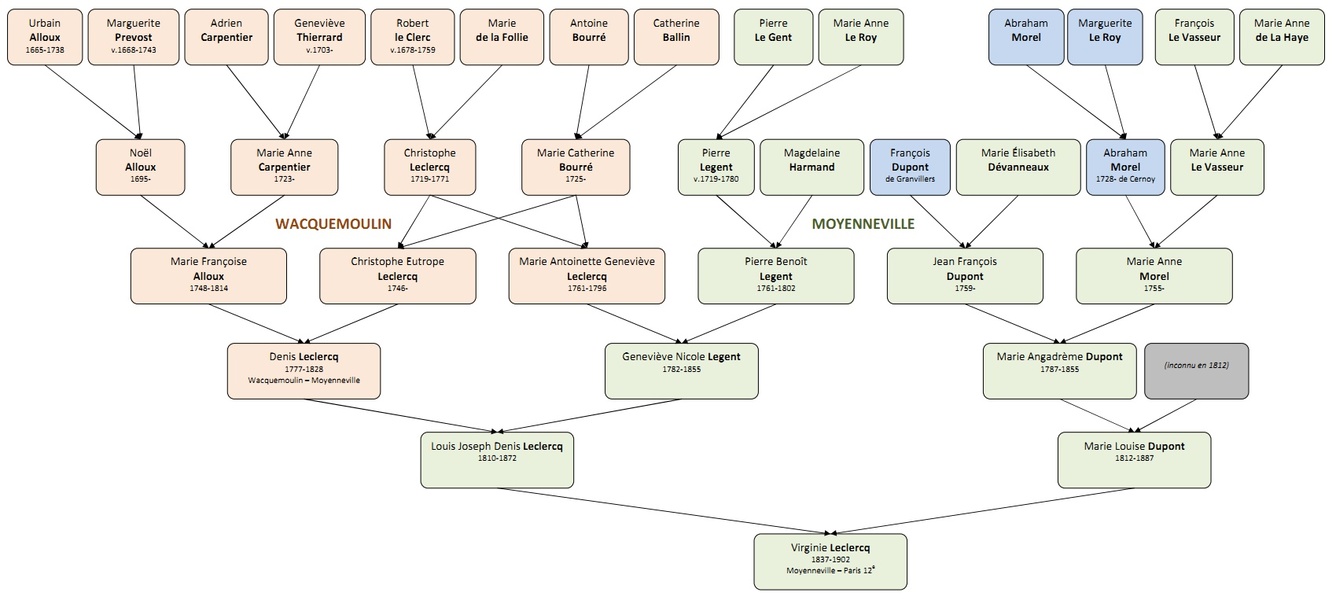 Cet arbre récapitule
l'ascendance de Virginie Leclercq à Wacquemoulin (en brun) et
Moyenneville (en vert) depuis le XVIIe siècle.
Cet arbre récapitule
l'ascendance de Virginie Leclercq à Wacquemoulin (en brun) et
Moyenneville (en vert) depuis le XVIIe siècle.
Sources
Archives départementales de l'Oise
M. Graves, "Essai sur les voies romaines du département de
l'Oise", in M. de Caumont (éd.), Bulletin monumental, tome 6, 1840.


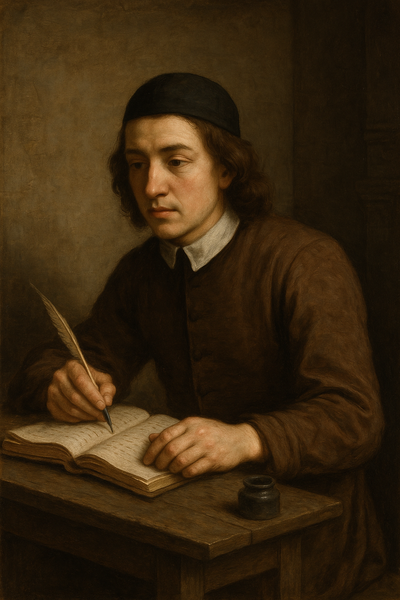


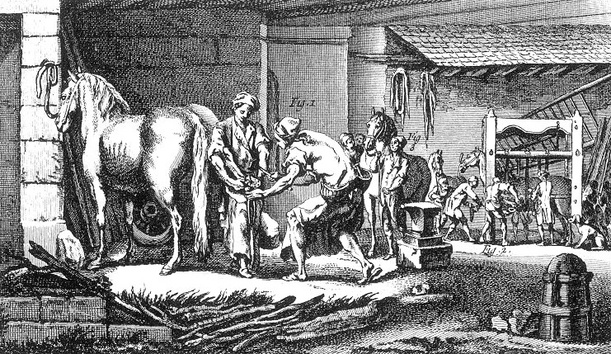
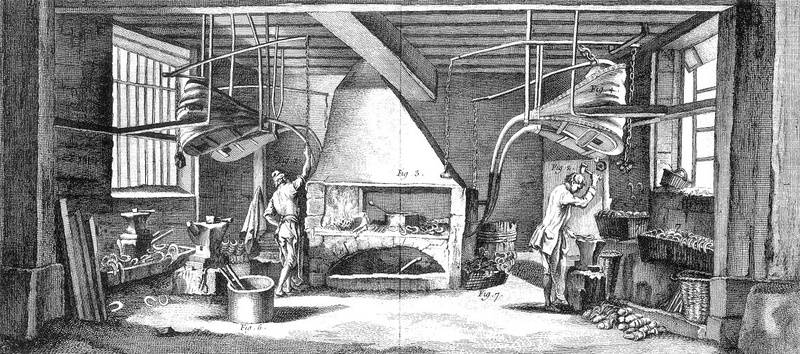
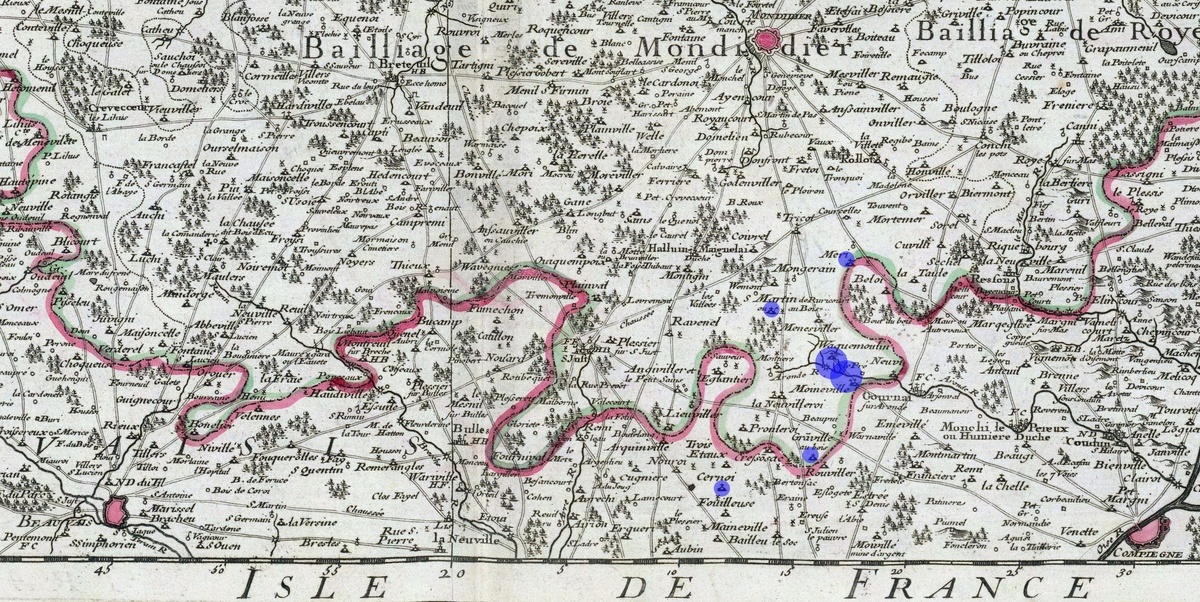
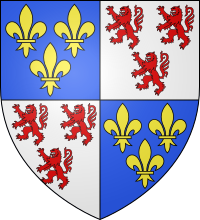


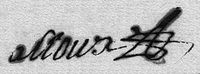 Au début des années
1740,
Au début des années
1740, 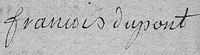 À la même
époque,
À la même
époque, 
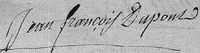
 Révolution française et
Empire à
Révolution française et
Empire à  Restauration des
Bourbon
Restauration des
Bourbon 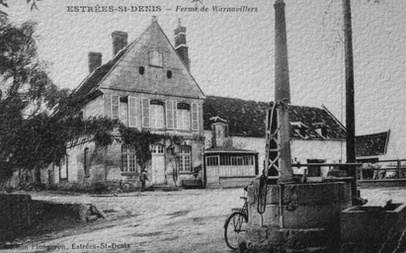

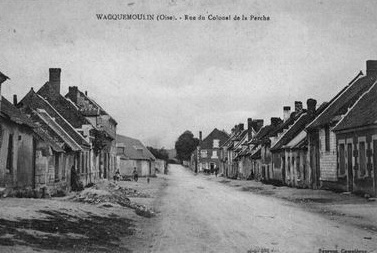
 Le
13 septembre, les troupes allemandes entrent dans le
département de l'Oise et atteignent Compiègne en milieu
d'après-midi.
Le
13 septembre, les troupes allemandes entrent dans le
département de l'Oise et atteignent Compiègne en milieu
d'après-midi.