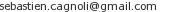II
Bruno est mort
Son nom est maintenant gravé en lettres d’or sur une plaque de marbre blanc apposée au mur de la salle des fêtes de notre école, sous ce vers merveilleux que chaque garçon — même dans les petites classes — savait réciter par cœur, bien que dans notre école on n’étudiât pas le latin :
« Dulce et decorum est pro patria mori. »
Il était mon ami. Et je ne crois pas que je trouverai jamais sur ce globe tournant un ami qui remplirait sa place.
Il y a un peu plus d’un an, j’ai été hospitalisé pendant plusieurs mois. J’étais moralement effondré, ma conscience avait déraillé. La laideur de la vie, le mépris de soi, le désespoir plus sinistrement condensé d’année en année et bien d’autres démons m’avaient traqué dans ces derniers refuges qu’on appelle confusion mentale. Et encore, je devais quand même vivre dans une perpétuelle guerre de position avec d’effroyables ombres imaginaires ; mes journées étaient comme des rêves de troll. À la fin j’étais de plus en plus exténué. Je me rappelle m'être plongé un jour dans le poème de Mikael Lybeck « Han med lien » (La faucheuse), où la Mort vient en ami chez un homme qui attend. Mon esprit rassembla alors toute la force qui restait pour appeler la Mort à son secours. Il n’avait plus rien à attendre de la vie ici-bas, où tout était souffrance et horreur ; la Mort lui aurait été libératrice. C’était alors le printemps, et un soupçon de la paisible lumière du soir restait encore dans la chambre qui s’obscurcissait. Soudain, sur le mur brun lambrissé dont les taches plus sombres ou plus claires, et même les différentes branches étaient pour mon regard, après des semaines d’examen, d’une familiarité exaspérante, je vis… un visage. Un grand visage vivant qui se dessinait clairement. C’était le sien, celui de mon ami disparu, Bruno. Avec les traits familiers de son noble profil, la forme fière et assurée de sa tête — cet occiput fortement développé, ce front haut et net, le nez plein de vie, un peu sinueux, la bouche grave, résolue et traduisant cependant la bonté de l’esprit.
Le visage de mon ami m’apporta une étrange quiétude et un moment de sécurité. Il brillait d’une tranquillité, d’une sublimité et d’une douceur plus grandes que j’aie jamais vu sur un visage vivant, — une tranquillité qui a bien fini son cours, le calme d’un être qui a atteint la mort, une tranquillité scellée, divine, comme on en voit quelquefois sur le visage d’un héros tombé. Je regardai ce visage comme avec joie et espoir, il semblait apparaître du pays de la mort, comme un vœu de bienvenue, comme la promesse d’une vie plus belle, qui ne laissât pas de place à la peur.
La nuit suivante fut la première, de tout mon séjour à l’hôpital, où je ne fis pas de cauchemars.
Et le soir suivant, à la même heure, je vis encore le visage. Il était déjà sur le mur à attendre, quand je tournai la tête pour le chercher. Tel que je l’aimais, — un visage brumeux, mais vivant, beau, majestueusement calme. Il y apparut de soir en soir, et toujours il m’apportait un don de joie et de paix. Mon esprit s’affaira à récolter en lieu sûr jusqu’au moindre soupçon de souvenir de notre amitié au fil de la vie ; il le fit avec ferveur, comme recueillant de précieux trésors. Ces jours-là se produisit dans le cours de ma maladie la première amélioration. Ces jours-là, également, je me fis un saint de mon ami Bruno, dont l’image, en tant qu’archétype de la merveilleuse sublimité de la jeunesse, que symbole de vigueur virile, rayonnante de beauté temporelle et intemporelle, a irréversiblement imprégné mon âme en profondeur.
C’est pourquoi j’ai l’impression, en parlant de Bruno, d’écrire une hagiographie contemporaine. C’est pourquoi je vois à la lumière du sublime même les petits incidents de sa vie, jusqu’au dernier que ma mémoire peut retrouver. C’est comme si la vie, à dessein, l’eût choisi, équipé et envoyé pour un voyage plus pur et un destin plus noble que les autres êtres que j’ai connus.
Aux collège et lycée, Bruno était mon camarade de classe, et je le tenais en estime depuis les petites classes, où il était toujours et en tout juste, droit et bon — autrement dit tel que nous, les copains, le considérions alors en un mot : loyal. Sa modération ne l’empêchait pas d’être travailleur, voire si nécessaire — par exemple dans une bataille de boules de neige ou un match de football — tout à fait énergique. Au contraire, son visage ouvert, radieux et son souple corps juvénile rayonnaient de cette joie de vivre particulièrement saine qui rend déjà presque virils certains qui sont encore manifestement des enfants et ne manque pas de leur procurer le respect des copains de leur âge. Mais mon véritable attachement, il ne le gagna qu’en sixième, par un certain acte, un exploit, à la fois enfantin et viril.
Il y avait un froid hivernal qui pénétrait dans les os et la moelle. À la première pause du matin, on remarqua que dans un coin de l’école, sur l’entretoise d’un poteau téléphonique, un chat était pelotonné. « Il est là depuis la nuit », annonça quelqu’un. « Les chiens l’ont chassé là-haut, et il n’ose pas redescendre. — Filons-lui une rafale, il descendra », réfléchit un autre. Plusieurs boules de neige tombèrent en trombe vers le chat ; l’une fit mouche, le pauvret miaula misérablement, manquant de tomber. On décida : « Il s’est complètement engourdi — il n’est pas capable de bouger comme il faut. — Une salve, les gars, ça marchera ! » suggéra un futur juriste. Alors on entendit un « Non » strict, d’une voix profonde, qui fit s’arrêter les bras et se tourner les têtes vers l’objecteur. C’était Bruno, qui arrêté un peu à l’écart suivait la scène depuis un moment. Sans ajouter un mot, grave et résolu, il alla au pied du poteau et — se mit à escalader. Il se mit à escalader le poteau téléphonique. Ce n’était pas facile, le poteau était glissant et le gel saisissant, les jambes avaient tendance à déraper et les mains devenaient rouges de froid. Plusieurs garçons rirent, quelqu’un fit une plaisanterie bienveillante. Mais Bruno était souple et tenace, il ne cessa de progresser, et s’introduisit bientôt à travers les fils givrés. S’étant élevé jusqu’au barreau inférieur, il parvint à saisir le chat. Celui-ci se défendit, effarouché, en sifflant et en griffant. Bruno le logea sur son épaule. Il mordait et égratignait, l’oreille, la joue. Le sauveur le retint fermement d’une main par le cou et descendit en s’aidant de l’autre, apportant malgré tout le miauleur avec lui. À la fenêtre de la maison voisine était apparu une femme souriant amicalement ; Bruno lui tendit le chat.
Tel fut l’acte héroïque. Moi, qui enfant m’étais bagarré avec mes cousins pour la vie de jeunes moineaux et avais pleuré un écureuil abattu qui mordillait ma main dans les convulsions de son agonie, j’admirai Bruno à partir de cet instant. Il avait osé montrer la bonté de son cœur, et qui plus est sous les yeux d’un groupe de garçons en train de mal devenir des hommes — et cela, c’était héroïque.
Vint la guerre de libération. Bruno était de ces lycéens qui furent incorporés quand les hommes adultes quittèrent la ville pour quelques communes plus au nord où l’on constituait des troupes blanches. Bruno était aussi parmi ces hommes qui les premiers marchèrent sur la ville tandis que les rouges se retiraient. Moi, garde de cave, j’admirai son uniforme de bure mal taillé, son fier maintien de soldat, la saine couleur de son visage, la jonction grave et résolue de ses lèvres, la force tranquille de son regard, raffermi dans les expériences de la guerre. Les camarades disaient : « Bruno, ça c’est un gars ! » Ou : « Bruno, c’est un homme. Il n’a pas peur. » Et on me racontait toutes sortes de choses — comment Bruno avait sauvé sous une pluie de balles tel ou tel blessé — comment Bruno avait lancé ici ou là une grenade à main dans un nid de mitrailleuse, — et comment Bruno, en mission de reconnaissance, avait anéanti une patrouille rouge… Bruno, quant à lui, était le plus discret de tous les garçons.
Un an passa. Les journaux parlèrent des affrontements de l’expédition d’Aunus[1]. À la pause, au lycée, on en parla. Chez les camarades, quand nous nous voyions le soir, de même. Un après-midi de printemps, Bruno et moi nous trouvâmes en même temps à la salle de lecture municipale ; cette fois il n’y avait personne d’autre. Nous lûmes les journaux qui venaient d’arriver, nous lûmes, nous dévorâmes. Des comptes-rendus de combats. Le front sud qui avançait… un corps de troupes constitué principalement de lycéens qui se distinguait… les noms des blessés et des morts… le reportage d’un correspondant…
Je ne sais lequel de nous deux le dit le premier. Mais quelqu’un le dit : « Allons-y. — Allons-y », répondit l’autre. Un regard. Une poignée de mains. Je ne me rappelle pas avoir éprouvé rien de plus grand et de plus simple.
Vint la veille du départ. Nous n’étions pas allés à l’école. Le proviseur était au courant, Lasse, le frère aîné de Bruno, avait décidé de venir avec nous, le commandant local de la garde civique nous avait donné un papier, et le professeur de finnois chenu au front formidable nous avait souhaité la bénédiction de Dieu par trois fois, pour finir avec des larmes aux yeux. Le soir devait être organisé une fête d’adieu, avec tous les garçons de la classe. Cet après-midi-là, Bruno vint chez moi étrangement calme. Il resta assis un instant en silence, la tête appuyée sur la main. Soudain il dit d’une voix profonde et solennelle : « Uuno, à présent je ne partirais pas, si je ne te l’avais promis. » Je fus évidemment étonné. Il me regarda dans les yeux, longtemps, d’un regard triste, merveilleusement scintillant, et ajouta doucement : « À cause de ma mère. » Comme il n’expliquait pas davantage, je dis : « Bruno, la promesse ne doit pas te lier. Moi j’y vais, mais tu peux très bien rester. Je te comprends, crois-moi. » Il secoua la tête. « Non, non, dit-il énergiquement, il faut que je parte, je ne peux pas ne pas partir… puisque j’ai promis. »
Ce n'est qu'au petit matin que je compris complètement le changement d’humeur de Bruno. Sa mère, sa jolie mère au visage gracieux et aux cheveux gris me parla passionnément, les yeux éplorés : « Non, ne partez pas ! Bruno a déjà été par deux fois en danger de mort… je le savais et cependant j’étais tranquille. À présent j’ai peur… Si maintenant vous partez, je ne verrai plus jamais Bruno. Ne partez pas ! Si vous ne partez pas, alors je pourrai garder Bruno… mais si vous partez, Bruno aussi partira. Ne partez pas, vous, ne partez pas ! Bruno est mon fils chéri… »
Aujourd’hui, je voudrais avoir été assez brave, à l’aube de ce jour-là, pour céder à la prière d’un cœur de mère noble, aimant, clairvoyant. C’eût été alors un sacrifice, aux yeux des camarades peut-être même une humiliation, mais tout cela eût été peu. Si je m’étais fâché, — peut-être, peut-être Bruno vivrait-il… Que savons-nous des instants décisifs de la vie, que savons-nous du destin ?
Embrassades d’adieu et larmes. La mère de Bruno m’embrassa aussi ; c’est émouvant d’y repenser — à présent. On nous couvrit de fleurs, les filles de l’école normale étaient venues nous accompagner avec des brassées de fleurs, dans la voiture et même sur la route des fleurs étaient lancées. Bruno était grave, pâle et grave, Lasse serein et souriant, moi joyeux. Et voici que même le vieux professeur de finnois était revenu dire au revoir une dernière fois, bien que l’horloge du clocher n’indiquât pas encore six heures… Ce départ était une fête. Et c’était un printemps précoce, les bords de la route blanchis d’anémones.
Sortavala[2]. L’engagement. Le manoir de Munkinhovi. Les manœuvres. Le bateau pour Salmi[3]. La marche au pas le long d’une grand-route de sable flasque submergeant jusqu’aux chevilles. La frontière. Aunus[4].
Aunus.
D’interminables trajets en forêt, beaucoup de marais, des rivières et leurs rapides, des lacs poétiques. De mauvais chemins, de mauvaises voitures, des chevaux squelettiques. D’avares lopins de terre, de petites vaches hirsutes. Les maisons en un seul bloc, comme si elles cherchaient à se protéger les unes des autres, les maisons monotones. Les portes de l’étable et du séjour sur le même palier. Des samovars, des icônes, des cafards. Un peuple au sang clair et à l’esprit chatoyant, facilement enflammé mais peu obstiné, ardent dans la joie, inconsolable dans le chagrin ; un peuple enfantin. Les bouches bavardes pleines d'un babil qui fait d'abord un son bizarre pour des oreilles finlandaises. Des danses populaires de dimanche soir dans la grand-rue du village, des corps plantureux de jeunes filles, des chansons nostalgiques. Des nuées de moustiques. Le rougeoiement des églantiers dans les prés et les aulnaies. — Aunus.
Par nos longues marches de jour, Bruno prenait soin par tous les moyens des camarades de régiment les plus faibles et inexpérimentés, peut-être le plus grand soin pour moi, bien que je fusse un peu plus âgé que lui-même. « Attache le sac à dos de telle ou telle manière, comme ça il paraîtra plus léger ! » « Porte les fusils comme ci ou comme ça, — la lanière ensuite ne fera pas si mal à la poitrine. » Ou : « Il vaut mieux marcher au pas comme ci et comme ça ; c’est moins fatigant. » Et quand nous nous reposions : « Ne t’assieds pas comme ça, étends-toi sur le côté, ainsi tu auras moins mal entre les cuisses en marchant. »
À Prääsä[5], quelque grand village avant le front, on passa les troupes en revue. Un officier supérieur prit la parole. « Nous ne sommes pas partis dans cette expédition en envahisseurs avides, pour étendre les limites territoriales de la Finlande, dit-il. Ceci est une croisade en faveur de la culture ; nous souhaitons déplacer la frontière culturelle de l’Occident jusqu’au lac Onega et au Svir[6]. » Mais le soir un autre officier parla à notre compagnie : « Les gars, demain vous serez envoyés au front. Vous savez que nous sommes ici pour déplacer la frontière finlandaise vers l’Onéga et le Svir — — —. » Bruno, mon voisin, me regarda, un fin sourire à la commissure des lèvres. « Ne sommes-nous pas venus au secours des opprimés ? » chuchota-t-il.
En route pour le front, il avait été plus silencieux qu’auparavant à l’école. Dans les lieux de repos j’avais parfois remarqué qu’il restait à regarder fixement par la fenêtre, avec dans la position de sa tête et dans tout son être quelque chose de triste et de résigné. Une fois, inconsciemment, il soupira tout bas, ou peut-être l’imaginai-je seulement ; en chaque occurrence je revoyais alors cette même image que j’avais souvent vue dans mon esprit : les yeux larmoyants de la jolie mère, les bras étreignant désespérément, la noble tête du père, digne et tremblotante, la pâleur de Bruno et le frémissement de ses lèvres…
Mais dès le premier jour au front, dans le village de Matrosy[7] — ou plutôt ce n’était qu’une ferme, une vieille bicoque, une boîte à sardines en guise d’hébergement pour la compagnie entière — Bruno sembla relever la tête avec insouciance, comme s’il eût grandi. Nous autres — en tout cas la plupart — étions plus graves que d’ordinaire, en proie à cette étrange joyeuse humeur que le front suscite toujours au début. L’atmosphère du front est imprégnée de fatalité, pleine d’imprévu, pleine de péril ; elle fait battre le cœur à nouveau. Mais rien ne semblait déranger l’assurance et la tranquillité d’esprit de Bruno.
La nuit, nous partîmes en patrouille, le chef d’une autre section, Bruno et moi, et peut-être une dizaine d’autres garçons. Ce que nous avions à faire était d’essayer de capturer les éclaireurs ennemis. Nous fîmes quelques détours dans la forêt, et à la fin le chef nous rassembla autour de lui pour donner ses ordres. Nous devions nous déployer en un cordon clairsemé, couchés au sol complètement hors de vue, et attendre l’ennemi. Je trouvai des broussailles adéquates ; Bruno continua son chemin plus avant pour prendre place à l’extrémité du cordon. J’avais l’intention d’aller m’allonger, quand je me retrouvai hors de moi d’indécision. Je ne puis plus comprendre aujourd’hui comment c’était arrivé, mais toujours est-il que j’avais complètement perdu conscience, aussi incroyable que cela puisse paraître, de la direction dans laquelle était l’ennemi ! Je ne suis pas du tout courageux, mais je n’eus pourtant pas vraiment peur cette nuit-là, peut-être bien que ce tournis résultait de la seule excitation. Que faire ? Il ne convenait pas d’hésiter. Je partis donc me faufiler dans la direction où Bruno avait disparu. Soudain il surgit devant moi, du sol, de derrière un arbre écroulé, debout, tout près de moi ; je ne l’avais pas remarqué. « Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-il. — Écoute, Bruno, dis-moi, par quel côté, je veux dire — — — par quel côté nous sommes venus », balbutiai-je tout penaud. Il me regarda bouche bée, étonné, mais bientôt il se mit à rire, d’un gentil rire bienveillant ; je devais être vraiment cocasse, en me tenant là profondément honteux. « Par ici, dit-il en montrant de la tête, et les rouges viennent de là sous la colline, si tant est qu’ils viennent. » Bizarrement, je n’avais plus honte ; son rire ne pouvait être mal pris ; il était jovial et libérateur. Par la suite, il ne toucha pas un mot de mon affaire, pas même par plaisanterie, et j’eus l’impression qu’il me traitait le lendemain plus cordialement qu’auparavant. S’il y avait eu à sa place quelqu’un d’autre — —
Cette nuit-là, on ne vit point l’ennemi. Mais un autre jour notre double patrouille tomba dans un guet-apens de l’ennemi, et l’un des garçons manqua à l’appel. Plus tard, on fit dans la forêt une horrible découverte. Un corps mutilé, défiguré, dont on avait manifestement tailladé des lambeaux de chair à la baïonnette. À côté, l’emplacement d’un feu de camp et autour, de la chair grillée au bout de baguettes de bois noircies, tout à fait comme les reliefs d’un repas inachevé. « Cannibales ! tonnèrent les garçons. Ces démons mangent les hommes, peut-être même vivants ! — Ou ils les donnent à manger aux chiens ! » — Bruno était assis sur un banc, tout pâle, les lèvres jointes. « À présent j’aurais envie de me battre », dit-il sourdement. Et il se mit à nettoyer son fusil.
Et bientôt nous eûmes à nous battre. Notre premier affrontement fut le plus grand du front nord, la prise de Polovina[8]. Là aussi Bruno était mon voisin ; cela me procura une sorte de refuge, de savoir qu’il évoluait près de là, à portée de voix. Je vis ses ruées longues et rapides. Je courus à côté de lui en criant hourra en haut d’un coteau dégagé en pente douce du sommet duquel l’ennemi tirait son feu. Je le rencontrai dans une tranchée conquise ; alors que je me précipitai sur la housse de la mitrailleuse, Bruno y était déjà. « Hé, comment ça va ? cria-t-il en riant. Ici tout est clair. Un homme mort et une machine hors d’usage. Ç’aurait été marrant d’ajouter là un post-scriptum ! » Et il bondit hors de la tranchée. « Viens ! »
Plus tard je le vis dans plusieurs affrontements. Il n’avait jamais bravé la mort avec arrogance comme le faisaient certains, qui tiraient principalement debout, mais il ne semblait pas non plus avoir peur du danger. Il était rapide et néanmoins modéré dans toutes ses tâches ; il était un combattant très sobre ; il n’avait nul geste excessif, nul désir d’attirer l’attention, ce qui chez les soldats est si souvent la meilleure incitation à se distinguer personnellement ; toute sa conduite au combat, en revanche, le distinguait par son calme permanent. Il était décidément un combattant-né, il était l’héritier des vertus d’un ancienne race de guerriers.
Bruno était de ceux que la mort semble guetter avec une attention particulière pour à la fin en faire sa proie. Toujours, quand des hommes étaient désignés pour des essais périlleux ou exigeant du génie et de la ténacité, Bruno devait s’y joindre. La patrouille à laquelle Bruno appartenait s’acquittait rarement sans échange de coup de feu. Dans les affrontements il se retrouvait presque toujours à l’endroit le plus délicat. On finissait par plaisanter : « C’est le tour de garde de Bruno. Le popov va encore se mettre à tirer. » Ou, quand une grenade était tombée à deux trois mètres de lui, derrière une grosse pierre : « Bruno, tu ferais un bon paratonnerre. » Mais Bruno n’acceptait pas de parler de lui ; il feignait de ne pas entendre, vaquait à ses occupations, se mettait à parler d’autre chose ou quittait le groupe.
Je ne raconterai pas ces petits événements qui jalonnèrent l’expédition. Il m’est plus cher de me rappeler d’autres circonstances où se révélèrent la virilité, la pureté et la beauté profondes du caractère de Bruno.
C’était le jour de la Saint-Jean. Il pleuvait à torrents. Nous étions en faction au bord d’une petite rivière, depuis trois jours sans répit en plein air. Nous n’avions pas un fil de sec ; nous maudissions le froid, l’ennemi, la fatigue, la faim et toute autre misère, nous attendions en claquant des dents le moment où la relève finirait par arriver. Le seul qui ne tremblait pas, ne jurait pas, qui prononçait au contraire des remarques bienveillantes, c’était Bruno. Et pourtant il devait être plus fatigué que personne d’autre, puisque de son propre chef il était allé sur la rive opposée enlever une barque qui à son avis n’était pas du tout un truc à laisser de ce côté-là du fleuve, à la disposition des éclaireurs rouges, — et avait dû revenir sous une pluie de balles, en plongeant et en nageant, le bateau ayant échoué de lui-même sur notre rive. Quand enfin l’après-midi nous avions regagné le village, séché nos vêtements à la chaleur du fourneau du lieu d’hébergement, dévoré notre ration de fête — un merveilleux riz au lait vraiment blanc ! — et étendu nos membres au repos, qui sur un banc, qui sur le sol, il s’établit dans la pièce un dialogue bizarre ; les garçons se mirent carrément à disputer à qui pourrait raconter l’histoire la plus « cochonne » ; c’était presque de l’hystérie, une sorte de contrecoup des efforts endurés ; en aucun cas je n’ai entendu de ma vie plus obscène papotage. Puis vint une petite pause, et Bruno, qui jusque là n’avait pas pipé mot, dit alors : « Pense un peu, Lasse, comme il serait bon d’être maintenant à la maison. Là-bas il y a les bouleaux de la Saint-Jean et… comme tu sais. On doit un peu leur manquer, à eux aussi. » Pas besoin de plus, l’ambiance s’était purifiée, on se mit à parler de ses proches, les lèvres qui à l’instant proféraient des grossièretés firent entendre des paroles sensibles, on pêcha dans les sacs à dos des plumes et du papier à lettre… Et ce ne fut pas la seule fois où Bruno purifiât l’air ; il le faisait souvent. Et il est impossible de dire s’il le faisait sciemment ou par un instinct naturel de pudeur. Jamais il ne regardait de haut en montrant du doigt, ne critiquait personne, ne cherchait à donner des leçons ; il donnait seulement aux pensées une nouvelle direction, c’est tout, et il le faisait comme fortuitement. Sans noblesse de personnalité on ne peut rien de pareil.
Et nos commérages dans la queue de la cantine. Surtout dans la queue de la cantine, justement. Beaucoup de garçons étaient carrément des diables pour se moquer quand ça n’allait pas, et de ce qui se disait alors n’émanait point le plus grand respect et la plus chaleureuse gratitude à l’égard de l’expédition ni envers notre cuisinier crasseux et grassouillet. De cette manière : « Amène les masques à gaz, avant qu’on ouvre la marmite. » « Ils l’ont déterrée du marais, cette vieille charogne de cheval. — Te plains pas, là dedans y a aussi de la viande de ver toute fraîche. » Ou s’il y avait de la mauvaise bouillie de seigle plusieurs jours de suite : « Grand merci, ça descend plus, je suis rassasié de sciure. » Et si les pains de blé étaient complètement bigarrés de moisissure et, quand on les brisait, projetaient en l’air une partie de leurs entrailles : « Ils nous font encore bouffer cet arc-en-ciel. », ou : « Les gars, vous avez déjà vu des pains volants ? » Jamais Bruno, même incidemment, ne prit par à ces blagues et moqueries. Un jour, il me dit même : « Dans beaucoup de fermes, les habitants souffrent de la faim. Tu aurais vu ce pain d’avoine que j’ai goûté aujourd’hui ! » Bruno pouvait-il se plaindre d’une manière si peu virile des circonstances où la guerre nous mettait, une fois que nous étions partis à la guerre de notre plein gré ? Se serait-il expliqué avec quelles immenses difficultés notre ravitaillement pouvait être effectué ? Quand je pense à n’importe quel moment au cours de l’expédition jusqu’à ce jour misérable où commença le repli du front nord, — Bruno y est toujours présent de quelque manière, et le plus souvent d’une manière dont le souvenir réchauffe le cœur. Lorsque lui et Lasse reçurent de chez eux un paquet, Bruno sut par sa conduite me faire oublier que toutes ces merveilles, en réalité, ne m’étaient pas du tout destinées. Nous nous régalâmes à trois, et cela se passait à une époque où pour un morceau de sucre on offrait cinq marks et pour une cigarette jusqu’à dix marks. C’était de la camaraderie. Ensemble, nous allâmes aussi discuter avec les fermières, et nous mangeâmes des repas fabuleux ; le cher lecteur peut deviner que, par exemple, une omelette qu’on payait cent marks finlandais savait aussi avoir bon goût dans une bouche affamée. Et affamés, nous l’étions ; beaucoup de nous ne déféquaient quotidiennement rien d’autre que du sang.
Toutes sortes d’autres souvenirs. Nos examens de poux, nos saunas de poux[9]… Les astiquages de fusil, les graissages de bottes… Et une fois que du blanc luisait au fond de nos pantalons en quantité un peu trop anti-militaire, nous nous mettions à faire les tailleurs ; on empruntait le tissu de rapiéçage aux jambes du pantalon…
Une fois, dans le village de Vidany-le-Bas[10], l’ennemi attaqua au milieu de notre plus doux sommeil. Nous étions arrivés dans la maison d’un cordonnier, et encore au moment de l’alerte il y avait à l’intérieur de l’une de mes bottes un embauchoir ajusté. Le cordonnier s’était enfui. Mes bottes étaient déjà trop petites, il était presque impossible de les mettre aux pieds. Et les mitrailleuses retentissaient déjà. Alors Bruno trouva un moyen. « Essaye de mettre l’autre au pied, dit-il. Pour celle-ci nous ferons comme ça. » Et il noua l’autre botte avec son embauchoir aux lanières de mon sac à dos. Et elle y pendit le temps du combat.
C’était un soir au bord du Suoju[11]. Bruno et moi venions d’être libérés de notre tour au poste d’écoute. Avant d’aller au plumard, nous restâmes un moment assis sur une pierre, à fumer et à regarder le cheminement du brouillard au-dessus des champs. Puis Bruno dit : « Écoute, je dois passer le rattrapage en composition. Il faut que j’écrive ici au moins quatre rédactions. Tu veux bien m’aider ? » Dites-vous que Bruno était le meilleur homme de la compagnie, soldat de pied en cap, je l’admirais, tous l’admiraient — et le voilà assis le cœur lourd à cause d’un rattrapage de composition ! J’avalai des larmes, quand je saisis sa main. Le monde de l’école et de la maison avec ses devoirs, tout cela était si lointain et effacé, et cependant si proche, cher et attachant. Nous n’étions pas deux soldats, à ce moment-là, mais deux lycéens, entre amis.
La prise de Petroskoi[12], le grand objectif vers lequel la conversation se tournait continuellement (avec des hypothèses diverses), s’était révélée difficile à réaliser. On avait attaqué et dû rebrousser chemin la tête en sang ; Suolusmäki[13], la plus sûre serrure de la ville, était trop fortement armée, et à chaque endroit l’ennemi avait la supériorité du nombre. Des semaines passèrent, nous n’arrivions pas à avancer.
Puis vint une rumeur. Elle s’insinua dans nos troupes de quelque part, de quelque manière, en secret, délicatement. Elle relevait la tête au milieu des foules en conciliabule. L’encadrement essaya de la tuer. Mais elle ne se tut pas. Elle grandissait de jour en jour, elle avait plusieurs têtes, elle devenait un monstre, un fantôme, dont tout le monde sentait la présence, dont tout le monde tremblait. C’était la rumeur de l’effondrement du front sud. C’était aussi la rumeur selon laquelle l’ennemi était en train d’avancer rapidement depuis le sud dans notre dos, pour nous couper la route vers la Finlande.
Ces jours-là, tout ou partie de notre compagnie montait la garde au bord d’une petite rivière dont je ne me rappelle plus le nom. Le service était lourd, les équipements doubles, de nourriture il n’y avait guère que le nom, il pleuvait et nos cabanes de pin étaient précaires. Misérables journées.
J’étais de garde depuis deux ou trois heures, écoutant le grondement du canon, le sifflement et le grincement des obus, le fracas des arbres et comptant les engins non éclatés. La canonnade était redoutable ; chaque grenade semblait venir droit vers l’auditeur… Alors Bruno passa par mon lieu de garde en compagnie d’un autre garçon. « Vous allez où ? — À la patrouille. — Les popovs sont virulents, aujourd’hui. — Ils vont sans doute passer à l’attaque. Salut ! — Salut ! » Et il longea la rive vers le nord, pour rejoindre de là la patrouille venant de Vidany[14]. Dans l’air sifflaient toujours les grenades, vers nous et au-dessus de nos têtes en direction du village de Vidany. Au nord on entendit aussi un coup de fusil. C’était étrange. Bruno… Bruno… est-ce que Bruno — ? Après un long, long moment, le camarade de patrouille de Bruno revint en courant. Il me cria en passant : « Les popovs ont traversé ! Ils étaient en cordon autour du pré. Ils nous ont laissé aller dans le pré, et puis ils se sont mis à tirer. Bruno est resté… »
On ne peut décrire cet instant. On ne peut décrire ce jour. À mon retour de la garde, tous, tous se lamentaient. Lasse pleurait dans la cabane de pin, il sanglotait : « Pourquoi juste Bruno… pourquoi juste Bruno… pourquoi le meilleur gars de notre famille… que les parents… aimaient le plus… pourquoi pas moi, pourquoi ?… Et si Bruno n’était pas mort… mais blessé… alors ils vont… le torturer… » Seigneur Dieu ! Je restai assis bien des heures tout à fait apathique. Je voyais les yeux et les mains de sa jolie mère… Je ne pouvais pas penser, je n’avais pas la force, je ne savais penser autre chose que : Bruno est mort, Bruno est mort.
Le soir, après que j’eus passé des heures à mon tour de garde au delà du temps convenu, le commandant de section arriva sur la berge. « Tous les hommes sur la route ! dit-il. On ne relève pas la garde. » Étrange ! Qu’était-il arrivé ? Est-ce que la rumeur — ?
Oui, la rumeur avait dit vrai. Au bout d’une demi-heure déjà la rivière disparut derrière nous. La retraite commença. Chacun savait que le front sud s’était effondré, que l’expédition avait échoué et que de surcroît l’ennemi faisait de son mieux pour nous cerner. Il tombait de la bruine, j’étais épuisé à mort, le sac à dos pesait, le fusil pesait, je titubais comme en rêve. Quelqu’un dit qu’une patrouille avait été envoyée chercher Bruno, mais qu’elle était revenue bredouille. Chaque pas nous emportait plus loin de ce lieu où son destin avait été scellé. Et tout était vain. La route était trempée par la pluie, une bouillie d’argile débordait à chaque pas à travers mes orteils ; dans la journée, j’avais laissé mes bottes au train, mes pieds souffrant trop des ampoules, et le train était parti devant. L’argile éclaboussait, clapotait sous les pieds, éclaboussait. Et le cerveau n’était capable que d’une seule pensée : Bruno est mort, Bruno est mort. —
 [1]
En
1919,
peu
après la proclamation de l’indépendance, une
armée finlandaise se
constitue pour tenter d’annexer la Carélie orientale.
Depuis
1812, la frontière
partage le Ladoga et l’isthme de Carélie en deux parties
à peu près égales.
L’objectif de l’expédition est de la repousser vers
l’est, pour
conquérir
notamment la région située entre les lacs Ladoga et
Onéga.
[1]
En
1919,
peu
après la proclamation de l’indépendance, une
armée finlandaise se
constitue pour tenter d’annexer la Carélie orientale.
Depuis
1812, la frontière
partage le Ladoga et l’isthme de Carélie en deux parties
à peu près égales.
L’objectif de l’expédition est de la repousser vers
l’est, pour
conquérir
notamment la région située entre les lacs Ladoga et
Onéga.
[2] Sortavala : ville carélienne sur la rive septentrionale du Ladoga, dans le territoire finlandais qui sera rattaché à l’Union soviétique en 1944. Avant 1918, les Russes appelaient cette ville Serdobol (Сердоболь).
[3] Salmi (Салми) : à mi-chemin entre Sortavala et Aunus.
[4] Aunus : en russe, Olonets (Олонец).
[5] Pryazha (Пряжа, Prjaža), à mi-chemin entre Aunus et Petroskoi. Au lieu d’employer le nom finnois (Prääsä), Kailas se contente ici de fenniser le nom russe.
[6] Svir (en finnois : Syväri) : fleuve qui déverse le lac Onéga dans le Ladoga.
[7] Kailas fennise ici un nom russe, probablement Matrosy (Матросы).
[8] Polovina : Половина.
[9] Cabane dans laquelle on désinfectait les draps de lits à la vapeur.
[10] Sur la rivière Shuya, au nord de la route qui mène de Matrosy à Petroskoi. En russe : Nizhniye Vidany (Нижние Виданы). En finnois : Ala-Viitana.
[11] Fleuve tributaire du lac Onéga. En finnois : Suoju. En russe : Shuya (Шуя). En carélien : Šuoju.
[12] Petroskoi, au bord du lac Onéga, vers l’embouchure de la rivière Shuya. En russe : Petrozavodsk (Петрозаводск). C’est actuellement la capitale de la république de Carélie.
[13] Le village de Suolusmäki (ou Sulagora) est devenu aujourd’hui un quartier de Petroskoi.
[14] Sur la rivière Shuya, en amont (un peu à l’ouest) de Vidany-le-Bas (Nizhniye Vidany, Нижние Виданы), se trouve le village de Vidany-le-Haut (Vyerkhniye Vidany, Верхние Виданы).