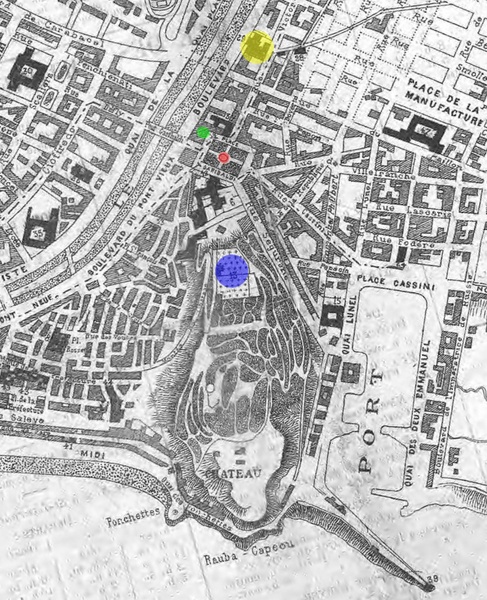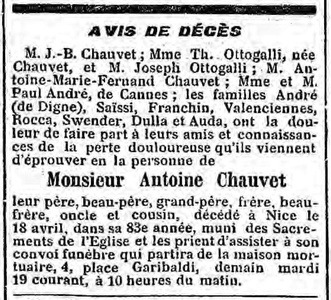Familles bourgeoises d'Aix-en-Provence


Provence catalane
Entre 1112 et 1245, les rois
d'Aragon de la Maison de
Barcelone régnaient sur le comté de Provence.
En 1245, le comté passe aux mains de la Maison d'Anjou.
 Provence
angevine
Provence
angevine
Au XIVe siècle, la famille Eyguesier est attestée à
partir de Pierre Eyguesier du Puyloubier,
au pied de la Sainte-Victoire. Ils sont alors éleveurs de bétail.
Dans les années 1370, un certain Gautier Burle,
sujet anglais, vient s'établir en la ville d'Aix.

En 1486, la Provence se sépare du Saint-Empire pour intégrer
le Royaume de France (sous Louis XI).
En 1615, un Sauvaire Burle né à Vauvenargues se marie à Aix avec une
demoiselle originaire de Seyne.
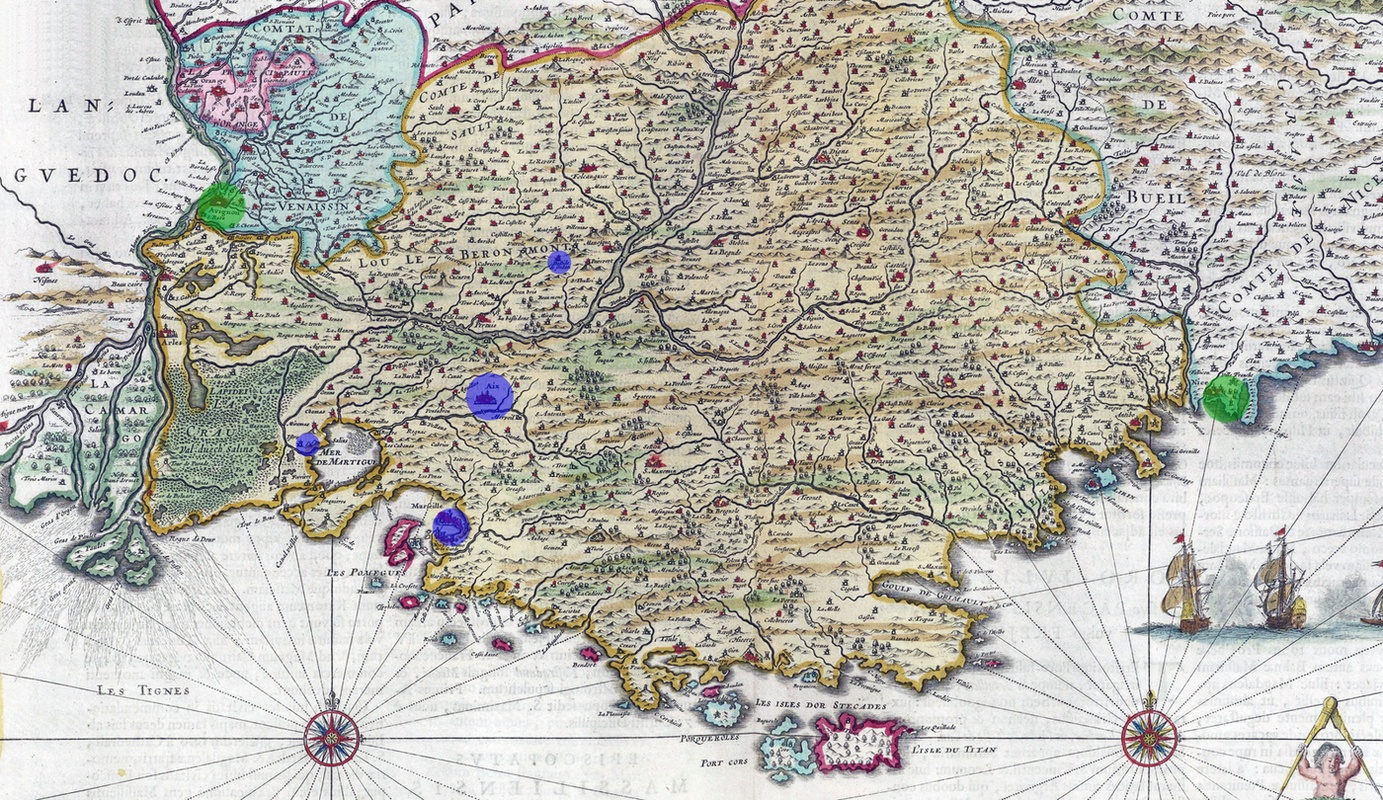
La Provence dans les
années 1660 (en jaune), entourée par le Languedoc, le Comtat
Venaissin (avec Avignon en vert), le Dauphiné au nord, et le
Comté de Nice à l'est (États de Savoie, avec Nice en vert).
En septembre 1672, au Saint-Esprit, un Honoré
Eyguesier, fils de Pierre et de Louise Roman,
épouse une Claude Giraud :
Né l'année suivante, leur fils Pierre deviendra
travailleur et épousera en juillet 1698 une Marguerite
Garcin visiblement originaire de Champtercier,
en haute Provence (en tout cas, c'est là que le mariage est
célébré).
Quant à leur fille Thérèse, en 1719, elle épouse
en sa paroisse cathédrale de Saint-Sauveur un homme d'une autre
famille bourgeoise de la cité : le maître tailleur Joseph Sauvet,
déjà âgé de 46 ans. Elle en a 26.
Charles Burle, fils de Sauvaire, s'est marié en 1696 à
Saint-Sauveur :
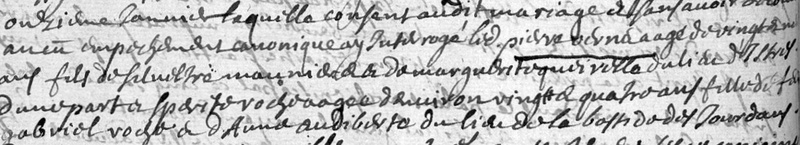
Sa fille Madeleine épousera en 1732 un François
Vernet, issu d'une famille bourgeoise d'Aix avec des
origines à Istres (étang de Berre,
petit point bleu ci-dessus) et à La Bastide des Jourdans (sur le versant du
Lubéron, au nord de la Durance, petit point bleu ci-dessus).
Il n'est pas exclu que ces
Vernet soient vaguement apparentés à la famille des peintres,
qui descendent d'un Claude Vernet né au Puy en Velay vers
1634 et marié à Avignon en 1664.
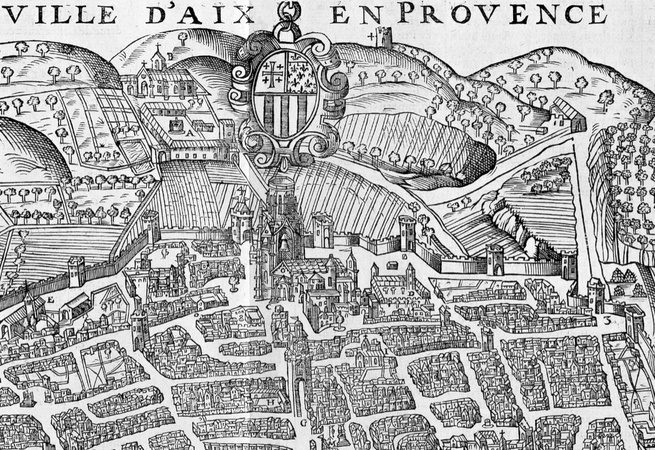
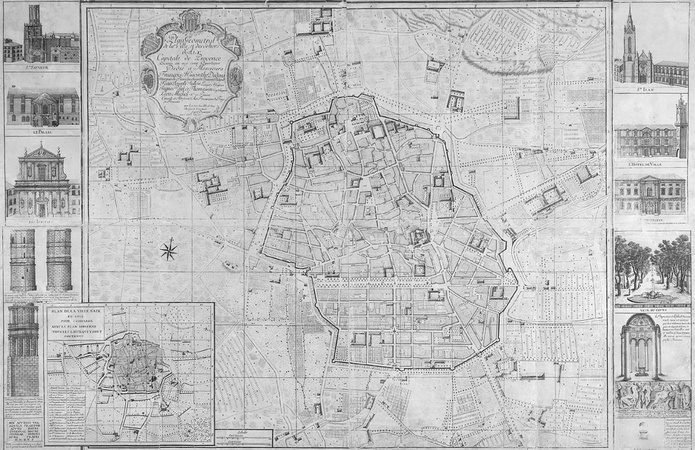
Deux représentations d'Aix à
l'époque. Les Sauvet résident alors dans le cœur historique
de la ville, paroisse cathédrale Saint-Sauveur.
Les Sauvet
entre Provence, Nice et Gênes
 Dans les années 1750, leur fils Pierre Sauvet
est à son tour maître tailleur à Aix. [À droite : portrait
imaginaire vers 1770.]
Dans les années 1750, leur fils Pierre Sauvet
est à son tour maître tailleur à Aix. [À droite : portrait
imaginaire vers 1770.]
En novembre 1758, il épouse Rose Vernet (fille de François)
en la cathédrale Saint-Sauveur.
Leur fils Barthélemy Antoine Sauvet naît peu après, vers 1759.
 L'atelier du tailleur dans l'Encyclopédie.
L'atelier du tailleur dans l'Encyclopédie.
Vers 1786, pour une raison
mystérieuse, Barthélemy quitte Aix, la Provence et la France.
Il a environ 27 ans.
Sans doute embarque-t-il à Marseille.
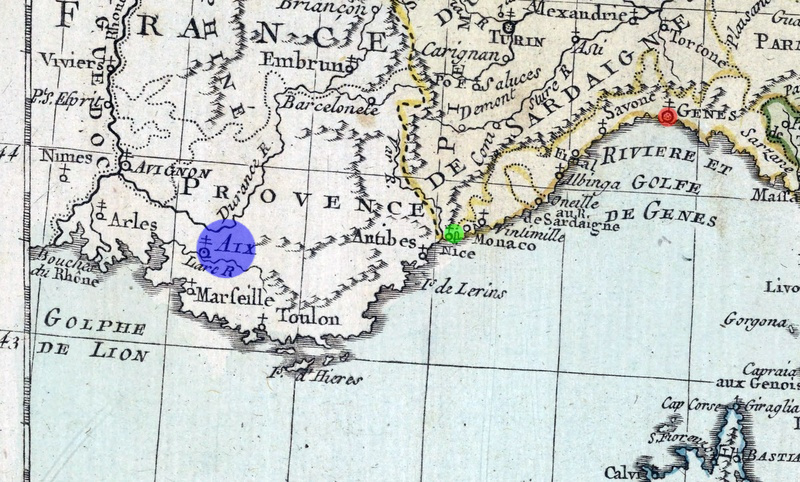 Du golfe du Lion à celui de
Gênes : Aix en bleu, Nice en vert et Gênes en rouge.
Du golfe du Lion à celui de
Gênes : Aix en bleu, Nice en vert et Gênes en rouge.

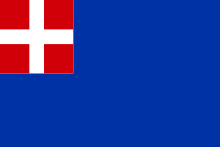 Comté
de
Nice
Comté
de
Nice
C'est ainsi que Barthélemy Sauvet s'établit à Nice (Royaume de Sardaigne), où il
exerce le métier de tailleur.
Sauvet étant un nom étranger, l'orthographe va poser pas mal de
problèmes dans les registres d'état civil. Dès lors, on va
rencontrer alternativement les formes Chauvet, Ciauvet
et Sauvet.
La confusion durera jusqu'au milieu du XXe
siècle, et se résoudra d'ailleurs par l'adoption officielle de
graphies contradictoires, selon les branches de la descendance,
devant divers tribunaux.
Le 24 novembre 1787,
en la cathédrale Sainte-Réparate, Barthélemy
se marie avec la jeune Niçoise Caterina Bottin (fille d'Antonio Bottino, originaire
de Peille, et de Maria Teresa Camossa).
Barthélemy et Catherine vivent sans doute quelque temps à Aspremont, où ils perdent leur premier
enfant (Agostino Antonio Pietro, décédé le 1er juillet 1789).
Ils s'établissent ensuite sur le territoire de la paroisse
Saint-Jacques, où ils ont bientôt un second fils : Pietro Sauvet, né le 27 mai 1790.
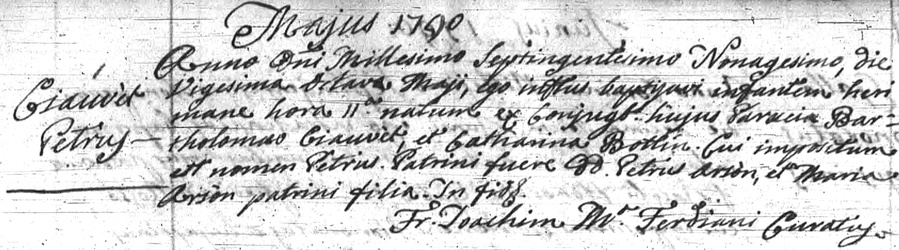
Occupation française
Guerre de 1792-1796
Les Français envahissent le Comté en septembre 1792, prenant
aussitôt Nice et Villefranche.
Les troupes françaises ont pris Aspremont sans résistance
dès septembre.
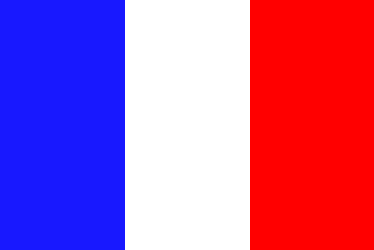 Dès le 31 janvier, les Français
revendiquent l'annexion du Comté, qu'ils proclament
"département des Alpes-Maritimes". La guerre va continuer en
montagne pendant plusieurs années. Dès le 31 janvier, les Français
revendiquent l'annexion du Comté, qu'ils proclament
"département des Alpes-Maritimes". La guerre va continuer en
montagne pendant plusieurs années.
Sous l'occupation, les Sauvet résident à la "porte France,
section 4" (ou "porte Neuve", l'ancienne porte Saint-Éloi,
qui donne sur le Pré-aux-Oies, du côté du futur pont
Neuf) [la porte et la rue sont indiquées en bleu sur le plan
ci-dessus].
Catherine meurt le 18
mai 1794 ("29 floréal an 2"). Barthélemy se
remarie aussitôt (le 2 juin, "14 prairial an II"), avec Camille Brun, née
en 1773 (fille de Gioan Onorato Brun et de
Francesca Gilli).
Un premier demi-frère de Pierre, Agostino Onorato,
naît sous l'occupation le "16 nivôse an IV" (6 janvier 1796).
En avril, l'armistice de Cherasco entérine la cession
du Comté de Nice à la France révolutionnaire.
Dans le "département des Alpes-Maritimes"
Les autres enfants de Barthélemy et Camille naissent sous le
régime français par temps de paix, notamment Joseph (en 1802).
 En mai
1804, Bonaparte se proclame "Empereur des
Français". Il élimine les symboles impériaux des armoiries
régionales : d'où le nouveau blason ci-contre attribué à la
ville de Nice, avec des abeilles et un soleil qui brille sur
un olivier et sur un citronnier. En mai
1804, Bonaparte se proclame "Empereur des
Français". Il élimine les symboles impériaux des armoiries
régionales : d'où le nouveau blason ci-contre attribué à la
ville de Nice, avec des abeilles et un soleil qui brille sur
un olivier et sur un citronnier.
Puis viennent d'autres enfants de Barthélemy et Camille,
notamment Françoise en septembre 1808 (qui épousera
en 1837 Pierre Bouet, avec lequel elle aura
plusieurs enfants dans les années 1840) et Marthe en juin 1813 (qui mourra
célibataire à l'âge de 27 ans).
Sous l'Empire, Pietro est boulanger. Le 2 septembre 1809,
il épouse Giuseppa Mascarel
(d'une famille de vermicelliers niçois de lointaine origine
piémontaise).
|
Restauration
 Les
États-Sardes
continentaux sont restitués aux Savoie en 1814, et l'ancienne république de Gênes y est
annexée par le Congrès de Vienne en 1815 (d'où le nouveau drapeau ci-contre).
Les
États-Sardes
continentaux sont restitués aux Savoie en 1814, et l'ancienne république de Gênes y est
annexée par le Congrès de Vienne en 1815 (d'où le nouveau drapeau ci-contre).
Si le premier enfant de Pietro
& Giuseppa est né sous l'Empire (Jean-Baptiste, vers
1813), il meurt dès 1816. Le second, Pietro, naît en 1815 (il se
mariera en 1846 avec une Thérèse Terese). Parmi les
enfants suivants, il faut mentionner surtout Maddalena, née et baptisée à
Sainte-Réparate le 9 avril 1821.
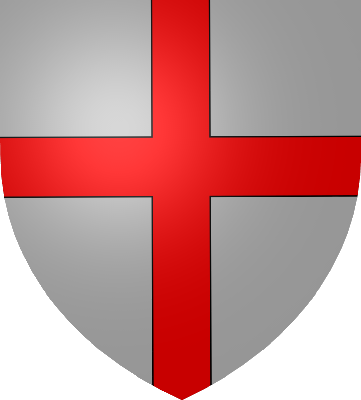  Pendant
ce
temps, à Gênes Pendant
ce
temps, à Gênes
Dans la première moitié des années 1820, à Gênes (Royaume de
Sardaigne), Agostino
Onorato et son épouse Rosa née Patrone ont un fils : Antonio
Chauvet.
Rosa est vraisemblablement génoise.
Agostino a-t-il émigré, seul, pendant l'occupation ? Ou
bien s'agit-il d'un déplacement au sein du royaume après le
congrès de Vienne ? et après la mort de son père ?
Toujours est-il qu'Antonio
Chauvet, demi-frère de Pietro et premier enfant de
sa mère, sera un sujet sarde né à Gênes, statut singulier au
sein de sa famille niçoise.
|
Lors du recensement de 1822, Pietro & Giuseppa habitent
avec leurs enfants dans la paroisse cathédrale, à la porte
27 de l'îlot 44 (entouré par les Bastions, la rue Centrale, la
rue du Collet et une actuelle impasse de la place Saint-François).
Maddalena grandit là avec ses frères Louis (11 ans) et Pierre
(7 ans), et sa grande sœur Françoise. Pietro est maintenant
teinturier. Son père (le tailleur Barthélemy) est mort
entre 1813 et 1822 : à la porte 36 de l'îlot 31 (devant
l'église paroissiale Saint-Jacques : rues Droite, du
Gesù, Benoît-Bunico et Place-Vieille), Camille
veuve Chauvet née Brun élève seule ses enfants (sauf
l'aîné, Agostino Onorato, alors à Gênes), qui sont donc le
demi-frère et les demi-soeurs de Pietro.
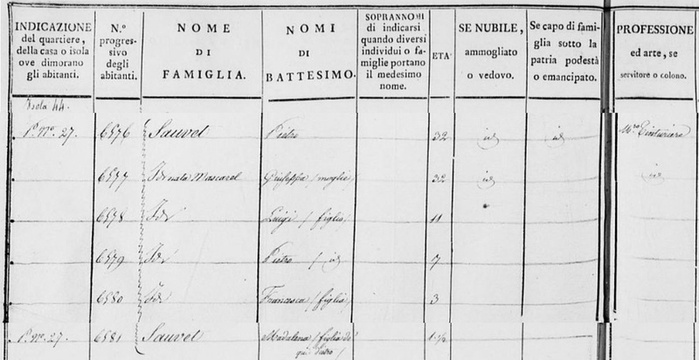
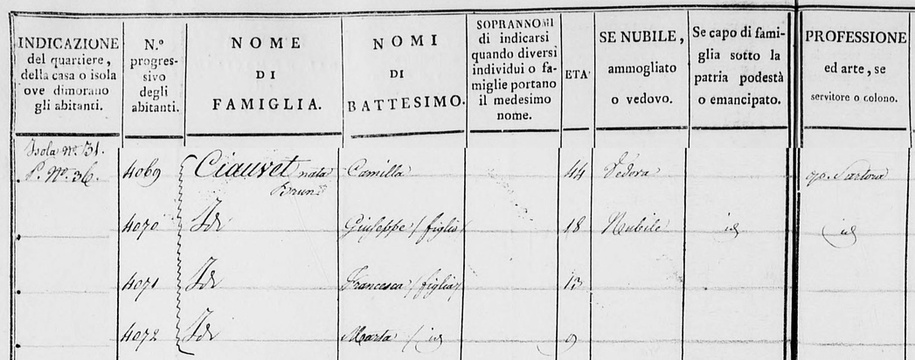 Dans le même cahier de
recensement, on remarque l'orthographe
Dans le même cahier de
recensement, on remarque l'orthographe Sauvet
pour la famille de Pietro, et Ciauvet
pour celle de sa belle-mère.
Dans les années 1820, après
ce recensement, Agostino Onorato
rentre à Nice avec Rosa et
leur fils Antonio (paroisse
Saint-Jacques). Ils vont avoir deux autres enfants : Francesca,
baptisée le 19 juillet 1829 ; Bartolomeo, baptisé le 16 juin 1833
(le parrain est Joseph Chauvet, sans doute l'oncle) ; mais
chacun mourra après quelques mois.
Joseph (autre demi-frère de Pierre) se marie au début des
années 1820 avec Marie Grondon, qui lui donnera une nombreuse
descendance.
En 1845, le 19 janvier,
Maddalena épouse l'ébéniste Antonio Cagnoli (elle a 21
ans, il en a 30). Lui aussi a une grand-mère paternelle
génoise, et un oncle né à Gênes : mais dans le cas des Cagnoli, l'exil génois remonte à la
guerre de 1792-1796. Tous deux vont quitter la vieille
ville, devenue particulièrement insalubre en ces années de
choléra, et fonder une famille dans les faubourgs
(Saint-Jean-Baptiste, Croix-de-Marbre). Les autres Chauvet restent
sur la rive gauche du Paillon.
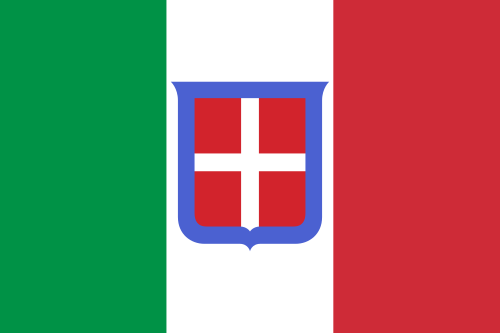 Vers
l'unité
italienne
Vers
l'unité
italienne
En mars 1848, le roi Charles-Albert mobilise les 4/5 de
l'armée sarde (65.000 hommes) pour aller soutenir les Milanais qui
se soulèvent contre leur empereur Ferdinand Ier. Le 31 mars, le
commandant de la place de Nice appelle les contingents de cavalerie
des classes de 1816 à 1821 (L'Écho
des Alpes maritimes, 2 avril) ; en outre, les militaires en
congé sont invités à se présenter à Turin pour un enrôlement
volontaire. C'est dans ce
contexte que le roi adopte le tricolore des révolutionnaires :
le nouveau drapeau, reproduit ci-contre, restera en vigueur
dans le royaume jusqu'en 1946.
Cette première "guerre d'indépendance italienne" est un échec.
Charles-Albert capitule ; Victor-Emmanuel II lui succède sur le
trône à Turin.
Antonio Chauvet devient
tailleur, conformément à la tradition familiale. Le 15 mai 1853, à
St-Martin-St-Augustin, il épouse Thérèse Saissi, couturière
née à Nice vers 1832 (fille de Gioanni Francesco Saissi et de
Maria Camilla Alvarez). Antonio est illettré (l'acte fera l'objet
d'un jugement de rectification en 1885 en raison des
orthographes fluctuantes).


Pietro Sauvet (père de
Maddalena) meurt le 26
janvier 1855 à l'hôpital de la Sainte-Croix,
administré par les pénitents blancs. Initialement,
l'établissement fut créé par l'archiconfrérie
confrérie des pénitents blancs en 1636 (intra-muros, à
l'emplacement de l'actuel 5 rue Zanin), avec onze
lits, dans le but d'accueillir et de guérir les malades
(à l'exception des fous, des contagieux, des vénériens
et des incurables). Depuis 1849 (et aujourd'hui encore), il
se trouve dans la paroisse Saint-Roch, sur la route de Turin
(38 rue Victor, alias avenue de la République).
|
Premier enfant d'Antonio et Teresa : Jean-Baptiste Chauvet,
le 19 février 1859
(baptisé le lendemain à Saint-Martin-Saint-Augustin).
En avril, Victor-Emmanuel se lance dans une seconde "guerre
d'indépendance italienne" contre les Autrichiens. Cette fois, il
s'est arrangé pour avoir le soutien militaire des Français. Du coup,
la campagne est un succès : la Lombardie est annexée aux
États-Sardes [carte ci-contre].
Conformément à l'accord contracté en juillet 1858
(entre Cavour, chef du gouvernement des États-Sardes, et
Bonaparte, empereur des Français), ratifié en janvier 1859 par
Victor-Emanuel II et publié par surprise en mars 1860, le Comté de Nice et
la Savoie sont cédés à Napoléon III en échange de l'aide
militaire apportée par la France en Lombardie.
Cession à la France
 L'armée française
entre dans Nice le 1er avril
et un référendum est improvisé deux semaines plus
tard.
L'armée française
entre dans Nice le 1er avril
et un référendum est improvisé deux semaines plus
tard.
Aucun Chauvet ne participe au scrutin. Apparemment, étant né à
Gênes (qui se trouvait pourtant dans le même pays que Nice, dans les
années 1820), Antonio est considéré comme Italien ; de
même que son fils, Jean-Baptiste, semble-t-il, en tant que fils
d'Italien. À moins que ce soit un choix de leur part, lors de
l'annexion ? En tout cas, comme on va le voir, le régime français
les traite en étrangers.
Deuxième enfant d'Antoine et Thérèse : Thérèse Chauvet, le 14 septembre 1869 (31 rue
Pairolière, Nice).
Devenue "place Napoléon" en 1860, l'ancienne place Victor est
renommée "place Garibaldi" le 13
septembre 1870, suite à la capitulation de Bonaparte
et à la proclamation de la république.
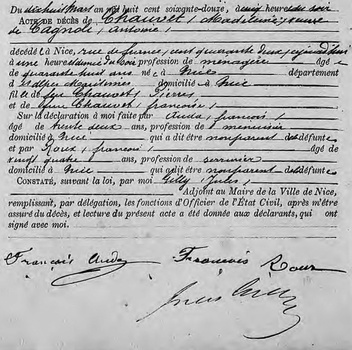
Maddalena Sauvet veuve
Cagnoli meurt en mars 1872, à l’âge
de 48 ans.
|
 Antonio et son fils
Jean-Baptiste, place Garibaldi
Antonio et son fils
Jean-Baptiste, place Garibaldi
Le 1er octobre 1884, Jean-Baptiste fils d'Antonio
(donc cousin d'Élie Ferdinand Cagnoli)
épouse Gabrielle Guiraud, fille d'un teinturier.
Leur fils Antoine Chauvet voit le jour le 6 mai 1889 (au 11 rue Paradis) ; mais la mère
meurt une semaine plus tard, le 13 mai.
Ces années-là, Jean-Baptiste est "caissier de banque", "employé",
puis "représentant de commerce" et "négociant".
Ses parents achètent un appartement au 4 place Garibaldi. Veuf,
il vit chez eux, avec son petit Antoine et sa sœur Thérèse,
couturière.
Sur l'image ci-contre (détail d'une photo de Giletta), le
numéro 4 est l'immeuble du fond, dont on voit deux des trois arcades
sous un balcon.
En 1891, érection
du monument à Garibaldi sur la place qui porte son nom (conformément
à l'engagement pris par le conseil municipal dès le mois
de juin 1882, le jour même où l'on apprit sa mort). Il est
inauguré le 4 octobre.
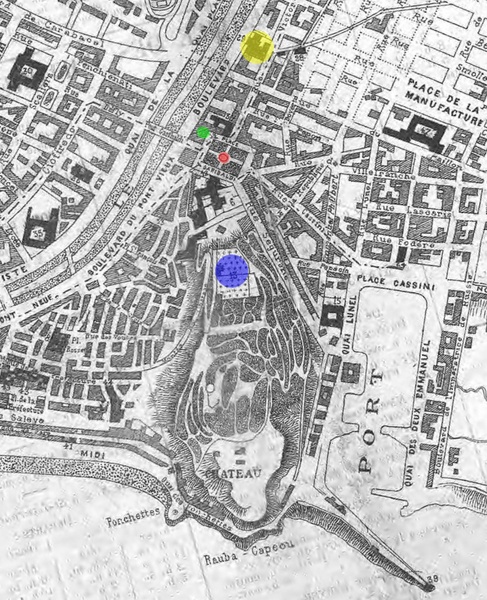
 Sur le plan de Nice en 1891 : le
domicile en vert et le monument à Garibaldi en rouge ; en outre,
l'hôpital de la Sainte-Croix est indiqué en rouge, et le
cimetière en bleu.
Sur le plan de Nice en 1891 : le
domicile en vert et le monument à Garibaldi en rouge ; en outre,
l'hôpital de la Sainte-Croix est indiqué en rouge, et le
cimetière en bleu.
À droite, inauguration du monument à Garibaldi [photo
Giletta].
En 1897, Jean-Baptiste
figure dans l'annuaire national de l'Union fraternelle du Commerce
et de l'Industrie, sous la catégorie "Renseignements commerciaux,
escompte et recouvrement".
Selon le recensement de 1901,
Antonio est "italien", tandis que sa femme est "française". Celle-ci
meurt le 13 janvier 1902.
Thérèse quitte le foyer en septembre
1903, lorsqu'elle épouse un jeune veuf, Joseph
Ottogalli, employé de commerce.
En 1904, curieusement,
Antonio est "citoyen français" (y a-t-il eu une naturalisation
? de même, il semblerait que Jean-Baptiste soit naturalisé en 1908).
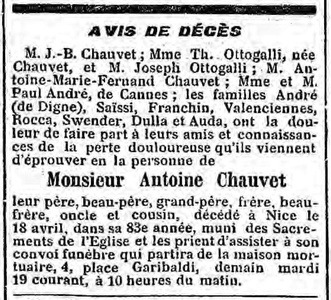
Antonio Chauvet meurt
le 17 avril 1904 à
son domicile. Ci-contre : l'avis de décès dans L'Éclaireur du
lendemain.
Une concession à perpétuité est acquise au cimetière
du Château.
Curieusement, la pierre tombale est entièrement
rédigée en italien. Cette caractéristique n'est
pas rare dans ce cimetière, vu que de nombreuses tombes sont
antérieures à 1860, mais c'est tout de même inhabituel,
voire audacieux, sous la Troisième République
française. C'est aussi le cas de la tombe de Jean-Baptiste
Toselli (†1885), ou de celle de Joseph André (†1903).
|
Après la mort des parents, Jean-Baptiste et son fils Antoine restent
seuls dans l'appartement de la place Garibaldi.
 Ci-contre : portrait d'Antoine
Chauvet (cousin d'Éloi
Cagnoli) sur la tombe familiale au cimetière du Château.
Ci-contre : portrait d'Antoine
Chauvet (cousin d'Éloi
Cagnoli) sur la tombe familiale au cimetière du Château.
Sources :
Archives départementales des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes
Anciennes
familles de Provence



 Provence
angevine
Provence
angevine
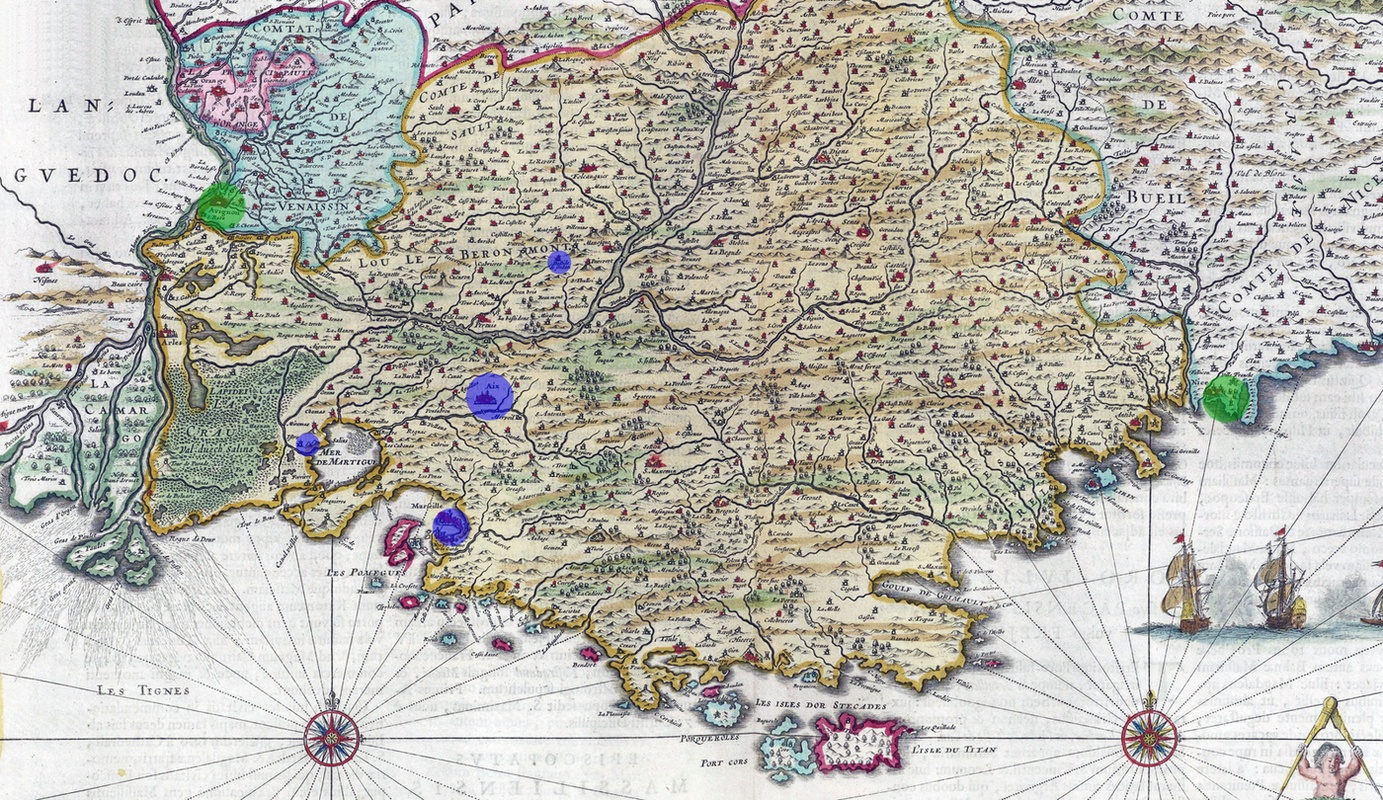
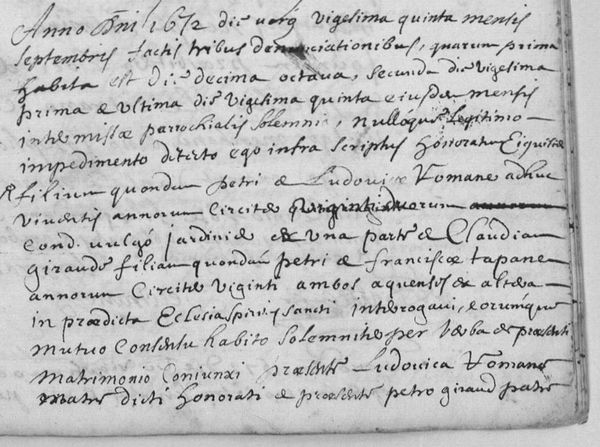
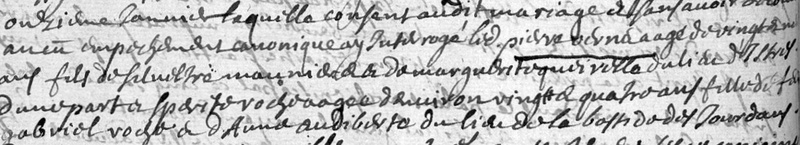
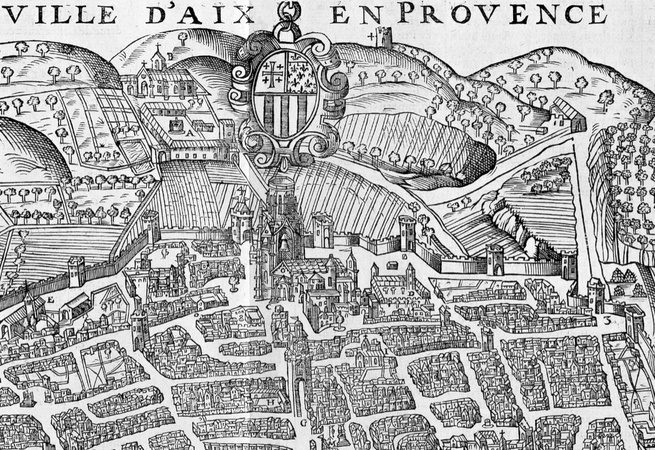
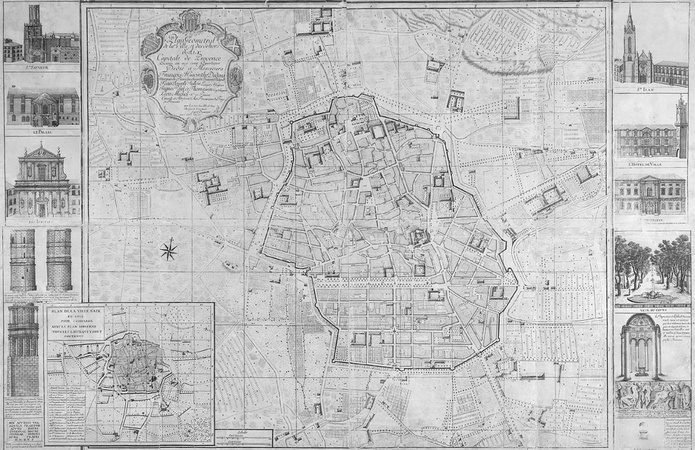
 Dans les années 1750, leur fils Pierre Sauvet
est à son tour maître tailleur à Aix. [À droite : portrait
imaginaire vers 1770.]
Dans les années 1750, leur fils Pierre Sauvet
est à son tour maître tailleur à Aix. [À droite : portrait
imaginaire vers 1770.]
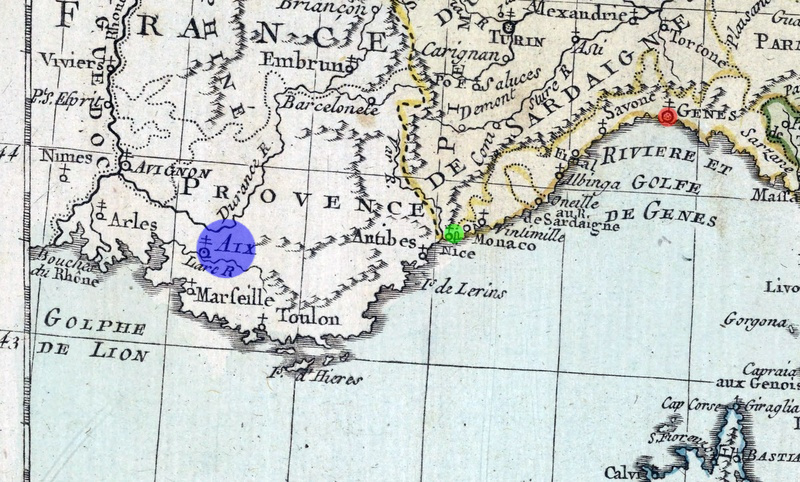

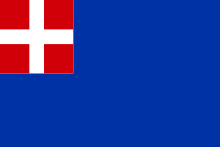 Comté
de
Nice
Comté
de
Nice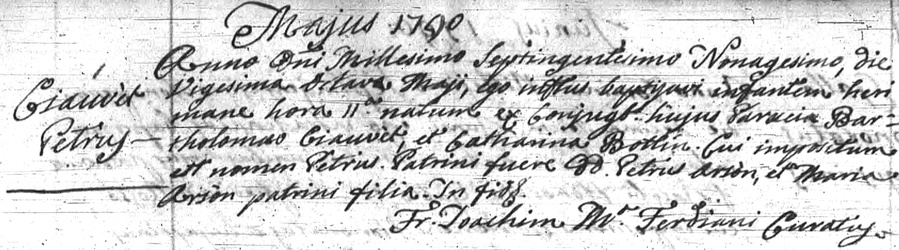
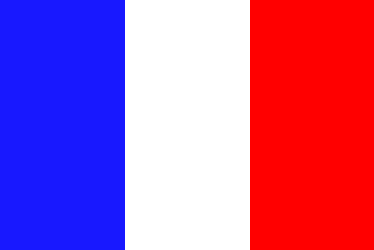 Dès le 31 janvier, les Français
revendiquent l'annexion du Comté, qu'ils proclament
"département des Alpes-Maritimes". La guerre va continuer en
montagne pendant plusieurs années.
Dès le 31 janvier, les Français
revendiquent l'annexion du Comté, qu'ils proclament
"département des Alpes-Maritimes". La guerre va continuer en
montagne pendant plusieurs années. 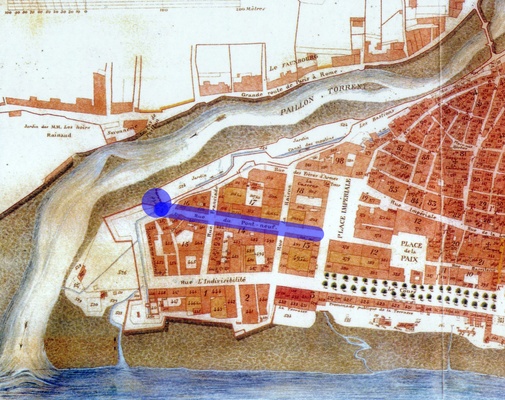
 En mai
1804, Bonaparte se proclame "Empereur des
Français". Il élimine les symboles impériaux des armoiries
régionales : d'où le nouveau blason ci-contre attribué à la
ville de Nice, avec des abeilles et un soleil qui brille sur
un olivier et sur un citronnier.
En mai
1804, Bonaparte se proclame "Empereur des
Français". Il élimine les symboles impériaux des armoiries
régionales : d'où le nouveau blason ci-contre attribué à la
ville de Nice, avec des abeilles et un soleil qui brille sur
un olivier et sur un citronnier.  Les
États-Sardes
continentaux sont restitués aux Savoie en 1814, et l'ancienne république de Gênes y est
annexée par le Congrès de Vienne en 1815 (d'où le nouveau drapeau ci-contre).
Les
États-Sardes
continentaux sont restitués aux Savoie en 1814, et l'ancienne république de Gênes y est
annexée par le Congrès de Vienne en 1815 (d'où le nouveau drapeau ci-contre). 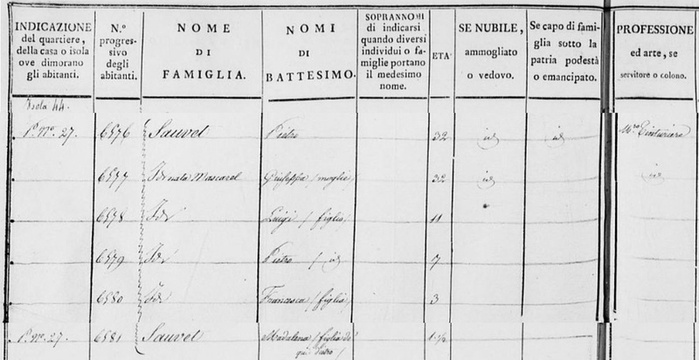
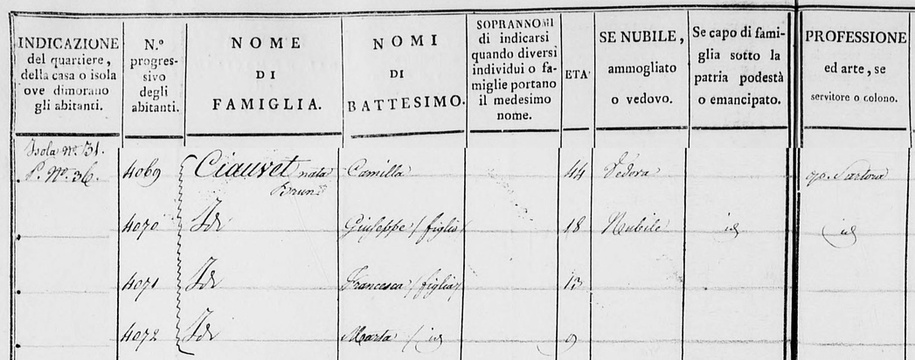
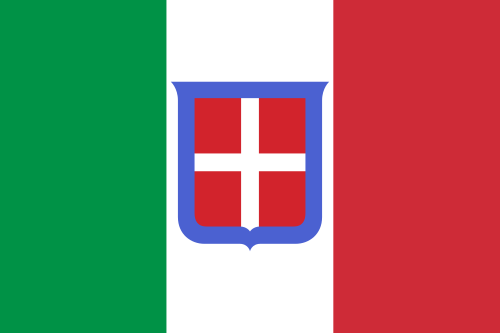 Vers
l'unité
italienne
Vers
l'unité
italienne


 L'armée française
entre dans Nice le 1er avril
et un référendum est improvisé deux semaines plus
tard.
L'armée française
entre dans Nice le 1er avril
et un référendum est improvisé deux semaines plus
tard. 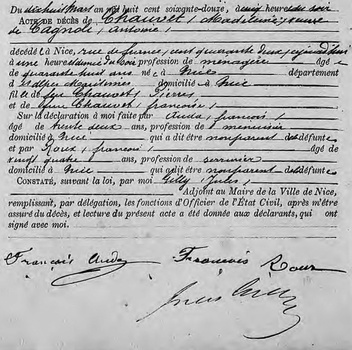
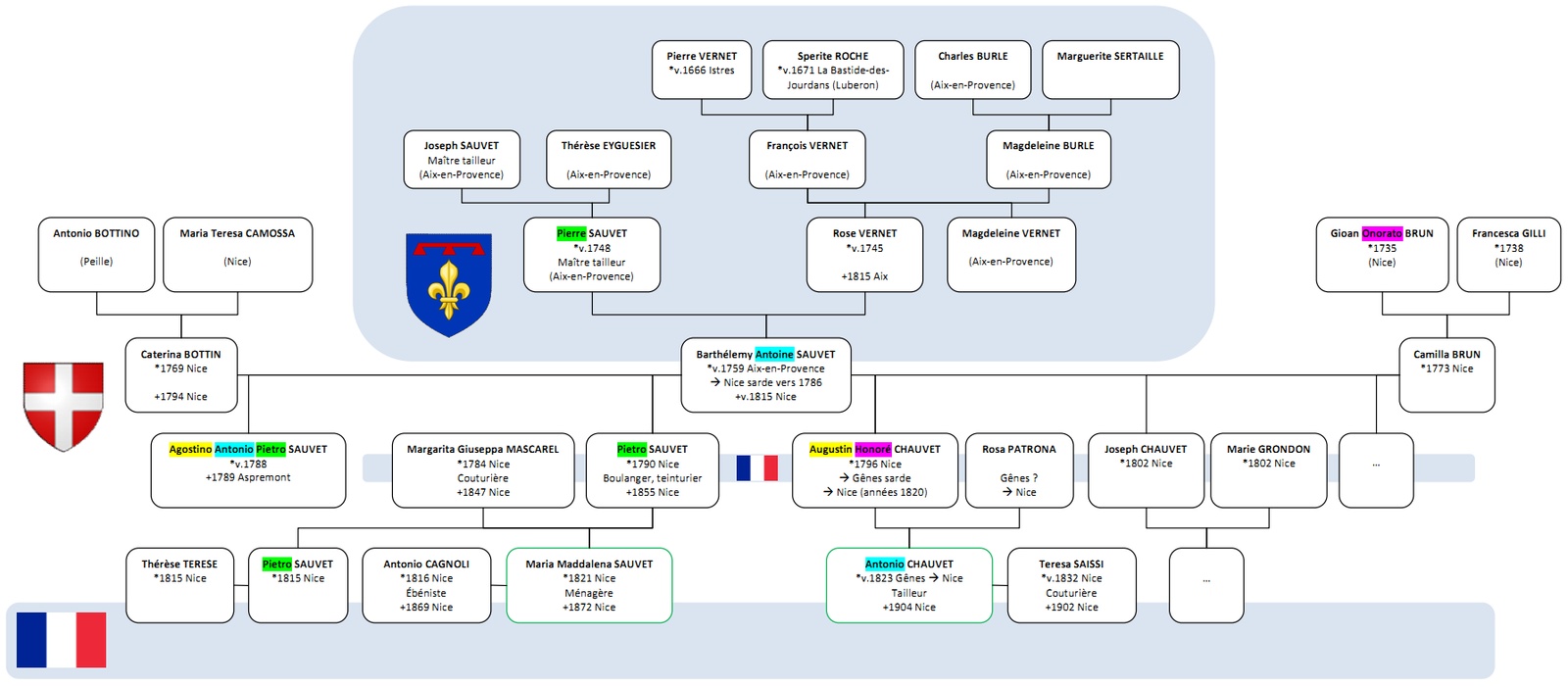
 Antonio et son fils
Jean-Baptiste, place Garibaldi
Antonio et son fils
Jean-Baptiste, place Garibaldi